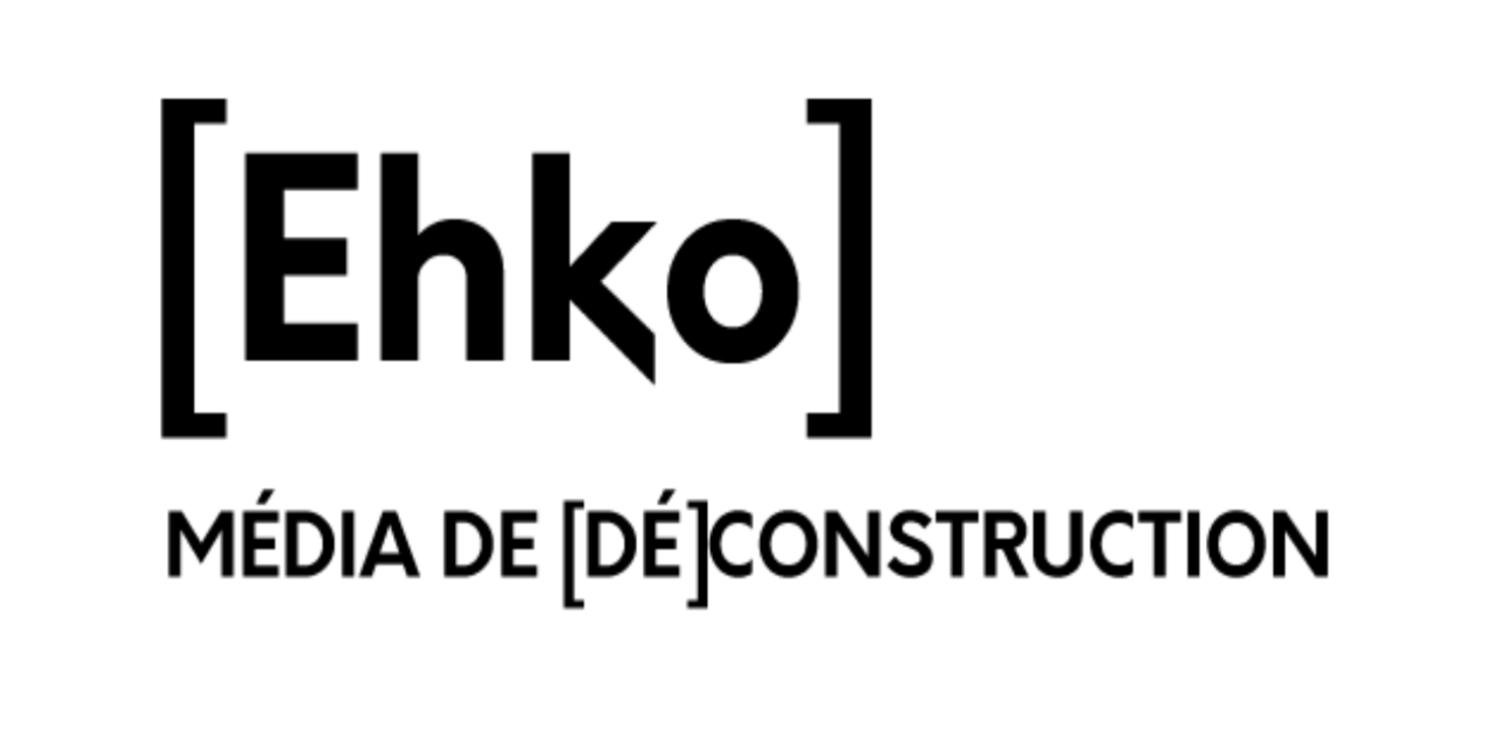[Le Parti des Indigènes de la République] vient d’avoir 15 ans. Houria Bouteldja a annoncé ce 6 octobre sa démission de ce mouvement qu’elle a co-fondé et qui a bouleversé le champ politique.
En France, elle est une absente trop présente. Notamment par les idées diffusées par le PIR. Sans atteindre l’hégémonie culturelle chère à Gramsci, ces idées dites « indigénistes » sont devenues la pierre d’achoppement sur laquelle viennent vaciller de nombreuses certitudes françaises. Une ligne de démarcation, qui force à se positionner.
[Ehko] l’avait rencontrée avant l’annonce de sa démission, puis en a parlé avec elle. Elle a accepté de répondre à des questions souvent posées sur elle, mais pas à elle, et d’expliquer sa décision.
[Ehko] : Vous avez démissionné du PIR et en avez expliqué les raisons. Vous dites notamment que le PIR est devenu « trop radioactif » et un « fardeau » pour vos amis. Qu’entendez-vous par cela ? Est-ce la fin du PIR ?
[Houria Bouteldja] : Je ne sais pas si c’est la fin du PIR parce que des frères ont décidé de poursuivre l’aventure.
J’aurais préféré une dissolution pour que les choses soient claires et plus en conformité avec ce que nous sommes un certain nombre à penser : le PIR est arrivé à la fin d’un cycle qui a accouché d’une œuvre politique inouïe mais qui voit sa principale cheville ouvrière sacrifiée sur l’autel de la « raison » ou de la lâcheté.
Nous sommes devenus radioactifs car la résistance du champ politique blanc est à l’œuvre et ne s’est jamais arrêtée d’agir. Le système immunitaire blanc, comme j’aime à l’appeler, a mobilisé toutes ses défenses pour sauver les structures de sa domination. Et la gauche n’est pas en reste. Il a fallu 15 ans pour nous isoler totalement, ce qui est quasiment un hommage que ces forces nous rendent car cela aurait pu être plus rapide. Il suffisait de nous acheter ou coopter, ce que personne n’a réussi à faire. Comme nous étions intègres, la seule solution devenait l’isolement par la radioactivité.
Notre fréquentation devenait un coût à payer pour nos alliés. Et c’est ce qui s’est passé. Cela ne s’est pas fait sans complicité indigènes bien sûr, mais ça c’est très banal. Depuis cette annonce, nous recevons des tonnes d’hommages et de témoignages de reconnaissance. Beaucoup se disent « orphelins », « sonnés ».
Pour notre part, c’est un peu la déprime mélangée à une immense fierté. Dieu nous ouvrira d’autres voies in cha Allah.
Une fois pour toute, qu’entendez-vous par « blanc » ?
Blanc, c’est non seulement un rapport social mais c’est surtout un rapport de pouvoir produit d’une part par l’histoire coloniale et d’autre part par les Etats et par les idéologies qui ont institué les Occidentaux comme supérieurs. Les Blancs sont ceux qui en bénéficient objectivement, quelles que soient leurs convictions politiques. Les Indigènes, c’est la catégorie contre laquelle s’exerce cette domination.
Qui êtes-vous Houria Bouteldja, selon vos propres mots ?
Je suis fille d’immigrés algériens, née en Algérie mais je suis venue à l’âge de 6 mois en France. Ma mère était femme au foyer. Mon père était ouvrier du bâtiment. J’ai très peu milité pendant mon parcours universitaire durant lequel j’ai fait des études de langues. Cette partie de ma vie n’a pas d’intérêt même si je pense avec le recul que j’ai tenté de soigner, à travers mon engagement tardif, toutes mes névroses de fille d’immigrés.
J’ai fait mes études à Lyon et suis arrivée à Paris au début des années 2000, juste un peu avant le 11 septembre. Ça a été une déflagration islamophobe. Dans le prolongement du 11 septembre, il y a eu le débat sur le voile. J’étais à titre personnel très affectée par l’islamophobie médiatique. Je n’ai jamais été engagée à gauche, n’ai jamais été attirée par elle. Je n’y aurais jamais mis les pieds. Mais j’étais à la recherche d’espaces où rencontrer des gens qui me ressemblaient, c’est-à-dire qui avaient les mêmes préoccupations que moi. Je manifestais aussi pour la Palestine. C’est l’époque de « Ni putes ni soumises » (NPNS). Je rencontre Pierre Tévanian avec qui je lance la pétition « Oui à la laïcité, non aux lois d’exception ». Cette pétition en rencontre d’autres, notamment une lancée par Christine Delphy et une autre de milieux antiracistes. La rencontre des trois pétitions crée « Une école pour tous et pour toutes ». C’est là que je commence à militer, dans le contexte de la loi sur le voile.
La militance commence donc pour vous en 2004 et non 2001 ?
2001 instaure un climat islamophobe général. Je bascule avec la concomitance de l’apparition de NPNS et la loi sur les signes religieux à l’école dite loi sur le voile.
Vous dites que l’islamophobie vous pesait déjà. L’avez-vous subie à titre personnel ?
Je n’étais pas voilée et la question n’est au fond pas là. L’islamophobie est une métamorphose du racisme anti-arabe. Quand on vise les musulmans, on vise les arabo-musulmans. Je percevais qu’à travers la loi sur le voile, on nous visait tous.
Je ne viens pas d’une famille politisée mais mes parents sont des Algériens (sourire). Spontanément, j’étais du côté des Indiens contre les cow-boys. On était les Indiens de France. J’articulais la question internationale avec les problèmes internes. Je voyais bien que la guerre contre l’islam menait à la destruction de l’Irak. Tout cela était déjà très clair pour moi.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas reconnue en « Ni putes ni soumises » ?
Quand j’en ai entendu parler la première fois, je suis allée à une de leur conférence, sans préjugé. J’ai entendu des discours qui amalgamaient les violences des quartiers et la violence en Algérie. Je me suis demandé pourquoi ce lien avec l’Algérie plutôt qu’avec la France puisque ces violences étaient produites par la société française. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun lien ne serait-ce qu’en raison d’une tradition patriarcale propre à la Méditerranée. Mais dans ce cas, il faut être rigoureux. Là, on sentait bien que c’était les « Arabes » qui étaient visés. De fait, la lecture était raciste, essentialiste. Les mecs indigènes de France seraient les mêmes qu’au bled. Or, les mecs de France sont le produit de la société française. Ce discours m’a bloquée tout de suite.
Avec des militantes qui se retrouvaient dans la lutte contre la loi sur les signes religieux, on a créé « Les Blédardes ». On percevait que NPNS était dans la lignée de l’idéologie coloniale française : arracher les femmes à leur famille, les couper de leur histoire. Dire « Blédardes » c’est affirmer cette appartenance, ne pas nier cette dimension en nous. Dès 2004, on a dit ce qui allait être pour moi comme un fil à plomb : solidarité avec les hommes dominés. Comme la cible était l’homme indigène, et que nous étions l’instrument de cette attaque systématique, il fallait affirmer que nous les femmes étions solidaires d’eux. Une façon de dire que nous refusions que soit rendue encore plus conflictuelle les relations hommes-femmes déjà, compliquées dans nos milieux, et que le reste, on s’en débrouille.
La vérité n’est pas qu’on ignore le sexisme, le patriarcat. On les reconnaît. Mais notre position était que le combat antiraciste était un préalable à une discussion sur le sexisme. Mon point de vue a toujours été que pour desserrer l’étau sur les femmes, il fallait réhabiliter les hommes. C’est paradoxal mais c’est comme ça. Voilà pourquoi le féminisme n’allait pas de soi. Puis ce mot est piégé aussi par l’histoire car on a beaucoup utilisé le féminisme dans le passé colonial pour casser la résistance des peuples. Ma conviction a toujours été qu’avant de s’attaquer aux hommes, il fallait déjà qu’ils aient le droit d’exister comme sujet politique. Chose qui ne se fait et dit jamais. Seules les femmes seraient dominées. Pourtant, s’il n’y a pas une proposition faite aux hommes non-blancs, le conflit hommes-femmes va non seulement perdurer mais il s’enkystera. Il y a là d’abord un étau à desserrer.
Vous ne vous reconnaissiez pas en la gauche dites-vous. Dans la gauche institutionnelle comme l’extrême-gauche ?
Dans aucune des deux. Je n’ai jamais eu d’atomes crochus avec la gauche d’abord, avant tout parce qu’elle est blanche. Mon intuition que la gauche n’était pas pour nous a précédé ma certitude et mes engagements postérieurs. Cela s’est confirmé avec le temps. J’ai co-créé un mouvement précisément en rupture avec cette gauche. Pour pouvoir mettre à nu son caractère « blanc », il a fallu rompre avec elle. C’est cette rupture que nous avons actée avec l’Appel des indigènes.

La prise de conscience de cette gauche vient donc de la mise en accusation faite par le PIR ?
La critique de la gauche par les mouvements de l’immigration nous a précédés. Mais l’Appel des Indigènes en 2005 a consommé le divorce. On sortait d’un débat pénible sur le voile et sur ce sujet, la gauche comme l’extrême gauche ont été nullissimes. Si la loi est passée, c’est aussi à cause de cette gauche blanche capitularde.
Capitularde ou complice ?
Elle a d’abord été complice, mais avec des nuances : si nous avons pu faire « Une Ecole pour tous » c’est aussi avec l’aide de certains pans d’extrême gauche. Mais ils étaient minoritaires. La gauche a été soit mal à l’aise soit complice de la loi sur le voile.
Comment l’expliquer ?
La gauche est blanche. Elle est eurocentrée. Elle se croit matérialiste alors qu’elle est idéaliste. Par exemple, elle est anticléricale, et cela se comprend dans un contexte historique d’une Eglise puissante et au cœur de l’Etat. Mais quand on est matérialiste, on comprend que ni l’islam ni les musulmans ne dominent l’Etat français.
Les musulmans sont la part du monde ouvrier la plus pauvre.
Ces deux éléments auraient dû faire de la gauche les principaux alliés des musulmans. Sans discussion. Or elle a discuté, sur le dos des classes les plus basses. Les gens de cette gauche n’ont pas vu leurs damnés de la terre. Ils ont vu le voile. Encore cet eurocentrisme. L’expérience blanche prévaut sur tout. La libération serait comme les Blancs la vivent. L’expérience des femmes blanches serait celle de l’humanité. Or l’affaire du voile a montré que cette expérience spécifique des rapports de genre n’est pas celle de tous. A ce moment-là, il n’y avait que des résidus de gauche anticolonialiste et pas d’antiracisme politique. La gauche s’est faite complice de ceux qui sont désormais ses adversaires politiques acharnés, ceux qui répriment aujourd’hui le mouvement social.
Lire aussi : Monde du travail : l’islam plébiscité puis diabolisé
Mais avant cette loi sur le voile, il y avait déjà un conflit entre la gauche et le monde indigène. C’est toute l’histoire de la marche pour l’égalité de 1983, qui était une préfiguration de l’antiracisme politique. Les militants de l’époque visaient la violence policière, une institution de l’Etat. La gauche a répondu par un antidote redoutable : l’antiracisme moral. Pour résumer, les méchants étaient monsieur et madame Dupond ou l’extrême droite. Or les marcheurs visaient la police. Nous avons donc été étouffés pendant une quinzaine d’années par cette soft idéologie. Tous ont soutenu SOS Racisme, y compris la LCR (Ligue communiste révolutionnaire). Je n’aimais pas ce « Touche pas à mon pote » qui puait le paternalisme.
Le mot « nous » que vous employez parfois, que ou qui regroupe-t-il ?
D’abord, je n’ai aucun problème à dire « nous ». La question de l’appartenance est légitime. Je peux dire « nous les Maghrébins », « nous les Algériens », « nous les Arabes » sans éprouver le besoin de complexifier mon identité.
C’est comme s’il fallait atténuer le caractère le plus racialisé de notre être, celui qui par son essence agresserait les Blancs. Je sens que lorsque je dis par exemple « Je suis musulman mais je ne fais pas le ramadan », c’est une façon de protéger le Blanc de ma pleine humanité qui en soi l’agresse lui. Ainsi, pour ne pas le heurter, je dois me dissoudre. C’est pourquoi il faut assumer : « Je suis Arabe » même si en fait je suis Berbère. Sinon, c’est vouloir fuir dans une impasse. Du coup, je ne me sens pas obligée de dire que je suis plurielle. Je préfère revendiquer les identités rugueuses et indigestes. Il y a donc ce « nous » des origines, de l’héritage direct et sensible. Il y a aussi un « nous » d’une catégorie sociale, d’une condition spécifique de l’immigration post-coloniale en France. Et enfin, il y a le « nous » politique des Indigènes de la République : le sujet colonial qui lutte et s’organise.
Il pourrait exister un autre « nous », celui de la convergence avec la gauche.
Quand le NPA (Nouveau parti anticapitaliste) soutient la marche de la dignité, je dis « nous » avec le NPA . Il s’engage dans une démarche décoloniale avec nous. Dans un projet où ce n’est pas la défense des prolétaires blancs qui est revendiquée mais la défense des indigènes. Quand une force politique blanche défend les intérêts des indigènes, il y a formation d’un « nous » politique. Un prélude de la communauté politique que nous devons faire advenir.
Sans discuter des modalités de cette défense ?
Sans discuter des prérogatives de l’autonomie politique des indigènes et de la direction de cette lutte. Cela fait 40 ans qu’on réclame cette autonomie. Quand la gauche transforme notre lutte, elle empiète sur nos priorités. Quand elle adhère aux revendications des couches les plus basses de la société alors le « nous » devient une évidence. C’est ainsi qu’on fait reculer la racialisation des rapports sociaux.
D’où vient le nom du PIR et ce mot « indigène » ?
J’ai trouvé ce nom en 2003. C’était 6 mois avant les 20 ans de la marche de l’égalité. Pendant l’affaire du voile, je me disais qu’on a marché il y a 20 ans et qu’ils s’étaient moqués de nous. J’ai eu cette idée en me disant qu’on était traités comme des indigènes et que la colonisation n’était pas finie. L’idée du continuum colonial m’a frappée.
On est là pour dire que la République égalitaire est un mythe, même si tout le monde s’en gargarise. Dans cette République, il y a des sous-citoyens. Et c’est nous.
Lire aussi : Insécurité républicaine
Ensuite la loi de 2004 est votée. J’ai toujours en tête de rapprocher la question Nord-Sud et la question interne. D’autres militants se greffent à cette idée et nous décidons de lancer l’un appel « Nous sommes les Indigènes de la République », avec la mouvance d’une école pour tous, des milieux pro-palestiniens, des comités antillais, anti-impérialistes.
Cette loi de 2004 contre le voile, l’inscrivez-vous dans la lignée du Code de l’indigénat ?
Oui, dans un code implicite, qui n’est pas assumé comme tel. Je sais très bien que l’époque de l’indigénat est révolue. Par contre des formes subsistent : à une discrimination systémique correspond une sous-citoyenneté systémique et même une forme d’apartheid social/racial. Même si je prétends que nous sommes des « indigènes aristocrates » par opposition aux damnés de la terre qui vivent sous un régime impérialiste.
Ce mot « aristocrate »… On a pu reprocher au PIR une forme de déconnexion avec les quartiers populaires, d’être un parti d’intellectuels, une sorte d’avant-garde éclairée mais déconnectée. Qu’en pensez-vous ?
Attention, quand je dis « aristocrate », je ne parle pas ici de la composition sociale du PIR. C’est un mot que j’applique à tous les indigènes de France, quelle que soit la catégorie sociale. Nous ne vivons pas dans un pays ex-colonisé soumis aux rapports Nord-Sud et nous avons malgré tout un avantage lié à la blanchité. Mais à l’intérieur de cet indigénat blanchi, il y a des contradictions de classe.
S’agissant du stigmate « intellos », « bobos indigènes », il me fait sourire. D’abord parce que nous sommes quasiment tous issus de l’immigration ouvrière. Ensuite parce que nous assumons d’être une organisation qui produit de la théorie politique.
Il faut bien structurer un mouvement politique et l’outiller d’armes théoriques et politiques.
Toutes les organisations fonctionnent avec une pensée politique et je trouve étrange qu’on nous le reproche. Nous voulons être une organisation de cadres. Et en former. La droite produit aussi de la pensée, de l’intellectualité qui sert la blanchité, à tout niveau. Le peuple ne lit pas forcément Alain Finkielkraut ou Marcel Gauchet par exemple mais leur pensée structure et infuse. C’est pareil pour nous. Tout le monde n’a pas à lire nos textes théoriques mais ceux-ci charpentent notre stratégie politique. Par ailleurs, nous avons d’autres modalités d’action plus en phase comme les manifestations, les débats publics, les créations de collectifs contre les violences policières…
Plus largement, les indigènes ont été exclus de la transmission politique.
Les mouvements antiracistes ont été empêchés de s’installer et de former politiquement les gens.
Le MIB a pu en faire les frais par exemple. Le PC (Parti communiste) s’est aussi dégagé de la formation politique des classes populaires blanches. C’est un constat général. Enfin, il faut connaître cette règle d’or : plus on est politiquement radicaux, moins on rentre dans un quartier.
Si le PIR n’y entre pas, ce n’est pas parce qu’il est rejeté des habitants ou trop snob pour y aller. C’est surtout parce que toutes les forces se sont coalisées pour l’en empêcher. L’ostracisation du PIR va jusque dans les milieux indigènes. Si je suis une sorcière et que tout le monde me rejette, personne n’osera, dans un cadre associatif, m’inviter. Le monde associatif vit des subsides de la ville. On dira vite que nous sommes des « communautaristes » ou des « antisémites ». Nous avons un discours autonome, ne sommes financés par personne. Le seul moyen de nous contrôler, c’est le boycott.
Nous avons une pensée qui infuse par le haut. Ce pragmatisme a produit les effets que tout le monde connaît puisque la pensée « indigéniste » a triomphé finalement. Les deux organisations pestiférées qui ont percé en France sur le plan national en mettant en place une stratégie par le haut sont le PIR et le CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France).
Mais comment expliquer que vos idées soient devenues centrales dans les débats politiques ?
Parce que des idées, ça se politise. Il ne s’agit pas seulement d’avoir raison. Il faut convaincre. Pour convaincre, il faut s’armer d’un appareil politique et d’une stratégie. Il faut bien évidemment connaître son environnement et maîtriser les contradictions politiques. Il faut créer du rapport de force. C’est ce que nous avons fait pendant 15 ans.
Vous êtes invitée à vous exprimer dans de prestigieuses universités à l’étranger, à des évènements internationaux. En France vous êtes à la fois invisibilisée, citée et accusée en votre absence, sans que vous puissiez vous défendre. Pourquoi un tel contraste ?
En France, on a pulvérisé toutes les questions qui participent du mythe français partagé par tous, la République, l’Egalité… On a pulvérisé la matrice de l’universalisme blanc. Un ami me disait « Il faut creuser l’incompréhension ». C’est ce que nous faisons.
On s’est aussi attaqués à toutes les idées émancipatrices qui font l’ADN de l’extrême gauche : le féminisme versus le féminisme décolonial et les masculinités non hégémoniques ; l’antisémitisme versus le philosémitisme. On a montré que l’extrême gauche était tendanciellement philosémite car elle ne remettait pas en cause le suprémacisme blanc de l’Etat-nation. Les juifs y sont par conséquent toujours des sous-citoyens, des sujets raciaux qui ont aussi pour fonction de tenir la boussole de la bonne conscience blanche.
Et sur l’homosexualité ?
Plutôt sur la question de la politisation de la sexualité… Pour fuir ce débat, on a feint de comprendre que je disais que l’homosexualité n’existait pas dans le monde arabe alors que je parlais des identités LGBT. Ça a été une vraie déflagration.
Notre position consiste à dire que l’identité gay n’est pas universelle. Ensuite, que la politisation des sexualités n’est pas non plus universelle. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des penseurs marxistes ont montré comment et pourquoi on a politisé la question sexuelle dans les démocraties libérales. Nous partageons ces analyses mais les agrémentons d’un regard décolonial. Il faut cesser de vouloir « civiliser » la sexualité des non Blancs. Il existe de nombreux milieux où l’invisibilisation est un véritable choix.
Nous avons commencé à défricher ce terrain vers 2013. Depuis, de nombreux chercheurs ont marché dans nos pas sans jamais nous citer. Quand tu parles en tant que chercheur, tu es validé par tes pairs. Quand tu parles en tant que militant décolonial, tu es homophobe.
Ces gens savent que nous ne sommes en rien homophobes. Mais ils ne prendront pas notre défense car il importe que nous restions infréquentables. En effet, la recherche n’a aucun impact en politique, quand nos analyses, elles, se traduisent sur le plan politique. Par exemple, parce que nous ne laisserons personne civiliser notre sexualité, nous ne pouvons adhérer sans les critiquer ces idées qui veulent imposer, au Tiers-monde où dans les quartiers, les formes de vie gay qui sont spécifiques à un milieu et à une classe sociale. Ainsi, même si on peut être amené à faire les mêmes analyses, on entre en contradiction avec le monde académique qui pourrait perdre en crédibilité s’il validait nos thèses. Car ce monde, comme le reste du champ politique blanc, défend d’abord les intérêts des Blancs.
Selon vous, les questions sociales, de précarité, d’accès aux soins sont mises de côté au profit de sujets dits sociétaux ?
Ce qui me gêne, c’est que le « Mariage pour tous » (MPT) soit considéré comme révolutionnaire alors qu’il s’inscrit globalement dans un projet homonationaliste. Le plus gênant, c’est que la défense de causes tout à fait légitimes (et je mets la lutte contre l’homophobie dedans) se font la plupart du temps au détriment de la lutte des classes en général comme si une synthèse globale entre les deux n’était pas possible. Or, il me semble que la ligne décoloniale en est capable, puisqu’elle intègre l’anti-impérialisme qui rentre en contradiction totale avec l’homonationalisme. Mais comme la priorité est donnée a plus d’intégration des Blancs dans la blanchité, les choix sont presque écrits d’avance.
L’État a besoin d’une base et les Blancs sont sa base sociale. Quand le PS est d’accord pour autoriser le MPT, c’est aussi que cette mesure ne remet pas en cause le capitalisme, ni les traités européens et encore moins l’impérialisme.
Le coeur du débat c’est que cette gauche qui se mobilise pour ça aurait pu se mobiliser avec autant de force contre le chômage et la précarité – je ne parle même pas des questions indigènes – dont elle devrait se préoccuper aussi. Non, ce qui compte, c’est le renforcement du pacte racial qui est lui-même une condition pour le maintien de l’ordre mondial. Pour les femmes blanches, c’est le même processus à travers le fémonationalisme.
Ainsi, il devient impératif de ne pas lever le doute sur ma supposée homophobie. Tant que je reste sorcière, le débat ne peut pas avoir lieu et la bonne conscience est sauve. En revanche, si je deviens une interlocutrice valable, la gauche prend un risque. Celui de faire une grande découverte sur elle-même. Et c’est vrai que pour sa dignité personnelle, la découverte peut être douloureuse : peut-être qu’ils ne sont pas si anti-antisémites que ça, pas aussi anti-racistes que ça, pas aussi féministes que ça, pas aussi anti-homophobes que ça. Peut-être qu’en creux de tous leurs mouvements, il y a la préservation de leur petit monde. Et cette découverte est effectivement assez terrible. Donc plutôt que risquer cette découverte, Houria Bouteldja sorcière, ça arrange tout le monde.
Donc tout ce qu’ils vous reprochent, c’est ce qu’ils seraient eux ?
Oui !
Réclamez-vous finalement un droit à l’indifférence. Indifférence à la sexualité des gens, à l’identité, etc, sur fond de matérialisme historique ?
Oui. Si Marx était vivant, il serait très content de nous. Eux nagent dans l’Idéalisme [Ndlr. Au sens philosophique] total.
Pourquoi vos détracteurs vous accusent-ils d’être antisémite ?
Pour commencer, il faudrait qu’ils sachent ce qu’est l’antisémitisme. Ensuite, ils citent par exemple mon rapport au petit garçon qui porte la kippa [Ndlr. Extrait du livre Les Blancs, les juifs et nous. Vers une politique de l’amour révolutionnaire(La Fabrique, 2016) : « Le pire, c’est mon regard, lorsque dans la rue, je croise un enfant portant une kippa. Cet instant furtif où je m’arrête pour le regarder. Le pire c’est la disparition de mon indifférence vis-à -vis de vous, le possible prélude de ma ruine intérieure ».] en disant que c’est de l’antisémitisme. Sauf que je ne parle pas de moi en tant qu’antisémite effective, mais en tant qu’antisémite en possible devenir (« le possible prélude de ma ruine intérieure »), ce que je dis redouter dans le texte.
De plus, j’assume de dire comme Frantz Fanon : « Une société est raciste ou ne l’est pas ». Etant moi-même un élément de cette société, je suis atteinte par le racisme d’une manière ou d’une autre. Et c’est vrai pour toutes les autres oppressions.
Vous parlez donc en tant que Française quand vous tenez les propos qui vous sont reprochés, avec l’héritage de ce que la France a fait aux juifs, alors que ceux qui vous critiquent ont vu la preuve d’un prétendu « antisémitisme arabo-musulman » ?
Oui. Dans ce passage, je parle de mon rapport aux juifs en tant que produit de la société française. La société dans laquelle nous sommes tous. Je parle de la dégradation du rapport des indigènes aux juifs. Je pense au soralisme, à comment de plus en plus d’indigènes deviennent antisémites car ils vivent dans une société raciste. Que c’est l’Etat-nation qui impose une hiérarchie selon laquelle les juifs seraient en quelque sorte mieux traités. Les Indigènes de République savent que les juifs sont aussi des sortes d’indigènes. Mais l’indigène de base se dit qu’il n’y a pas de raisons que les juifs soient les chouchous et pas eux. Puis il y a des indigènes intégrationnistes qui, au lieu de remettre en cause la hiérarchie et la suprématie blanches, veulent la place du juif.
Tendanciellement, il y a une évolution des juifs vers la droite et vers le sionisme, alors qu’avant ils étaient du côté de l’extrême gauche. Nous ne sommes pas dans de l’essentialisation. A partir du moment où existe le postulat qu’une société est raciste ou ne l’est pas, nous disons alors qu’une société est antisémite ou ne l’est pas. A partir du moment où on est dans une société antisémite, on est probablement peu ou prou antisémite.
L’extrême gauche me fait rire. Elle construit un espace politique « safe », non raciste, non sexiste… Selon leurs présupposés, ils sont protégés de l’antisémitisme par un cordon sanitaire. Mais il arrive qu’à l’intérieur apparaisse un élément rouge-brun. Que fait alors la gauche blanche ? Elle se réunit, en conciliabule, tétanisée, elle pousse des « quelle horreur » et finit pas rejeter cet élément de l’autre côté du cordon. Le corps redevient sain à l’intérieur et ils sont contents.
Nous ne raisonnons pas ainsi. Plutôt que de croire que les autres sont antisémites et pas vous, commençons par nous poser des questions sur le rapport à l’Etat-nation et aux juifs, qui vous affecte, que vous le vouliez ou non. Ce n’est pas moi qui, par volonté personnelle, vais pouvoir extirper en moi l’homophobie, le sexisme, l’antisémitisme. Cela ne se passe pas comme ça.
Je sais que le corps indigène est ensauvagé par ce système. Si on veut mettre fin à cet ensauvagement, il faut affronter le rapport au petit enfant à la kippa, aux rapports humains qui se transforment en raison de cette hiérarchie raciale. Une fois que cela est reconnu, vient le questionnement sur ce qu’il faut faire pour lutter contre ce mal.
Les juifs doivent avoir leur place dans cette société. Comme les indigènes, les musulmans, les Noirs. Et comme les Blancs. Tout le monde doit avoir sa place ! Toutes ces questions sont intimement liées au rapport Nord-Sud : il n’y a pas de racisme à l’intérieur s’il n’y a pas d’impérialisme.
Votre pensée bouscule à l’intérieur de la France. Comment est-elle potentiellement perturbatrice dans la question des rapports Nord-Sud ?
Nous sommes moins perturbateurs sur les questions de l’anti-impérialisme que sur les questions internes. Parce que d’une part il existe traditionnellement une gauche anti-impérialiste et internationaliste et que d’autre part, l’anti-impérialisme a tellement reculé que tout le monde s’en fout.
Par exemple, cette année en Algérie, a-t-on vu la gauche soutenir le Hirak ? Walou, rien ! Un an de mobilisation incroyable, rien. Je trouve extraordinaire que toute la gauche ne mette pas toutes ses forces pour soutenir les Algériens, les Marocains au Rif, les Soudanais et autres peuples du Sud. J’ai participé aux manifestations dans les rues de Paris, il n’y avait que des Algériens.
Mais les Algériens ont-ils besoin de ce soutien de la gauche française ?
Bien sûr. L’extrême gauche doit faire son devoir : Macron agit contre l’intérêt du peuple algérien, il soutient la « Françalgérie ». Quand en France on manifeste, ce n’est pas pour donner des leçons aux Algériens mais contre ce que fait Macron. C’est ça la solidarité effective.
Concernant l’impérialisme, le sionisme reste un tabou car s’y mêlent la bonne conscience occidentale et le philosémitisme de gauche ou d’extrême gauche.
L’antisionisme est la pierre d’achoppement ?
Oui.
Tenir cette position vis-à-vis de la Palestine ne vous est pas pardonné ?
C’est pire que ça : ils n’arrivent pas à trouver dans notre positionnement quelque chose qui ait, de près ou de loin, un rapport avec l’antisémitisme. Ce qui ne nous est pas pardonné est de ne pas être antisémites. Ils voudraient trouver en nous de l’antisémitisme pour valider l’équation antisionisme =antisémitisme, mais sans succès. Voyez encore en quoi la sorcière montre son utilité.
De plus, nous soutenons la résistance quand elle est musulmane et islamique alors que la gauche française ne soutient que la résistance marxiste et communiste, comme le FPLP. Nous refusons de faire ce choix. Le mouvement décolonial soutient les résistances quelles que soient leurs formes ou leurs couleurs.
Vous ne voulez pas avoir à faire de choix entre les types de résistances à soutenir en Palestine ?
Non. Tout le monde le fait. Or c’est aux Palestiniens de faire leurs choix, que ce soit le FPLP (Le Front populaire de libération de la Palestine), BDS (Boycott-Désinvestissment-Sanctions) ou le Hamas. Par contre on insiste pour dire qu’il faut soutenir la résistance islamique parce qu’en France c’est celle qui recueille le moins de soutiens. Ce n’est pas à nous de décider ici qui sont les bons et les mauvais Palestiniens.
Vous dites dans l’introduction de votre livre Les Blancs, les Juifs et nous, Vers une politique de l’amour révolutionnaire : « Car certes il y a le conflit de classe mais il y a aussi le confit de race ». Ce « aussi », nous voudrions l’interroger. Comment articulez-vous les deux ? Il vous a été reproché de mettre le conflit de race avant le conflit de classe.
Je ne peux que citer Marx : « L’esclavage direct est le pivot de notre industrialisation contemporaine autant que les machines, les crédits, etc. […] Sans esclavage il n’y a pas de coton et sans coton il n’y a pas d’industrie moderne. C’est l’esclavage qui a donné de la valeur aux colonies ; ce sont les colonies qui ont créé le commerce mondial ; c’est le commerce mondial qui est la condition sine qua non de l’industrie mécanisée à grande échelle. » (Misère de la philosophie)
Pourquoi faudrait-il mettre le conflit de classe avant ?
Dans le monde capitaliste, l’accumulation du capital a commencé par la « découverte » des Amériques, un génocide et la mise en esclavage de millions d’Africains. La race c’est quoi ? Comment extorquer la plus-value maximum par le travail forcé. On accumule du capital. C’est gratuit, avec 100% de profit. Tandis qu’avec le salariat, avec la classe, il n’y a pas de profit à 100%. Pour qu’il y ait l’émergence du prolétariat blanc, il a fallu d’abord la déshumanisation d’une partie de l’humanité. Les deux marchent ensemble. Du coup, cette question de mettre la race avant ou après la classe m’ennuie au sens littéral. La race a servi à l’émergence de l’ère industrielle. Cela fait partie de comment le capitalisme s’est développé. C’est tout.

Vous êtes un « point aveugle » pour une certaine gauche qui s’en tient à l’approche purement sociale ou « marxiste » des rapports de domination. Comment expliquez-vous qu’elle arrive à voir la question de la race aux Etats-Unis par exemple, mais pas en France ?
Ils sont aveuglés par la prééminence de la question de classe parce qu’ils considèrent que la race divise le monde ouvrier, or la race divise le monde ouvrier de fait. Le conflit d’intérêts existe à l’intérieur du monde prolétaire.
Si les syndicats ont toujours privilégié les intérêts des ouvriers blancs, c’est pour cette raison. Le marxisme fait une analyse de classe, soit. Mais le communisme réel défend qui ? D’abord les prolétaires blancs. C’est pour ça que les communistes du monde occidental, qui bénéficient le plus des rapports impérialistes, sont les plus chauvins.
Quand nos parents viennent ici, ils sont les parents pauvres de la lutte des classes. On aurait rêvé de faire légitimement partie de la classe ouvrière. Ce qu’on voudrait, c’est l’unification de la classe ouvrière. Mais pour cela, il faudrait en finir avec l’impérialisme et le chauvinisme. Sinon le conflit de race qui structure les rapports entre prolétaires perdure et empêche la construction d’un bloc historique révolutionnaire. Les cheminots maghrébins ne sont pas traités comme les cheminots blancs. Les uns sont discriminés, pas les autres. Pareil pour l’accès à l’emploi, les retraites… Pendant le Covid on a bien vu que ce sont les indigènes qui devaient aller travailler et faire le sale boulot. Alors que les couches les plus aisées étaient confinées.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre Les Blancs, les Juifs et nous ?
Parce que ! Plus sérieusement, parce que beaucoup de choses restaient à dire, peut-être plus intimes et moins directement politiques. Ensuite parce qu’il faut laisser des traces. C’est une tentative de libération du regard blanc et ce livre a constitué un jalon dans ce sens. Si j’en crois les réactions surréalistes qu’il a suscitées et qui méritent une véritable étude sociologique sur la blanchité (je lance cette idée) tellement elles ont été hystériques, je pense humblement y être arrivée.
Vous écrivez que par cette lutte on dépassera « le Noir », « le juif », « l’Arabe », « le Blanc ». Vous y prônez ainsi l’union de tous, c’est ce qui vous serait reproché au fond ?
Ce livre réhabilite l’humain, oui. Mais l’humain blanc ou blanchi est-il prêt au sacrifice qu’exige l’amour révolutionnaire ?
Votre livre a fait l’objet de vives critiques, notamment de la part de cette gauche sociale. Comment l’expliquez-vous ?
J’ai un peu honte pour eux pour la manière dont ils l’ont lu. Il n’y a aucune différence entre une recension du Monde diplomatique ou de Valeurs actuelles. Le Diplo, c’est quand même considéré comme un journalisme déontologique. Sauf pour moi.
D’autres l’ont critiqué. Dans l’émission de « Ce soir ou jamais », Thomas Guénolé a cité comme étant des affirmations de votre part ce qui était les éléments d’un raisonnement. Pourquoi êtes-vous restée silencieuse, alors que lui s’est montré très ému ?
Je ne m’y attendais pas du tout ! Les plateaux de Frédéric Taddéi sont formés autour d’un clivage ou de camps supposés. Thomas Guénolé était supposément du même camp que moi car critique de l’islamophobie. Donc j’ai été surprise. Pour autant, il est important de comprendre le contexte.
Avant l’émission, j’étais allée écouter Thomas Guénolé au Salon du livre maghrébin à l’Hôtel de Ville. Il intervenait alors dans un débat. Je le voyais comme quelqu’un de plutôt sympathique parce qu’il avait écrit des livres contre l’islamophobie. Je l’entends alors dire qu’il a refusé d’aller à la marche de la dignité car elle était « communautariste ». Je vais le voir à la fin, lui dis que je fais partie des marcheuses et lui demande s’il serait prêt à venir débattre avec nous publiquement. Il a été pris de court mais n’a pas osé refuser. Entre temps, il est invité à l’émission. Je suppose qu’il s’est dit que ce serait l’occasion ou jamais de me faire mordre la poussière et éviter la confrontation dans un débat loyal. A la télé, étant donné ma réputation sulfureuse, tu sors deux ou trois passages tronqués, tu lis un passage sans dire que le mot « tarlouzes » est entre guillemets. Bref, un procédé dégueu et lâche… Du coup, l’extrême droite a jubilé.
En France, quand on parle du racisme, les dominants et les dominés ne sont pas distingués. Ramené à vous, Manuel Valls, alors Premier ministre, a pu vous attaquer. Comment l’expliquer ?
Mettre les gens dos à dos permet de préserver l’ordre tel qu’il est. Faire la distinction revient à démontrer que ce sont eux les coupables.
Si le monde blanc prolétaire adoptait des solutions communistes, ce serait la pire chose qui pourrait arriver pour le bloc au pouvoir. Donc vite, il faut reparler du danger représenté par les musulmans et les indigénistes. Faire en sorte que ce monde blanc prolétaire se tourne vers les fachos plutôt que vers la remise en cause des rapports de classes et du capitalisme. Il faut préserver l’idée d’un danger musulman.
C’est exactement ce à quoi sert la loi « Séparatisme ». L’ébullition du prolétariat blanc doit continuer à servir les intérêts du grand capital et préserver le pacte racial. Les Gilets jaunes balancent à gauche et à droite. Or ce qui caractérise la spontanéité blanche c’est le chauvinisme. Il est alors très facile d’entraîner La France insoumise (qui résiste quand même) sur cette voie. Quand Valeurs actuelles fait des unes sur les islamistes, les bolchéviques, les indigénistes qui remettent en cause l’ordre, ça brouille toutes les cartes. Le nouveau magazine de Michel Onfray, c’est aussi ça : on parle pour les prolos, sur une base ultra chauvine, raciste, contre les musulmans. Onfray est-il à ce point contre le gouvernement ? Est-il un opposant ? C’est une blague !
Comment le PIR a-t-il accueilli les Gilets jaunes ? Comment vous êtes-vous positionnés ?
Au moment où presque toute la gauche exprime une méfiance, parce qu’ils seraient homophobes, racistes, etc j’ai été parmi les premiers à les soutenir. Voici ce que j’écrivais le 19 novembre sur ma page Facebook : « Les grandes âmes reprochent aux gilets jaunes de ne pas être un mouvement pur, à savoir il porte en lui le sexisme, l’homophobie et le racisme. Ok mais il est impossible qu’un mouvement spontané émanant d’une société sexiste, raciste et homophobe, et principalement composé de blancs des classes moyennes et basses, moyennement politisées (car exclues des espaces de politisation) y échappe. Il n’en n’est pas moins légitime pour exiger sa part de dignité. Ceux qui font mine de découvrir les « tares » du peuple et de s’en offusquer soit sont des naïfs, soit de faux naïfs dont le seul objectif est de nuire à cette mobilisation. Si on a une perspective révolutionnaire, il serait plus intelligent d’accompagner ce mouvement et de le radicaliser positivement plutôt que de lui cracher dessus.
Et que ce soit clair : je suis la première à m’inquiéter du racisme qu’il peut charrier. A bon entendeur. »
Par contre, toujours selon notre tradition qui consiste d’abord à défendre l’intérêt indigène, nous avons estimé que c’est le rôle de la gauche blanche de les soutenir sur le terrain. De faire ce travail parce malgré tout la cible des Gilets jaunes c’était clairement l’Etat. Si ce mouvement, réprimé par la police, est d’accord pour converger contre le racisme, tant mieux : on ira alors tous dans la même direction.
Ce qu’on appelle « la pensée indigéniste » n’est-elle pas utile dans le sens où elle fait oublier la question sociale et met la question raciale en avant ? Cela permet d’évacuer les questions sociales urgentes et d’agiter ce que vous ne dites pas. Autrement dit, avez-vous réhabilité, malgré vous, l’approche raciale des rapports humains ?
Avant nous, ces questions existaient déjà. Ce n’est pas avec nous qu’a été inventé « l’ennemi islamiste ». Ensuite, si on se dit que si tout ce que nous faisons sera instrumentalisé, rien ne se fera. Va-t-on attendre que la gauche se réforme toute seule ? Elle ne le fera pas. Il nous a bien fallu nous imposer dans le débat. Le risque était que l’émergence de la question indigène serve l’extrême droite. Mais c’est un passage obligé. Nous sommes dans un étau : soit on se laisse écraser sans résister ni lutter et on perd fatalement, soit on se bouge et ça fait bouger tout le champ politique, la gauche et l’extrême droite. Et il y a une petite chance de gagner.
Evidemment, cela se transforme en course de vitesse entre le pôle blanc révolutionnaire allié aux indigènes (ce que nous appelons la majorité décoloniale) et le pôle suprémaciste blanc. La question est : qui ira le plus vite ? Plus vite la gauche intégrera ces questions, plus vite on marchera tous ensemble contre les autres. L’extrême droite a les médias, le pouvoir avec elle. Face à cette puissance, on est mal partis.
Mais ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on a fait évoluer les rapports de force. Aujourd’hui, ces questions sont au centre.
Pour répondre à la question « Font-ils diversion avec ces questions ? » : nos questions sont prioritaires et sociales. Les violences policières, les discriminations, sont des questions sociales, posées sous le versant racial, qui affectent les gens dans leur quotidien.
Donc, dans un tour de passe-passe, ceux qui vous accusent de vous focaliser sur la race auraient projeté leur obsession identitaire sur vous ?
Oui. Mais nous n’avons pas de marge de manœuvre. Et ne sommes pas seuls sous le feu : le CCIF, la Brigade anti-négrophobie, Maboula Soumahoro, Rokhaya Diallo, Françoise Vergès…
Il pourrait aussi vous être reproché une forme d’idéalisme qui ferait qu’à une prétendue « férocité blanche » s’opposerait une innocence indigène naturelle, ontologique ?
Je ne dis pas qu’il y a une ontologie de la férocité chez les Blancs. Ils sont les produits de leur histoire. Et je ne dis pas qu’il y a une innocence indigène. Je ne pense les humains que dans les rapports sociaux et politiques. S’il fallait penser à ce qu’étaient les humains avant la colonisation en Afrique ou dans le monde arabe, j’imagine très bien des traditions de guerre ou des conflits féroces, qui heurteraient notre sensibilité aujourd’hui. Il ne s’agit pas de dire que l’inhumanité est blanche, mais que l’inhumanité moderne est essentiellement provoquée par la blanchité.
Mais l’histoire précoloniale ne m’intéresse pas. Je m’intéresse à ce qui produit l’ensauvagement d’aujourd’hui. Aux systèmes de pouvoirs actuels. Dans ce contexte, ce ne sont pas les damnés de la terre ou les indigènes qui portent la responsabilité de la marche du monde : on est des victimes. Pour autant, les victimes peuvent être des salopards. Prenons un exemple : on ne dit pas que les indigènes ne sont pas des violeurs, qu’il faut défendre les hommes indigènes quand ils violent. On demande que les hommes blancs et indigènes soient traités de la même manière face à leur crime. C’est quand même très différent. On ne les défend pas en tant que criminels, mais en tant que sujets discriminés.
D’où votre positionnement concernant Tariq Ramadan ?
Oui et les hommes tués par des policiers. Il y en a 400 ou 500 depuis les années 80. Je crois qu’il faut savoir défendre des coupables, des pas beaux, des pas finis. Il faut d’autant plus le faire que le système raciste institue l’innocence blanche. C’est ça qu’il faut casser.
A titre personnel, comment vous vivez tout ça ? Comment cela pèse sur vous ?
La pire chose c’est d’être prisonnière des Blancs, de leur idéologie. Dans mon livre j’écris « mon corps ne m’appartient pas ». Tant que j’étais sommée de dire « mon corps m’appartient », comme tout le monde parce que ce serait une évidence, j’étais prisonnière des femmes blanches et du féminisme blanc. Cette phrase est tellement sacrée que je me devais de la vénérer. Quand je m’en libère, je respire, c’est tout. Ma fierté c’est d’avoir, sinon libéré les miens, de m’être libérée seule, avec mes mots.
Ils me détestent parce que je ne leur appartiens plus, que je ne leur appartiendrai jamais et je leur ai fait savoir. Et j’étais prête à briser des amitiés pour ça. J’ai cassé toutes les serrures de ma prison. Si j’ai l’air d’être un monstre, tant pis. Mais je suis fière d’avoir entendu des femmes indigènes au Mexique venues m’écouter me dire en toute sororité : « Nous disons aussi que notre corps ne nous appartient pas, il appartient à notre communauté ».
Quand je dis que j’appartiens à ma race, je dis que j’appartiens à ma mère, à mon père, à ma grand-mère, à l’islam. Ca a été interprété comme : elle dit appartenir au patriarcat de ses origines. C’est dingue non ? Pourtant je cite ma mère et ma grand-mère !
Alors que la volonté coloniale de nous obliger à nous émanciper de nos communautés c’est de fait nous livrer au capitalisme, à l’individualisme, à la modernité…
Mais n’est-il pas possible de se libérer de l’autre appartenance, familiale, raciale, de n’appartenir à personne. Juste à soi ?
J’appartiens à ceux à qui on veut m’arracher. C’est une question de conflictualité : si ce n’était pas l’arabité et la famille maghrébine qui étaient ciblées, je ne ressentirais même pas le besoin de revendiquer ces appartenances. Maintenant, s’appartenir à soi, je trouve que ça ne veut absolument rien dire et ça revient à la même chose que mon corps m’appartient. C’est un mot d’ordre libéral. En société, on appartient toujours aux autres. La question est : comment faire pour que cette appartenance ne t’étouffe pas. A part l’idée d’un monde juste et équilibré, libéré de la modernité qui est toute à la fois capitaliste et organisée autour d’une matrice raciste et hétérosexiste, je ne vois pas comment répondre à cette question. Maintenant, je veux bien dire de manière grandiloquente : j’appartiens à l’humanité car il n’y a qu’une seule race. Je rêve même de le dire au risque de passer pour la Paulo Coelho de l’antiracisme mais je ne le ferai qu’à condition d’abolir la race, car dans la vraie vie, il y a l’humanité qui mérite de vivre et celle qui ne le mérite pas et dont la dignité est constamment bafouée.
Cette humanité est-elle celle là même que vous souhaitez réinventer avec « l’amour révolutionnaire » ?
Oui. La marche de la dignité, toutes ces femmes en accord avec elles-mêmes et avec leur histoire, en accord avec leurs hommes morts ou vivants, en accord avec leurs ancêtres et tous ces Blancs venus nous rejoindre. C’était une esquisse de ce que pourrait être l’amour révolutionnaire.
Sur [Ehko], l’information est en accès gratuit mais notre travail a un coût.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustrations : Houria Bouteldja au « Bandung du Nord » (2018) et avec Angela Davis. Droits réservés.