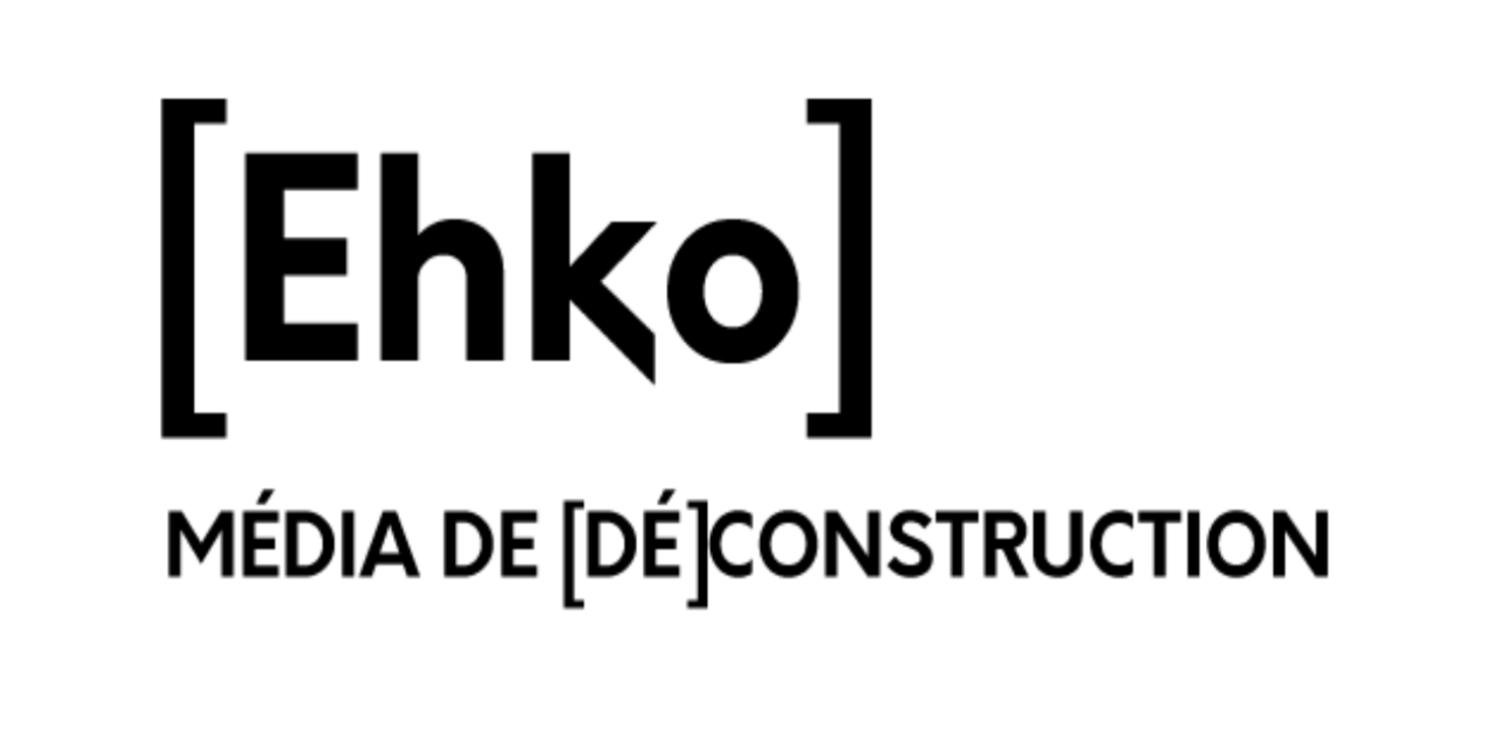Maboula Soumahoro, docteure en civilisations du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire/africaine, vient de publier son premier livre Le Triangle et l’Hexagone. Réflexions sur une identité noire (La Découverte). A travers l’exploration de l’histoire des Noir.e.s, c’est son histoire et celle de son pays natal, la France, qu’elle a mises au jour. [Ehko] l’a rencontrée.
[Ehko] : Quel est votre parcours ?
[Maboula Soumahoro] : Je suis née dans le 13e arrondissement de Paris à la fin des années 70. Mes parents étaient arrivés de Côte d’Ivoire à la fin des années 60 pour étudier et travailler. J’ai grandi en France avec mes 6 frères et sœurs et j’ai fini par voyager aux États-Unis.
A quel âge et pourquoi êtes-vous allée aux États-Unis ?
La première fois à 15 ans, pour des vacances. J’en rêvais depuis toujours ! J’avais grandi dans les années 80, sous l’impérialisme culturel des États-Unis. A la toute fin de la guerre froide, il y avait le bloc communiste et le monde soi-disant libre… J’avais de la famille là-bas, on n’avait pas d’argent mais j’arrivais à me payer mes billets d’avion. Puis j’ai commencé des études d’anglais à la fac et je me suis dit « Autant étudier l’anglais aux États-Unis plutôt qu’à Créteil ». Je suis partie 6 mois environ puis je me suis dit qu’après la maîtrise, je partirais un an. Ce que j’ai fait en 1999. J’étais à la City University of New York et pendant 10 ans, j’ai fait pas mal d’allers-retours, en fonction des visas. En 2009, j’ai obtenu un poste de maîtresse de conférences à Tours, je me suis alors réinstallée en France.
Quel poste occupez-vous actuellement ?
Je suis maîtresse de conférences, ça signifie que je suis enseignante-chercheuse et professeure titulaire à l’université. J’ai obtenu cette certification après la soutenance de ma thèse de doctorat.
Pour être précise, je suis docteure en civilisations du monde anglophone mais être docteure ne permet pas d’être maître de conférences : une fois que l’on passe le doctorat, on doit constituer un dossier et le présenter au Conseil National des Universités (CNU) qui donne cette certification, qui permet de candidater à des postes ouverts de maître de conférences à travers la France sur une période de quatre ans. Une fois que l’on obtient la certification, sur la base du doctorat, du rapport de thèse, du CV, des publications, des interventions lors de colloques, on m’avait dit qu’il y avait tout de même 30% de risque de rejet… On a alors quatre ans pour trouver un poste et si on n’en trouve pas, on est obligé de soumettre de nouveau une candidature pour maintenir le statut de maître de conférence, ce qui signifie que la recherche doit avoir continué. Généralement, quand on est docteur – en tous cas dans les lettres, les langues, etc – on nous encourage à passer des concours de l’enseignement pour être en poste dans le secondaire si on les obtient, tout en continuant à rêver du Graal de l’université.
A la fin de ma thèse, j’ai passé le Capes, sachant que d’un point de vue légal, je n’avais pas besoin d’être titulaire du Capes ou de l’Agrégation pour devenir maître de conférences, mais pour être recrutée, il vaut mieux être au moins certifiée, agrégée.
J’ai eu le Capes et la thèse en même temps et j’ai eu la chance d’obtenir un poste la première année. Le paradoxe c’est qu’il a fallu que je démissionne du corps des professeurs certifiés pour devenir maîtresse de conférences, apparemment ça posait un problème administratif, ils n’avaient jamais vu ça.
Aujourd’hui j’ai un poste dans une fac que j’envisageais alors que je ne voulais pas me déplacer n’importe où, j’ai ce privilège.
Pourquoi avez-vous préféré l’Université de Tours ? Quels étaient vos sujets de mémoire et de thèse ?
J’ai commencé mes études d’anglais à l’Université Paris XII de Créteil parce qu’ayant grandi au Kremlin-Bicêtre, j’ai été affectée à la fac de banlieue. Mais mon premier choix c’était Paris III Sorbonne-Nouvelle parce que c’était la Sorbonne… On m’avait dit que c’était le meilleur département d’anglais de France, l’anglais était ma passion et j’avais eu 18 au Bac dans cette matière à l’écrit et à l’oral. J’ai cru que j’allais pouvoir y aller par la grande porte parce que j’avais les capacités, sauf que, administrativement, je dépendais du Val-de-Marne. L’ironie c’est que le Kremlin-Bicêtre est à 5 stations de Censier-Daubenton où se situe la Sorbonne et Créteil à 1 heure en transports ! Je suis allée à Créteil assez déçue, en me disant que c’était dégueulasse, loin, une fac de banlieue alors que je voulais une fac prestigieuse… Finalement, je m’y suis fait et les facs de banlieue sont souvent plus ouvertes intellectuellement, moins classiques que les parisiennes. J’y ai passé 4 ans.
Une professeure qui m’avait remarquée dès la première année m’a proposé de venir avec elle quand elle a été mutée à Paris VII, pour mon DEA après ma maîtrise. Ça m’arrangeait. A partir de la maîtrise, je me suis spécialisée en études afro-américaines.
Pourquoi les études afro-américaines ?
Parce que c’étaient des Noirs des États-Unis, des Noirs cools, valorisés. J’ai grandi avec de l’admiration pour l’histoire et la culture afro-américaines. Au départ, c’était juste de l’intérêt parce que j’étais Noire mais aussi parce qu’ils n’avaient pas mon histoire, c’est comme s’ils représentaient ce que je voulais être. Il y avait aussi quand même le rapport à l’Afrique. Quand j’ai travaillé sur le Liberia dès la maîtrise, c’était pour me retrouver un peu dans cette histoire : qui sont ces Afro-américains qui ont rêvé d’Afrique, qui ont rêvé de repartir et qu’est-ce que cela veut dire de revenir une fois qu’on est partis – quelles que soient les conditions ? Mes parents étaient venus de Côte d’Ivoire et j’avais un rapport ambigu avec le pays : je n’y suis pas allée pendant une longue période, je ne savais pas vraiment quoi faire de cet héritage, d’autant qu’il n’est pas valorisé en France. On est Africains, d’un milieu très traditionnel, et ça, ce n’est pas à la mode.
Vous n’envisagiez pas d’étudier le parcours de Noirs auxquels vous pouviez davantage vous identifier ?
Ça n’existait même pas. Il y avait soit des études africaines et je ne voulais pas les suivre même si j’ai pris quelques cours d’histoire africaine en option, mais au départ, les Noirs de France n’existent pas, même en tant qu’objet d’études. On parle d’immigration, de nos parents, mais parler de nous, c’est une évolution intellectuelle assez récente.
A quoi est-ce dû ? Est-ce lié au travail de Pap Ndiaye qui a publié La condition noire ?
Les travaux de Pap Ndiaye datent de 2008. Cet exemple est intéressant car il est également passé par les Etats-Unis et a étudié les Américains. On est toute une génération à avoir ce parcours – Audrey Celestine, Sarah Fila-Bakabadio – plein de personnes noires ou métisses travaillent sur le sujet et ont fait ce détour pour finalement revenir en France hexagonale. Il m’a fallu ce détour intellectuel, physique et géographique avant de me pencher sur moi-même mais en France, pas en Côte d’Ivoire. J’ai vraiment grandi.
Le fait qu’en français on utilise le terme anglais « Black » illustre exactement le fait qu’on n’existe pas.
J’ai l’impression que c’est une façon de nous dire, nous les Noirs de France, sans nous dire. On n’a même pas accès à la langue française pour nous décrire. Noirs et Blancs peuvent utiliser ce terme. C’est comme s’il y avait en France hexagonale un ancrage particulier. Si les gens voient « les migrants » dans la rue, ou des personnes africaines en boubou, ils ne diront pas « Black » mais « un Africain », « un réfugié », « un Antillais ». C’est comme s’il n’y avait pas de mot pour nous dire et se définir comme Noirs et « Noirs de France », c’est plus récent. Si quelqu’un voit ma mère dans la rue, il ne dira pas « J’ai vu une Black » mais « J’ai vu une mama africaine ». Il y a une différence entre ma mère et moi, au niveau vestimentaire, de l’ancrage, de la citoyenneté et il n’y a pas de mot pour nous décrire. J’ai l’impression qu’on s’est appuyé sur un terme qui renvoie à une invisibilité.
Moi-même j’ai grandi dans une génération pour qui il était question de retourner en Côte d’Ivoire et finalement, j’ai 43 ans et je suis toujours là. Même ma mère est encore là. Le seul pays où j’ai passé plus de temps qu’en France ce sont les États-Unis, pas la Côte d’Ivoire. Que fait-on de tout ça ? Quand j’ai commencé mes études, je ne le voyais pas.
Comment vous perceviez-vous alors ? Cet environnement ne vous permettait pas de vous projeter en tant que Noire ? Il n’y avait pas de représentation à laquelle vous identifier ?
J’étais Africaine, Dioula, un groupe ethnique d’Afrique de l’Ouest, musulmane mais ça n’avait pas de rapport avec la France. Je me voyais Noire, mais je ne me voyais pas en tant que Française. Quand j’ai commencé à aller aux États-Unis et qu’on m’a demandé d’où je venais, j’ai fini par dire « Je suis Française » parce que ça ne servait à rien de dire que je suis Ivoirienne, on m’aurait demandé « D’où ? » et je n’y suis allée que trois fois dans ma vie.
Au départ, la France c’était à la fois chez moi et pas chez moi, notamment parce que ce n’était pas le pays de mes parents. Mais ma famille et mes amis sont en France et quand j’économise pour rentrer une fois par an au pays, c’est en France… C’est ça la réalité et ça a été une découverte.
A quel moment avez-vous été consciente que vous étiez Noire, « différente », en France ?
Très tôt, quand on m’a traitée de « Sale Noire » à l’école. Et je m’appelle Maboula Soumahoro. Tout me place à l’extérieur. Mais dans ma famille, à la maison, il n’y avait pas de honte, ni de complexe. En revanche, dehors, la France était exotique, c’était autre chose, pas pareil que chez moi. On ne mangeait pas de la même façon, on ne s’habillait pas de la même façon.
La France était exotique
Vous évoquez le rapport à la langue avec l’anglais, il n’y avait pas ce prestige autour de la langue (ou des langues) de votre famille ?
Non, bien au contraire. La langue dioula, je la comprends un peu mais ne la parle pas. Je n’ai pas de langue maternelle en fait et je ne la pratique pas du tout.
Le français est-il votre langue maternelle ?
Oui, sauf que la France n’est pas ma mère. Ça m’a obsédée pendant l’écriture du livre.
Comment et pourquoi avez-vous commencé l’écriture de votre livre Le Triangle et l’Hexagone ?
J’ai commencé en 2013. Ça fait longtemps que je le travaille. J’ai fait des présentations au Royaume-Uni et aux États-Unis et il y a 2-3 ans, quand j’étais dans le Vermont, j’ai commencé à écrire. La Découverte m’a contactée et je n’arrivais pas à écrire en français pourtant j’avais envie de trouver ma voix en français. Je ne parle pas la langue de ma mère (qui parle aussi français) et je parle une langue qui n’est pas celle de ma mère. Il y a un fossé culturel, que se dirait-on si on pouvait parler la même langue ?
J’ai été formée intellectuellement en anglais sur les questions raciales avec des théories qui n’existaient pas ou très peu en langue française. Plein de choses me viennent naturellement en anglais. Ça renvoie aussi à l’impossibilité en langue française et depuis la France contemporaine à dire ces choses.
J’ai rencontré mon mentor aux États-Unis, un Nigérian, en 1999. Je l’intéressais parce qu’il n’avait jamais vu une Noire de France, donc il trouvait que j’étais fascinante. Il me demandait « Tu penses que tu es Française ? » Ce à quoi je répondais : « Oui ». Il m’a demandé pourquoi je ne parlais pas le dioula, m’a suggéré de l’apprendre – j’ai étudié beaucoup de langues, latin, grec, russe, allemand – mais le dioula ne rentre pas. Je peux l’apprendre, de manière froide et distanciée, mais il me manquera l’affect, est-ce que ce sera ma langue maternelle ? Je suis en paix avec moi-même, dans la nostalgie de la perte de ma langue maternelle que j’aurais voulu apprendre de ma mère. Mes parents ne me l’ont pas apprise, par conformisme notamment, mais aussi parce qu’on devait rentrer au pays avec une éducation à la française, c’est ça le prestige, il y a eu une appropriation du discours dominant. Petite, j’avais honte de cette langue et aujourd’hui, c’est un grand regret.
Vous vous considériez alors comme Française, sans réfléchir à ce que ça impliquait et sans affect ?
Oui, de fait je suis Française, je suis également Ivoirienne par mes parents, et je n’y mettais pas d’affect. J’en ai rien à faire d’être Française, l’amour pour la France ou pour toutes les patries, c’est pas mon truc. Je n’ai pas le cœur qui bat quand je vois le drapeau bleu-blanc-rouge, je ne donnerais pas ma vie pour la France.
Je ne supporte que les drapeaux des petites nations, des petits pays qui ont gagné contre les grands, celui d’Haïti par exemple.
Pouvez-vous nous parler de votre thèse ?
Ma thèse, qui a été une grande bataille (et sera publiée), s’intitule « La couleur de Dieu, regards croisés sur la Nation d’Islam et le mouvement Rastafari (1930-1950) ». J’écoutais et écoute beaucoup de rap et de reggae, m’intéressait à Malcolm X et je me suis demandé quelles étaient leurs histoires. Je voulais étudier, être prof à la fac, il fallait que je choisisse le sujet passionnément pour allier l’utile à l’agréable.
Comment le sujet a-t-il été accueilli à l’université ?
Très mal. C’était hors de question. « Ce n’est pas un sujet scientifique » ou « valable ». « Il faut changer de cursus, faire de l’ethnologie ou de l’anthropologie pour parler des Rastas »… Toute cette hostilité m’a fait me demander : à part le fait que ça parle de Noirs et que je sois Noire moi-même, quel est le problème ? Nous étions en 1999 – année charnière pour moi – et j’étais déjà aux États-Unis. J’avais soutenu ma maîtrise en juin et en septembre j’étais à New York, j’y ai suivi plein de cours sur les Noirs, enseignés par des Noirs et j’ai vu qu’il y avait un champ de recherches riche avec des gens pointus, des pontes. Je n’avais jamais vu ça en France, à part avec un prof africain à Créteil qui proposait une option sur l’histoire africaine mais il faisait un peu dépassé… J’avais l’impression que c’était un de mes tontons ou un intellectuel des années 50 qui parle un français très châtié, donc pas à la mode… A New York ils étaient plus jeunes, plus cools. Le prof nigérian était plus jeune, il était venu aux États-Unis pour ses études à Columbia, ces gens me faisaient rêver et c’était nouveau.
J’ai aussi rencontré Édouard Glissant à New York sans savoir qui c’était. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, j’avais entendu son nom, celui d’Aimé Césaire et là je les découvrais et ça me faisait penser à mes amis « immigrés » – les Martiniquais sont censés être Français mais font partie des immigrés – qui ne comptaient pas alors qu’il y a toute cette littérature, tous ces écrits !
Ça dit quelque chose de ce qui est enseigné en France ? Ça a ouvert vos horizons ?
Oui, ça dit tout.
J’ai pris un cours de culture de la Caraïbe et c’est là que j’ai lu Maryse Condé pour la première fois et le premier livre que j’ai lu portait sur la civilisation du bossale, j’ai lu La Rue Case-nègres de Joseph Zobel, j’avais vu le film quand j’étais petite mais là je lisais le livre… Même mon nom « Soumahoro » était perçu différemment. Le prof qui avait fait l’appel lors du premier cours m’avait demandé d’où je venais, si je connaissais l’histoire de ma famille, de l’empire du Mali. C’est un nom répandu, ma mère m’avait raconté cette histoire et il m’a répondu « Non ce ne sont pas des histoires, c’est une Histoire ! » Je n’avais pas accordé d’attention à des histoires entendues dix fois et là je me disais « Je peux faire une thèse sur moi-même ! On a de la valeur. »
Ma mère ne voulait pas que j’aille à New York car je m’éloignais encore plus de l’Afrique mais c’est ce qui m’a donné envie d’y revenir et de m’intéresser à notre culture.
Pourquoi ne perceviez-vous pas cette valeur quand vous étiez en France ? C’était du rejet intériorisé découlant du mépris environnant ?
Je me conformais complètement au discours dominant français selon lequel on est de la merde. Ma mère ne s’est jamais dit qu’elle n’avait pas de valeur. Elle parlait dioula, avait ses activités culturelles, je voyais les tontons et les tatas se saper, faire des mariages, des enterrements, des lectures de Coran, mais pour nous, c’était différent. Je dis que la France était exotique pour moi car dehors il se passait des choses que je ne connaissais pas. Un jour j’ai mangé du chou-fleur à la cantine et je ne savais pas ce que c’était, pareil pour le goûter avec du Nutella. Ce n’était pas notre vie. Ce qui est différent devient attirant et n’a jamais rien à voir avec toi et ton intimité, c’est comme si tout ce qui était dehors était mieux. En plus on était pauvres…
C’est comme si je rêvais d’être Blanche en fait. On rêve d’être Blanc car c’est mieux.
Vous aviez quelle représentation des Noir.e.s quand vous étiez plus jeune à part les Américains ? Celle des auteurs ? Celle liée à l’Histoire ? Lilian Thuram disait, quand il est arrivé en France hexagonale, que la première représentation était celle des esclaves et ce fut un choc pour lui.
Quand j’étais petite, il y avait des Africains et des Antillais. L’esclavage n’était pas mon histoire. Nous on a plus cette histoire dans les silences, des histoires de disparitions, je me demande aujourd’hui si ce n’étaient pas des gens qui ont été kidnappés.
Mon père a étudié en France, avec des étudiants africains, mais je n’ai pas grandi avec lui.
Cela signifie que les Noir.e.s n’existaient pas ?
En tous cas, je les ai rarement croisés. Au CM1, un prof que j’adorais m’a fait me lever pendant un cours sur la traite négrière. Je pense que ça venait d’une bonne intention « Regardez les lèvres lippues, le dos cambré, la couleur de la peau, à un moment dans l’histoire Maboula aurait été esclave »… Ça a été mon premier contact direct avec cette histoire. Comme quoi les bonnes intentions…
Je n’ai pas été vexée, au contraire, j’étais plutôt fière qu’il m’ait demandé de venir devant la classe et puis je pensais alors que ça ne me concernait pas.
Une de mes grandes sœurs, qui a suivi des études de lettres spécialisées à La Sorbonne, est devenue un de mes premières modèles intellectuels. Elle m’emmenait avec elle, on allait acheter des livres, elle me parlait de littérature africaine ou noire-américaine. Je me souviens de ses sujets de mémoire.
On était à la fin des années 80, début des années 90. Il y avait le film « Malcolm X », j’ai lu son autobiographie, un des premiers livres que j’ai lus en anglais.
Je ne me souviens pas d’avoir vu des cultures noires mises en avant et valorisées par des Blancs Français. On me disait « Tu es Ivoirienne, je connais bien la Côte d’Ivoire » ou un autre pays africain, c’était censé être valorisant mais on me parlait toujours de choses qui n’étaient pas moi. Il y avait encore un effacement. En tant que petite fille, je gérais encore ma honte, je n’étais pas vraiment Ivoirienne, il y avait toujours un malaise. On me disait « C’est dans ton pays qu’on fait ça ». Je ne savais pas. Pour moi, c’était de la non-existence constante. Tu n’existes pas, on ne te connaît pas.
On plaquait sur vous des stéréotypes ?
Oui. On avait fait un concours de beauté avec trois copines blondes aux yeux bleus. On avait moins de 10 ans. Résultats : « Karen est la plus belle, puis Stéphanie, puis Emmanuelle mais toi Maboula on ne te classe pas parce que comme tu es Noire, on sait pas ». J’ai répondu « C’est vrai ». Elles ne m’ont pas dit que j’étais moche mais j’ai compris que j’étais exclue de la beauté car je n’étais pas blanche, blonde, aux yeux bleus.
La France et Paris notamment ont été un refuge pour les Noirs américains au temps de la ségrégation aux États-Unis, pour par exemple Joséphine Baker ou l’écrivain James Baldwin. Les Américains ont-il conscience de la situation des Français noirs aujourd’hui ?
Ça dépend des générations. Des Noirs américains sont venus en France et ont été mieux traités que dans leur pays d’origine. Il y a eu des communautés intellectuelles et artistiques depuis la fin du 19e siècle. J’ai de nombreux collègues noirs américains qui viennent encore à Saint-Germain-des-Prés, Montparnasse, mangent du fromage, boivent du vin, apprécient leurs amis Blancs Français qui ne sont pas comme les Blancs des États-Unis. Ils ont pu faire carrière ici et, parfois, n’ont rien à faire du traitement des Français noirs. C’est dommage.
L’écrivain Ta-Nehisi Coates est conscient du prestige qu’il a en France, qui n’a rien à voir avec le traitement des Noirs de France. Il a par exemple demandé pour ses interviews des journalistes non-Blancs, Noirs, Arabes, etc. Il a une quarantaine d’années et c’est plutôt nouveau.
Cela se passe donc à une période où des individus noirs sont exposés dans des « zoos coloniaux » en France, comment expliquer que les Noirs américains soient mieux traités que les Noirs en/de France ?
Ce sont des Américains. Quand on parle des Etats-Unis, il faut vraiment penser à la Première et à la Seconde guerre mondiale, quand les Etats-Unis arrivent en puissance sur la scène internationale. Ils en ont bénéficié.
Lors de la Première Guerre mondiale, les soldats sont ségrégués dans l’armée américaine mais bien reçus par les Français. Ils parlent anglais, mâchent du chewing-gum, sont associés au jazz, au sport ; ce sont des Noirs évolués, civilisés, pas des sauvages d’Afrique. Ce ne sont pas les mêmes Noirs. On peut voir leur beauté, mais ancrée dans le respect de la civilisation, parce qu’ils sont Américains.
On peut faire le parallèle avec les dits « Tirailleurs » africains de l’armée française ?
Exactement. La question est : « Tu es le Noir de qui ? »
Puisque vous êtes Française, les Américains ne s’attendent à ce que vous vous positionniez sur les problématiques américaines, en tous cas pas directement, à ce que vous demandiez des comptes ?
Aux États-Unis, en tant que Noire Française – pas Noire Ivoirienne – je peux être mieux traitée qu’une Noire Américaine car je bénéficie du raffinement français, de l’intellectualisme français, de la sophistication française. Je ne suis pas la Noire de l’embrouille, de ceux qui sont arrivés en 1619 dans le territoire qui allait devenir les États-Unis et qui pourraient faire peur, au contraire, ils peuvent aussi se servir de moi en disant « Je connais une Noire Française »…
Par le simple fait d’enseigner dans des départements d’études afro-américaines, de la diaspora, je bénéficie de luttes menées par d’autres. J’ai peut-être même pris le poste d’un Afro-américain… Des professeurs du continent européen ou de la Caraïbe notamment anglophone obtiennent des postes que les Américains n’auraient pas. On oublie par exemple que Colin Powell, avec toute sa carrière politique et dans l’armée, est d’origine jamaïcaine. On croit qu’il est Américain mais ce n’est pas le cas, et ça compte. Toute une bourgeoisie noire, non-Américaine, a joué le jeu du « Nous on n’est pas Afro-Américains, on est d’autres Noirs ».
Ça été le cas pour Barack Obama, avec le parcours de son père, Kenyan venu étudier aux Etats-Unis ?
Oui, sauf que Barack Obama marche en tandem avec sa femme. Elle est de Chicago, c’est la caution noire ancrée, Afro-Américaine, du terroir. Ils ont capitalisé sur ça. Au niveau du recensement, il se déclare « Afro-Américain », pas « Métis ».
Mais elle aurait pu être vindicative sur les droits civiques, Michelle Robinson-Obama étant issue d’une famille réduite à l’esclavage ?
Elle a été très décriée, caricaturée mais ils ont tout de même gagné. Les Obama sont très modérés au niveau politique.
Les Noirs américains sont sur-représentés en tant que victimes des violences policières. Sont-ils conscients que c’est également le cas des Noirs en France ?
Les plus jeunes, oui. « Black Lives Matter » a des branches en France. Ils essaient de créer un mouvement international.
Depuis des décennies, on dispose de chiffres sur les discriminations au logement, à l’emploi, sur les violences policières en France… Au regard de vos travaux, comment expliquez-vous que la question de la race, qui semble primordiale, reste taboue ? Le mot « race » a été retiré de la Constitution et le sujet a été évacué, l’argument (du président Hollande notamment) étant que la France ne reconnaît pas « les races », mais insidieusement cela n’invisibilise-t-il pas aussi le racisme ?
Premièrement, c’est du délire. Deuxièmement, ça nous renvoie au fait que la race et le racisme servent à quelque chose, les deux structurent les sociétés – en France ou ailleurs.
Ce fonctionnement raciste sert à organiser, à dominer, à hiérarchiser des individus et les communautés au sein des sociétés.
On dit souvent que le racisme n’est pas juste une question d’être gentil ou méchant, ça conditionne la place dans la société, le niveau de vie, le salaire. Bien sûr qu’il n’y a aucun intérêt à reconnaître son fonctionnement, sinon ce serait la révolution : on questionnerait toute cette hiérarchisation et ça aboutirait à la redistribution des richesses, or les personnes qui bénéficient du système n’ont aucun intérêt à ce que tout cela soit remis en cause – à part si la valeur commune est celle de la justice. Des gens perdraient mais une autre façon de voir les choses est que tous les êtres humains gagneraient. Cette dimension idéaliste n’existe pas.
La République française s’est aussi construite sur la hiérarchisation des races. C’est sur cette idée que la France a fondé son empire, qu’elle a colonisé. Les « thèses » d’Arthur de Gobineau sur la supériorité de la race blanche ont été reprises dans des livres scolaires jusque récemment. C’est donc central. Pensez-vous que ce sujet pourra être abordé en France, sereinement ?
La question raciale structure tout. Le coup de baguette magique c’est la géographie, la division entre la France hexagonale et les territoires dits d’Outre-mer. C’est facile d’évacuer cette histoire puisqu’il y a une sorte de centralité de l’hexagone.
Même si les décisions politiques ont été prises dans cet Hexagone ? Quelles y ont eu un impact ? Que le pouvoir politique, des entreprises et des individus tirent profit jusqu’à présent de l’entreprise coloniale ?
Les bénéfices sont invisibles car la présence des corps n’était pas là. L’esclavage était interdit dans l’Hexagone. C’est facile de se dire « C’était ailleurs », « C’était il y a longtemps », « C’était loin ». Il est impossible d’agir de la sorte aux États-Unis. C’est d’ailleurs ce qui explique la guerre de Sécession.
Cela explique qu’il ne soit pas admis de dire que l’immigration et la « diversité » de la population française tant décriée sont aussi le résultat de cette histoire ? La France pouvait coloniser sur tous les continents sans conséquence sur l’Hexagone ?
Exactement. Le Triangle et l’Hexagone parle de ça : la France n’a pas conscience de son histoire hors de l’Hexagone.
Donc cela justifie que le récit tienne ? Peut-il encore tenir longtemps ?
Oui, mais il n’est pas possible qu’il tienne encore car on est trop présents. Tous ces gens du Triangle sont en France hexagonale, les corps sont là, de manière plus massive qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire, les mémoires aussi. La présence est établie et personne ne va partir.
Ce Triangle que vous citez dans le titre de votre livre, c’est celui qui désigne le commerce triangulaire, entre Nantes, Bordeaux et des pays d’Afrique notamment ?
Oui. Au début, les éditions La Découverte étaient réticentes, pensant que le titre ne serait pas compris et justement, c’est le problème. La France s’inscrit dans cette histoire de l’Afrique et des Amériques. J’aurais pu aussi parler de l’Océan Indien. Le Bumidom a fait déplacer des personnes de ces territoires vers l’Hexagone.
En vérité, s’il ne s’agissait pas de race, comment se fait-il que des gens de la Guadeloupe puissent être traités comme des gens de la Côte d’Ivoire alors que techniquement, ils sont citoyens français depuis 1848 ? Qu’est-ce qui justifie le même traitement ? La peau. Quand on voit un Noir dans la rue, on ne sait pas s’il est Antillais, Africain, s’il est citoyen ou pas donc qu’est-ce qui parle ? Nos corps. C’est ça la race. Je pense qu’il y a une dénégation – pas un déni – car l’ensemble de la population sait très bien que le sujet existe, que la race ce n’est pas nouveau. Par exemple les statistiques ethniques – qu’on ne veut pas appeler raciales – sont interdites en France, mais pas en Nouvelle-Calédonie.
La maîtresse de conférences Mame Fatou Niang a récemment tweeté sur le préfet Bolotte et les événements de Mé 67 en Guadeloupe. Plusieurs personnes l’ont reprise, sûres d’elles, en croyant la corriger en parlant de Mai 68… Quelle arrogance ! De toute évidence, ces personnes ne connaissent pas cette histoire. C’est cela qui est affligeant : on ne regarde pas l’histoire de la même façon, ni du même angle.
Pierre Bolotte a pourtant été préfet en Algérie durant la colonisation française, a pensé et mis en place une politique de répression qu’il a ensuite appliquée en Hexagone – avec la BAC notamment – et dans les dits territoires d’Outre-Mer. Tout cela n’est pas connu et il n’y a pas volonté de connaître ?
Non. Cela me fait penser à l’unité de police SWAT aux États-Unis, pensée dans le cadre des émeutes de Watts à Los Angeles en 1965. Ca commence toujours à la marge, dans la périphérie, le test c’est toujours dans les Outre-mers puis ça arrive dans le mainstream et tout le monde pleure, se demande ce qu’il se passe, dénonce les violences policières parce qu’un homme est blessé à Paris intra-muros… Quand ça se passait en banlieues de n’importe quelle ville, tout le monde s’en foutait. Mais ce qui sera testé, et de manière hyper violente et brutale sur les populations qui ne comptent pas, va à un moment affecter les populations qui comptent…
Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, donne l’exemple d’un officier de l’armée française en Algérie qui vient le voir car il est stressé, nerveux, frappe sa femme et ses enfants, Fanon réfléchit et énonce : « Vous pensez que vous allez torturer des gens toute la journée et qu’après tout ira bien chez vous ? Non, cette violence va tout contaminer. Il est certain que ça va déborder. » Si la répression de Mé 67 et celle de 2005 dans les banlieues est possible, vous pensez qu’il va se passer quoi en Mai 68 à Paris et en 2018 [Ndlr. Manifestations contre la Loi Travail] ou en 2020 [Ndlr. Manifestations contre la réforme des retraites] ?
C’est la même chose aux États-Unis. Des Américains blancs pleurent depuis l’élection de Donald Trump or des gens ont rappelé le sort réservé aux Indiens d’Amérique à Standing Rocks, les violences policières subies par les minorités depuis des décennies… Pour « les Cinq de Central Park », Donald Trump, qui était l’une des personnalités new-yorkaises les plus influentes, a acheté des encarts publicitaires pour demander la peine de mort contre ces jeunes hommes noirs et latinos accusés à tort d’agression et de violence sur une femme blanche en 1989. Les Noirs rappellent donc « Trump, on le connaît depuis ce moment, depuis longtemps donc. Vous n’avez rien dit, c’était normal alors que nous, nous savions qu’il était capable de ça. Maintenant c’est votre président. Cette montée de violence vous ne la comprenez que lorsqu’elle vous affecte. »
Pourquoi les Américains blancs se plaignent-ils de Trump ?
Ils se demandent ce qu’il se passe, comment ils ont pu élire un tel homme. Les femmes blanches qui ont organisé des manifestations ne comprenaient pas qu’il n’y ait pas de femmes noires avec elles, ce à quoi les femmes noires répondaient « On a voté à 94% pour Hillary Clinton, notre travail on l’a fait. Et vous ? » Elles disent « Ce n’est pas quand la lutte vous intéresse qu’on doit se joindre à vous. On a déjà lutté mais vous n’en n’aviez rien à faire. Donc maintenant, débrouillez-vous. Notre combat on le mène au quotidien. »
Revenons-en à la France. Comment expliquer la petite place donnée aux études post-coloniales, compte tenu de l’histoire coloniale française ?
Pour faire du post-colonial il faut déjà bien gérer le colonial.
Cette non-reconnaissance va de pair avec cette dénégation – j’insiste, ce n’est pas du déni, ils savent mais n’acceptent pas. On sait que le Franc CFA existe en Afrique de l’Ouest, on peut dire qu’il ne sert à rien, mais s’il n’apporte rien à la France, pourquoi garder cette monnaie ? On peut dire à chaque révolte dans les « territoires d’Outre-Mer » qu’ils coûtent plus que ce qu’ils ne rapportent, que la France n’en a rien à faire d’eux, qu’elle est prête à leur donner leur indépendance, alors pourquoi elle ne la donne pas ? A quoi servent ces territoires ? Notamment à accroître la puissance maritime de la France, deuxième voire première mondiale, non pas grâce à l’Hexagone mais à l’Atlantique, au Pacifique…
Cette dénégation nous renvoie à cette impossibilité à dire, à sonder – pas politiquement seulement – maîtriser, comprendre, enseigner, poser des questions complexes sur le fait colonial.
Si on ne fait pas ça, je ne vois pas comment intellectuellement on peut envisager le post-colonial. Dire que tout s’était arrêté en 1960/1962, c’est aussi ridicule que de dire que tout allait bien pour les descendants d’esclaves en 1849, un an après l’abolition, ça n’a pas de sens. Ou pour un couple une semaine après son divorce.
N’est-ce pas aussi par peur d’avoir des professeurs « issus de l’immigration post-coloniale » ? On constate le manque de diversité dans le monde universitaire, le fait que seule la parole d’une certaine catégorie d’universitaires soit admise. Vous n’êtes sans doute pas au niveau auquel votre CV vous permettrait de prétendre et des oppositions comme celles autour des positions de Gérard Noiriel illustrent ces positionnements sur la prétendue « neutralité »…
Oui et le problème est là. Il va y avoir des études post-coloniales en France, sur les Noirs, la diaspora, parce qu’il n’y a pas le choix mais ce ne sont pas nous, les non-Blancs, qui auront ces postes. Je l’accepte. Je vois très bien ce qu’il se passe en terme de développement au sein de l’université, seuls quelques collègues m’invitent, des jeunes générations – mais ce ne sont pas eux qui ont les postes. J’ai vu fin novembre la création d’un grand réseau de 100 chercheurs issus de 8 universités françaises qui vont travailler sur la question du racisme. Ils refusent les termes de « race » et d’« islamophobie ». Je ne sais pas qui sont ces chercheurs mais moi, je n’ai pas été contactée. Ce n’est pas de l’ego trip, je sais juste qu’on n’aura pas ces postes-là. Ils seront obligés de se lancer sur ces sujets, c’est la marche du monde, mais cela ne veut pas dire qu’ils mettront des corps différents, parce que le corps n’est pas censé compter, parce que n’importe qui est censé pouvoir travailler sur ces thématiques.
Je ne dis pas qu’il faille être Noir pour étudier les Noirs mais je dis qu’il est hors de question qu’il faille ne pas être Noir pour étudier les Noirs. On nous accuse de ne pas avoir de distance, de neutralité alors que c’est aussi ridicule que d’envisager qu’un mouvement féministe intellectuel et la production liée aux femmes n’ait pas émané de femmes et que seuls des hommes puissent l’alimenter. Cette comparaison est flagrante. Comme celle du passage sous silence du rôle des esclaves quand on étudie les histoires abolitionnistes. C’est un parti-pris facile de parler de Victor Schoelcher en France, des Britanniques qui ont fait tout un débat parlementaire pour l’abolition, et assez tôt par rapport aux autres nations, sans mentionner les révoltes des esclaves. Je revendique ma non-neutralité.
Je ne suis pas neutre et je ne crois pas en l’objectivité et je veux juste qu’ils reconnaissent leur non-neutralité, ils ne sont pas neutres.
Aux États-Unis, ce sont des profils comme les miens qui intéressent depuis les révoltes de 2005. Nous apportons un regard nouveau sur la France. Des personnes ont envoyé des lettres m’accusant de « racisme anti-blanc » pour y faire annuler l’une de mes interventions. D’autres envoient à mon université des lettres de menace. J’ai porté plainte contre une personne qui a tweeté que mon CV était faux. Un jour, à la fac de Tours, une personne m’a demandé si j’étais femme de ménage… Cela ne poserait pas de problème que je sois femme de ménage, que je ne veuille rien d’autre.
Parlez-nous du « Black History Month » en France dont vous êtes à l’origine, qui vise à faire connaître l’histoire des personnes noires
Après avoir été invitée en 2009 ou 2010 par une association qui s’appelait CAPDiv (Cercle d’action pour la promotion de la diversité), nous avons créé en 2013 notre propre association qui a attiré beaucoup d’attention, mais d’autres initiatives existent et c’est très bien.
Chaque année on me demande pourquoi « Black History Month » ? Je réponds « Parce que c’est White History Life every day » (Nldr. L’histoire blanche est à l’honneur tous les jours). C’est ce que les Blancs ne comprennent pas : à un moment ils sont dans un privilège tel, dans une puissance telle, une domination telle, qu’elle en devient invisible et c’est ça le privilège ultime.
On vit dans un monde structuré autour des Blancs mais aussi des hommes, de la validité physique ou mentale. Ceux qui ne comprennent pas la question raciale, qui ne comprennent pas qu’elle se voit, comprennent mieux avec ces parallèles. Pourtant quand on arrive dans un endroit, généralement, plus c’est riche, plus c’est Blanc, mieux c’est.
Envisageriez-vous de faire des whiteness studies, études de la blanchité, en France ?
C’est devenu à la mode mais j’ai déjà fait ça dans les années 2000… C’est très bien, ça bouge mais de nombreuses choses qui se passent actuellement en France sont pour moi des répétitions.
Toute chose produite doit donc être acceptée, on a si peu de contenus et on est si contents de les avoir qu’on n’est pas encore au stade de la critique comme on pourrait le faire pour n’importe quel objet d’étude scientifique. Ici, on est toujours en retard.
Un dernier mot ?
C’est dur, on sait que ce sera toujours dur, mais on va y arriver.
Lire aussi : Le Triangle, l’Hexagone et les réflexions sur l’identité de Maboula Soumahoro
Crédit photo : Patricia Khan.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.