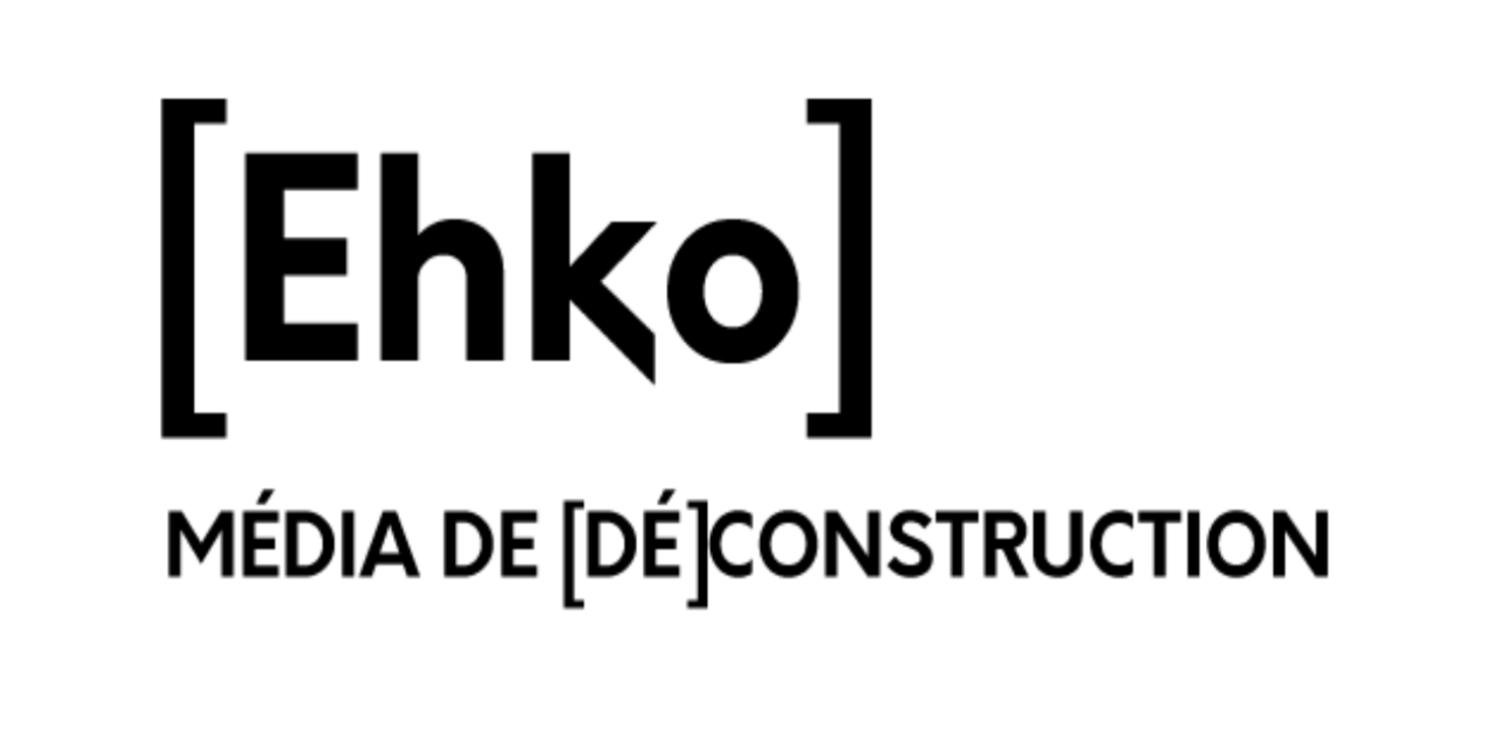Comme il existe un greenwashing ou un pinkwashing, existe-t-il ce que [Ehko] a choisi d’appeler un « femowashing » ? Autrement dit, à l’instar des techniques de communication d’une entreprise ou d’une entité politique fondées sur un souci de l’environnement ou une attitude bienveillante vis-à-vis des personnes LGBTQ, le « femowashing » permet-il de modifier son image et sa réputation dans un sens prétendument féministe ? Au-delà, sert-il à masquer des enjeux politiques qui vont précisément à l’encontre de l’intérêt des femmes ?
[La question se pose] alors que l’Arabie saoudite vient de nommer une femme au poste d’ambassadrice auprès des États-Unis. C’est la première femme que Riyad nomme à un tel poste. Et il ne s’agit pas de n’importe quelle femme, puisque la nouvelle ambassadrice est la princesse Reema Bent Bandar ben Sultan, 44 ans. Jusqu’à présent, elle faisait partie de l’Autorité sportive générale saoudienne qui s’emploie à promouvoir les femmes dans le sport dans le royaume. Elle avait également travaillé dans le secteur privé, en tant que PDG de Harvey Nichols Riyad et cofondatrice de Yibreen, société de spas à Riyad.
La princesse Reema remplacera le prince Khalid Ben Salman, fils du roi Salman et frère cadet du prince héritier Mohamed Ben Salman dit MBS. Dans une valse de nominations, il vient d’être désigné vice-ministre de la Défense, aux côtés de son aîné, lequel dirige déjà le ministère.
La nouvelle ambassadrice est aussi (et peut-être surtout) la fille du prince Bandar Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, figure de proue de la diplomatie saoudienne et qui a été lui-même ambassadeur du royaume aux États-Unis de 1983 à 2005. Il était réputé si proche de la famille Bush, père, fils et fratrie, qu’il a pu être surnommé « Bandar Bush ». La princesse Reema a ainsi passé de nombreuses années à Washington, alors que son père était ambassadeur. Elle y a obtenu un diplôme en études muséales à l’Université George Washington.
Son père, quand il était ambassadeur, avait pour obsession affichée l’Iran. Tout son travail diplomatique pouvait se lire comme la volonté d’endiguer les ambitions des desseins et ambitions régionaux chiites. A l’époque de l’accord sur le nucléaire iranien, Bandar Ben Sultan avait écrit que « ce nouvel accord fera des ravages » au Moyen-Orient, région qu’il estimait « déjà déstabilisée par les actions iraniennes ». Toute la question est de savoir si sa fille a été nommée précisément pour tenir le même fil diplomatique.
Décidée par décret royal, cette nomination intervient au milieu des relations refroidies entre l’Arabie saoudite et les États-Unis. Cette turbulence relative est la conséquence du meurtre par des agents saoudiens à Istanbul en octobre dernier du dissident saoudien Jamal Khashoggi, opposant à MBS et journaliste du Washington Post. La nomination de la princesse Reema à Washington vise sans doute aussi à tourner la page de ces tensions après l’assassinat de cet opposant devenu visiblement trop gênant en raison des diatribes enflammées publiées dans le très influent Washington Post.
Si le président Donald Trump a soutenu MBS contre vents médiatiques et marées politiques, le Sénat américain a toutefois adopté deux résolutions. La première a confirmé que le prince avait autorisé l’assassinat de Khashoggi et la seconde a appelé à la fin du soutien américain à la guerre contre le Yémen.
L’autre but de la nomination d’une femme jeune et « moderne », selon tous les stéréotypes actuels, est sans doute de coller au storytelling coûteux que le royaume a peu à peu construit autour de MBS, présenté comme le « prince réformateur ». Ou plutôt de recoller les morceaux et lambeaux d’une narration patiemment construite par de prestigieux cabinets de relations publiques autour d’initiatives de Mohamed Ben Salman : réforme d’une économie trop dépendante de l’exportation des hydrocarbures, droit de conduire accordé aux femmes ou encore ouverture de lieux de divertissement. Un ripolinage en règle tandis que l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition de divers pays arabes, menait et mène encore une intervention militaire humainement désastreuse au Yémen.
« Cherchez la femme »
Ce que l’Arabie saoudite de MBS semble avoir parfaitement compris de l’Occident est l’importance des relations publiques. De l’image. De la narration aussi. D’où l’importance, pour le royaume, des relations publiques, lesquelles ne sont ni plus ni moins que la version policée (et capitalistique) de la bonne vieille propagande.
Le SAPRAC ou le Saudi American Public Relation Affairs Committee a été précisément créé en mars 2016 dans ce but : « Améliore[r] la réputation et développe[r] des messages qui influencent les influenceurs » pour « chaque aspect de la dynamique saoudienne américaine ». Dès la page de garde du site de l’organisation basée à Washington (« à quelques minutes de la Maison Blanche » comme s’en vante la page de présentation), seules trois femmes souriantes apparaissent, deux d’entre elles voilées mais visages découverts entourant la troisième, non voilée. A l’instar du American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), le SAPRAC affiche l’objectif « de diffuser du contenu et des messages en collaborant avec les médias américains. Des informations authentiques, mises à jour et documentées concernant l’Arabie saoudite seront fournies à tous ces organes de presse afin de les aider à accéder facilement aux informations, aux opinions et aux retours d’information sur les affaires courantes des deux pays ».
L’Arabie saoudite a aussi conclu des contrats de plusieurs millions de dollars avec les plus influentes sociétés de publicité institutionnelle afin de contrer la presse négative dont il fait souvent l’objet. Il suffit de se rappeler la vaste opération de relations publiques « royalement » orchestrée qu’a été la tournée aux États-Unis de Mohamed Ben Salman, à laquelle a succédé rapidement un voyage inaugural au Royaume-Uni en mars 2018. Cette tournée s’était accompagnée d’une campagne de presse écrite ainsi que d’une campagne d’affichage dans les rues londoniennes, affirmant que MBS « apporte un changement en Arabie saoudite », complétées par des hashtags tels que #ANewSaudiArabia et #WelcomeSaudiCrownPrince.
Mais derrière cette façade de communication qui met en avant une femme, issue du sérail clanique au pouvoir, la réalité du sort réservé aux Saoudiennes est autrement plus sombre. En novembre 2018, Amnesty International faisait état dans un rapport que « Plusieurs militants saoudiens, dont des femmes, détenus de manière arbitraire sans inculpation depuis le mois de mai à la prison de Dhahban, en Arabie saoudite, auraient subi des actes de harcèlement sexuel, de torture et d’autres formes de mauvais traitements lors des interrogatoires ». Le rapport indique que plusieurs militants ont été arrêtés de manière arbitraire lors de la répression du mois de mai, dont des femmes qui défendent les droits humains, et qu’ils sont détenus sans inculpation et sans assistance juridique. Ils ont été détenus au secret et placés à l’isolement pendant les trois premiers mois. Il s’agit des militantes des droits des femmes Nouf Abdulaziz et Mayaa Al Zahran, et de militants déjà persécutés pour leur travail en faveur des droits humains par le passé, comme Mohammed Al Bajadi et Khalid Al Omeir, ainsi que de Hatoon Al Fassi, militante des droits des femmes et universitaire de renom, qui aurait été brièvement détenue après la levée de l’interdiction faite aux femmes de conduire. Hatoon Al Fassi a d’ailleurs reçu en novembre 2018 le prix Academic Freedom de l’Association des études sur le Moyen-Orient, qui lui a été décerné en son absence lors de la réunion annuelle de l’association.
C’est exactement ce genre de féminisme porté en bandoulière afin de satisfaire un Occident peu regardant sur le reste qui a permis à la Tunisie de Ben Ali de se « vendre » longtemps comme progressiste. Quand bien même la société était figée de peur face à l’Etat policier créé par l’ancien président tunisien. C’est ce même « femowashing » qu’a tenté aussi l’Egypte d’Al Sissi. Durant les élections législatives de 2015, des mesures avaient été prises pour que les femmes, les jeunes, les chrétiens et les personnes handicapées soient représentés à la faveur de quotas imposés pour une législature de cinq ans. Des femmes furent même nommées gouverneures. Pourtant c’est dans ce même pays que des femmes ont été la cible des pires traitements, avec le soutien appuyé du royaume à ce régime. Des « test de virginité » furent systématiquement pratiqués sur des Soeurs musulmanes lors de leur arrestation. Elles étaient de fait violées.
Ce « femowashing » revêt aussi d’autres aspects. Plus belliqueux. Celui par exemple des guerres prédatrices menées au nom de la défense des femmes. Qu’elles soient Afghanes, Irakiennes, Syriennes, Libyennes, peut-être bientôt Iraniennes. Mouvement aléatoire et cause civilisationnelle qui ont semblé épouser parfaitement le déploiement de l’imperium américain. Or, étonnement ou pas, il n’y a pas encore eu de guerre menée pour la défense de « la femme palestinienne » ou celle de « la femme saoudienne ».
Souvenez-vous, par exemple, c’est au nom de ce femowashing que Nicolas Sarkozy, alors président, avait justifié le maintien de troupes françaises sur le sol afghan à coup de « c’est un pays où l’on coupe les doigts des femmes parce qu’elles ont du vernis à ongles ». Un mensonge pourtant, ou plutôt une entreprise de communication, construit par les officines de relations publiques afin de mieux « vendre » la guerre contre l’Afghanistan. Au final, le corps des femmes utilisés comme un argument de vente, que ce soit pour un détergent, une soupe en brique ou une guerre civilisationnelle et prédatrice.
Sam Gardiner, ancien colonel américain, a ainsi démontré dans une étude que la guerre contre l’Afghanistan lancée en octobre 2001 avait été précédée par la construction d’une mécanique de propagande redoutablement efficace. Dès novembre 2001, fut créé le Centre d’information de la coalition de la Maison-Blanche qui élabora un plan cynique visant à convaincre que la guerre contre l’Afghanistan se ferait pour « le sort des femmes afghanes ». Sam Gardiner estime que la campagne s’est construite autour « d’une histoire qu’ils ont créée […]. Ce n’était pas un programme avec des étapes spécifiques ou un financement destiné à améliorer la condition des femmes » note-t-il. La coordination de cette propagande entre Washington et Londres a même impliqué les épouses des dirigeants américain et britannique. Le 17 novembre 2001, Laura Bush déclarait que « Seuls les terroristes et les talibans menacent de couper les ongles des femmes pour avoir porté du vernis à ongles ». Trois jours plus tard, Cherie Blair disait aux médias londoniens : « En Afghanistan, si vous portez du vernis à ongles, vous risquez de vous faire arracher les ongles ».
Pourtant, selon une étude de la Brown University publiée en octobre dernier, les guerres menées contre l’Afghanistan puis contre l’Irak en 2003 ont eu des conséquences catastrophiques pour les femmes de ces deux pays. Elles restent ainsi exclues du pouvoir et connaissent des taux de chômage ou de pauvreté élevés. L’Irak est ainsi devenu le pays au « 1 million de veuves ». Le « femowashing », ripolinage en règle d’enjeux bien prosaïques, vernis hypocrite de dynamiques en rien soucieuses des femmes, se révèle être un féroce «femobashing». Une façon de nier ou d’aggraver la condition des femmes tout en prétendant agir pour leur « bien ». Rien de nouveau sous le soleil.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.