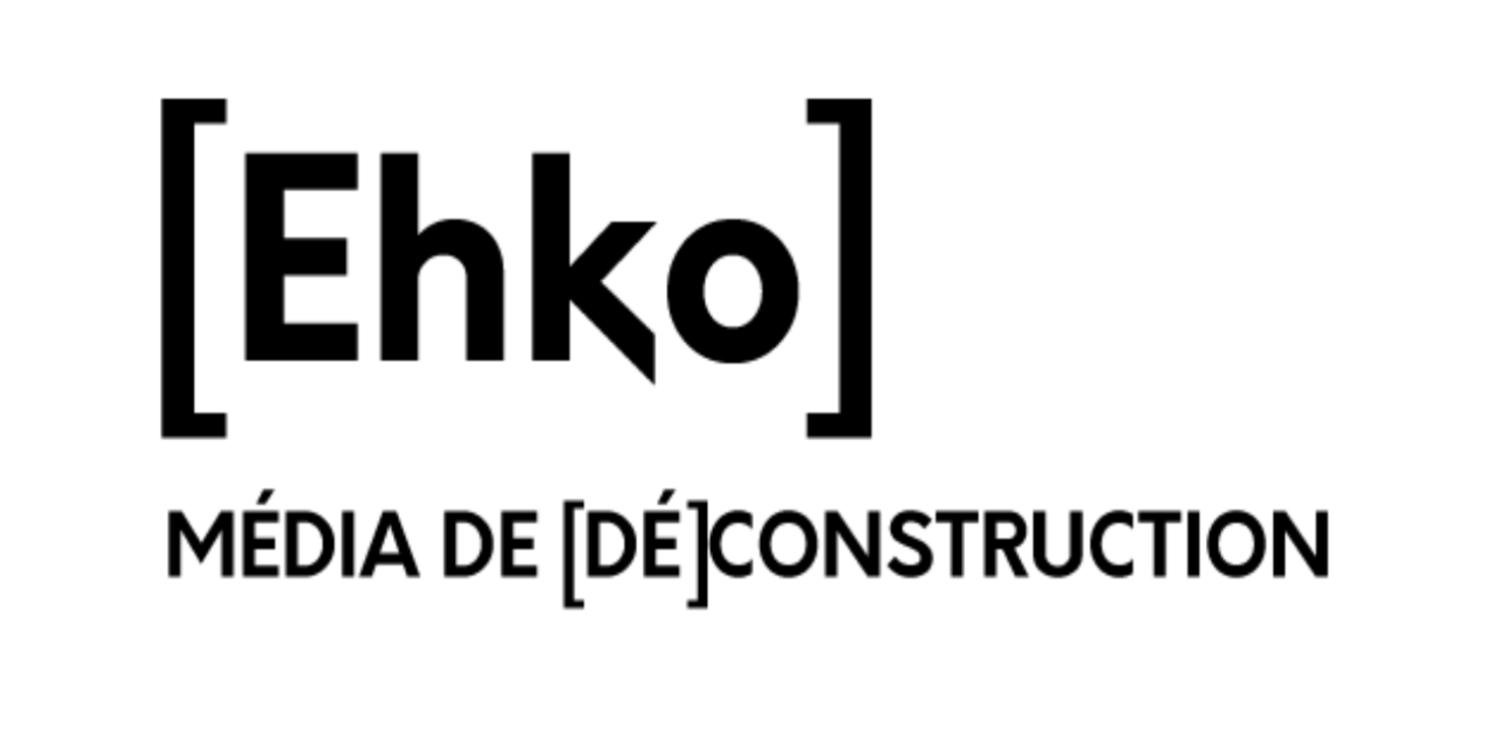Connaissez-vous les évènements de décembre 1960 en Algérie ? Souvent oubliés, voire délibérément occultés, ils constituent pourtant un point nodal de ce qui était encore qualifié aveuglément d’ « évènements » ou « troubles ». Dans un livre et un documentaire, Mathieu Rigouste revient sur cette période.
[« Un seul héros le peuple »]… Le titre du nouveau livre de Mathieu Rigouste, qui est aussi celui de son documentaire à venir, l’affirme sans ambages. L’intelligence et l’autonomie politique des peuples constituent une dynamique historique indépassable. Après une enquête dense et documentée de sept ans, l’auteur retrace ce point de bascule au cours duquel le « peuple algérien » s’est saisi de son devenir. En cela, il rend au mot évènement son sens inaugural, entendu comme rupture d’une trajectoire rectiligne et qui ouvre alors vers le surgissement historique. Sous-titré « La contre-insurrection mise en échec par les soulèvements algériens de décembre 1960 » le livre du chercheur en sociologie rend aussi une forme d’hommage à un peuple nié alors dans son existence nationale singulière, sa dynamique politique autonome et sa force émancipatrice déliée. Dans une mise en perspective tout à la fois historique, historiographique, politique et sociologique, Mathieu Rigouste retrace d’abord, jour par jour, la lente montée des faits qui ont mené aux évènements de décembre 1960. Contre la coulée brutale du colonialisme, il reconstitue les barrages réels et symboliques dressés par la résistance obstinée des dites « masses » algériennes. Il trace et piste aussi une généalogie des pratiques sécuritaires, créant un lien avec un actuel très pesant fait de tentations autoritaires, violences policières, contrôle de l’espace public et ordre capitalistique martial. Un présent qui en devient dès lors moins inéluctable au regard de cette histoire redécouverte. Une histoire qui peut (et doit) se lire en devenir possible.
Dans un livre qui associe rigueur universitaire et souffle narratif, l’auteur distingue les strates des parcours personnels, les trames de petits riens et de petites gens qui, à force de détermination et courage, ont ébranlé la machine coloniale. Plutôt que la naissance hagiographique d’une nation, Mathieu Rigouste a reconstitué la naissance d’un peuple.
Le livre est sorti dans l’indépendante maison d’éditions Premiers matins de Novembre. Un documentaire est en voie de finalisation. Un site de financement participatif est disponible ici.
Entretien.
En quoi ce qui s’est passé en décembre 1960 a-t-il constitué une rupture dans la guerre d’Algérie et pour le pouvoir colonial ? En quoi est-il singulier par exemple par rapport aux autres soulèvements, de 1954 ou de 1945 pour ne citer que les plus célébrés ?
Les soulèvements de décembre 1960 arrivent à un moment de la guerre de libération où le Front de libération national (FLN) et l’Armée de libération nationale (ALN) ont été profondément démantelés par la contre-insurrection à l’intérieur du territoire. L’Etat français tente alors d’en profiter pour installer un premier projet néocolonial. Alors que l’extrême droite coloniale appuyée par plusieurs régiments tente un putsch, les classes populaires sortent en masse et s’opposent puis se maintiennent dans les rues pour exiger leur libération, pendant près de trois semaines. C’est la première fois dans l’histoire de la guerre de libération mais aussi de l’Algérie sous domination française. C’est une rupture de tous les codes de l’ordre colonial : sortir des ghettos et braver les frontières des quartiers interdits, porter les drapeaux de l’indépendance, chanter et danser mais aussi s’affronter avec les colons, avec la police et avec l’armée. Et dans plusieurs villes, à plusieurs occasions, les colonisé.e.s ont débordé les appareils répressifs et se sont approprié ces rues et ces quartiers.
Comment avez-vous travaillé ? En enquêtes populaires ou archéologie testimoniale que vous revendiquez ? Selon quelles sources, algériennes ou françaises ?
Au long de mes recherches sur la généalogie coloniale du système sécuritaire, j’avais entendu parler de « ce soulèvement », car généralement on parle d’un seul soulèvement, celui du 11 décembre à Alger. Mais très peu de travaux sur ce sujet existaient, à part quelques références éparpillées ici et là dans des livres sur la guerre d’Algérie. J’ai commencé des recherches préparatoires, entre entretiens et archives. J’ai dégagé plusieurs terrains de recherches. Côté archives, les dossiers militaires au service historique de l’armée de terre, ceux des Sections administratives spécialisées (SAS) aux archives nationales de l’outre-mer (ANOM) et la presse de l’époque. Tout cela a permis de voir comment a fonctionné la contre-insurrection d’alors et également comment ont réagi les appareils répressifs de l’époque face à ce soulèvement.
Vous donnez la parole à des témoins de l’époque. Comment les avez-vous retrouvés et amenés à vous parler ?
Parallèlement, j’ai fait des entretiens préparatoires avec des témoins de l’époque. J’ai pris conscience qu’il y avait un tissu d’histoires cachées, du point de vue du massacre qui avait eu lieu alors, mais également du point de vue de l’engagement des classes populaires. Il y avait urgence à les faire témoigner, ne serait-ce qu’en raison de leur âge. Il s’agissait aussi de recueillir cette parole qui n’avait pas été entendue. J’ai compilé ces sources dans une forme d’investigation croisée et je les ai traitées avec les outils du matérialisme critique en sciences sociales. J’ai appliqué ces méthodologies aux appareils de domination pour comprendre comment ceux-ci fonctionnaient. En revanche, c’est plutôt un rapport de coopération que j’ai essayé d’établir avec les témoins. Il s’agissait là de récolter leur parole pour pouvoir la diffuser mais également de penser avec eux, de réfléchir et mener l’enquête ensemble. J’ai assumé ma tendresse pour le sujet, mes contradictions personnelles et la politisation de mon regard sur la séquence. J’ai révélé les conditions de production de ma recherche. Les témoins m’ont emmené là où ils vivaient et là où ils avaient manifesté, ils m’ont transmis la géographie des rapports de pouvoir de l’époque, nous avons cheminé à nouveau, ensemble, le long des interstices où leurs résistances se sont engouffrées. On croisait alors d’autres personnes qui amenaient d’autres témoignages. Cela a régulièrement créé des situations d’échanges entre toutes les générations réunies pour se mêler à nos conversations. C’est une « enquête populaire » aussi de ce point de vue, elle a été menée avec les sujets de l’histoire.
Comment avez-vous veillé à éviter une romantisation a posteriori de ces évènements, voire à un « messianisme » du peuple algérien (ce qui fut reproché à Frantz Fanon, comme vous le rappelez) ?
Je crois que j’ai d’abord été fasciné par ces événements car ils sont fascinants. Il s’y enchevêtre une multiplicité d’histoires bouleversantes. Cela pouvait m’empêcher d’être critique à l’égard de certains témoignages ou de certaines mises en récits des événements. Mais je crois que personne n’est neutre face à son sujet de recherche, encore moins quand il s’agit de situations sociales et historiques. J’ai tenté de croiser rigoureusement des sources pertinentes, crédibles et indépendantes. Je les ai analysées avec les outils du matérialisme critique, c’est-à-dire en observant les rapports de domination, les rapports de force et les rapports de pouvoir, en cartographiant des mécanismes et leurs dysfonctionnements, en interrogeant la place des personnes dans la société et dans l’histoire. Emergent des cohérences et des contradictions, de la complexité. Force est de reconnaître à quel point la notion de peuple est inopérante car homogène, uniforme, aveugle aux contradictions internes et aux rapports de pouvoir. Quant à ce « messianisme », c’est justement le contact au terrain, les témoignages des personnes, qui évitent d’y tomber. Si l’on veut bien prendre au sérieux leur analyse vécue de la situation, elles décrivent précisément la manière dont elles se sont politisées, la manière dont elles se sont organisées, elles racontent des façons d’agir spontanées et d’autres méticuleusement préparées, elles incarnent des sujets écrasés mais qui essaient, se trompent, persistent, apprennent, échangent et se transforment collectivement.
Vous qualifiez ce peuple de « prolétariat colonisé ». Pourquoi ces deux mots accolés et en quoi ils sont nécessaires pour comprendre ce soulèvement ? Qu’avait ce prolétariat de différent du prolétariat européen ?
La figure du « peuple algérien » masque ainsi des contradictions profondes entre des personnes qui étaient pour ou contre l’indépendance, des attentistes, des opportunistes, des volontaristes… Dans le mouvement indépendantiste, d’autres partis ont existé, comme le Parti communiste algérien (PCA) et le Mouvement national algérien (MNA) et à l’intérieur du FLN lui-même, se distinguaient des courants divers. Le peuple n’est pas un concept opératoire, c’est une notion qui peut inclure les classes dominantes, c’est-à-dire mettre dans la même catégorie le patron et l’ouvrier, le riche et le pauvre, le gouvernant et le gouverné. Il m’a fallu refaire aussi l’histoire de l’utilisation et du codage de cette notion de « peuple » et de ce slogan « Un seul héros le peuple », comment ils ont été utilisés et instrumentalisés à différentes époques et selon différents enjeux. Pour travailler sans ambiguïté, j’ai choisi ce terme de « prolétariat », mais pas au sens strictement marxiste ni dans son acception ouvrière. Plutôt dans son sens le plus large, comme la classe de celles et ceux qui n’ont que leur bras et leurs enfants. Les classes populaires algériennes étaient alors majoritairement paysannes. A cette catégorie de prolétariat, j’ai ajouté le terme « colonisé » pour souligner que ce n’était pas la même situation d’exploitation et de domination que celle du prolétariat considéré comme blanc en métropole, même si ce dernier a pu subir lui-aussi des régimes de férocité. La condition coloniale est particulière; elle est une conjugaison de rapports de domination capitalistes, racistes et patriarcaux qui se traduit par un système de ségrégation et de privilèges par rapports aux classes populaires considérées comme « occidentales ». La ligne de fracture coloniale oppose prolétaires blancs et indigènes dans tous les secteurs de la société impérialiste : dans le logement, la santé, l’éducation, la culture, pour l’accès aux droits, face à la police, à la justice, à la prison, à l’armée et aux administrations… Et c’est aussi sur cette ligne que s’opère l’explosion sociale et historique de décembre 1960.
Le soulèvement semble se donner pour but de remplir l’espace public de leur présence, corps et voix. Pourquoi cette forme de résistance ?
Cela dépend des endroits et des moments de cette séquence qui se déploie sur 3 semaines et 25 villes. Ces manifestations subissent avant tout une répression sanglante. Mais dans les témoignages, il y a des multiplicités de moments décrits comme des paralysies de l’ordre colonial où ces classes populaires tiennent la rue. Les cortèges ont tant de puissance qu’ils prennent les rues interdites, parfois même celles entravées par des barrages militaires. Les colonisés investissent l’espace public, leur corps en avant, avec des drapeaux algériens qui pouvaient valoir à l’époque de se faire tuer. Les personnes décrivent un sentiment de libération intense et des performances festives : on chante, danse, émet des youyous. Ces mêmes festivités qui ont caractérisé l’indépendance s’amorcent dès 60 avec une libération des corps et un renversement des rapports de force par la présence physique des Algériens dans les rues et villes interdites de décembre 60 jusqu’à 62 (Malika Rahal termine d’ailleurs une recherche de fond sur les festivités de l’indépendance). Les témoins parlent d’une joie intense, de délire ou de transe collective. Ils disent avoir senti appartenir à un corps commun. L’image de « fleuve » revient, avec l’idée de masse mais dotée d’une intelligence. J’ai essayé d’aborder cela avec l’aide des travaux de Fanon qui, déjà à l’époque, interrogeait le corps en décrivant l’enkystement de la violence coloniale dans les muscles des colonisés. Une violence qui resurgissait alors au cœur des centre-villes coloniaux, comme les colonisés l’avaient rêvé. En enquêtant auprès des témoins, on comprend comment cette libération collective a été préparée à travers diverses pratiques d’entraînement, dans les jeux des enfants, dans le scoutisme et jusque dans le football. Les Algériens et les Algériennes font exploser la situation parce que le colonialisme avait condamné toute autre possibilité de libération. Mais les formes prises par ces surgissements collectifs des corps opprimés découlent aussi de l’histoire des communautés de quartiers qui s’y sont engouffrées et de l’histoire de leurs résistances quotidiennes.
Vous écrivez également que l’émeute peut être comprise comme un langage. Quelle a été la grammaire de ces émeutes et que disaient-elles ? Est-ce là que cette masse est devenue « peuple » ou force politique ?
J’ai abordé la notion de peuple telle qu’elle est proposée par ces révolutionnaires anonymes de l’époque, non pas pour en faire un concept mais pour réfléchir à ce qui surgit à ce moment-là et à ce qui vient donner de la force et rompre tout l’ordre colonial. J’ai écouté ce que disaient les témoins au sujet du « corps commun ». J’ai été puiser chez différents théoriciens, de Nietzsche à Georges Lapassade en passant par Wilhelm Reich qui ont proposé des schémas d’analyse pour comprendre comment des énergies accumulées à l’intérieur des corps par les blessures de l’histoire peuvent s’associer pour surgir ensemble. Pour nommer le phénomène décrit par les témoignages j’ai repris la notion d’égrégore, issue de l’alchimie, qui définit une entité psychique constituée par l’enchevêtrement de toutes les énergies qui lui donnent naissance. J’ai proposé de concevoir cette figure de peuple qui a pris forme dans les rues des villes algériennes en décembre 1960 comme un phénomène de subversion des corps et des imaginaires préparés par l’histoire des résistances populaires quotidiennes.
Quel a été le rôle du FLN, des instances algériennes basées à Tunis ?
Les instances dirigeantes du FLN n’ont pas appelé à ces soulèvements, elles ne les ont pas déclenchés et ne les ont pas organisés, même si quelques-uns ont tenté de le faire croire par la suite. Une dynamique de réorganisation d’une zone autonome FLN à Alger était certes à l’œuvre mais encore loin d’aboutir en décembre. Elle n’avait pas les moyens de déclencher un tel soulèvement. Elle a cependant tenté de les encadrer, selon les quartiers. Dans d’autres villes où il y a aussi eu de grandes manifestations, le FLN était parfois complètement absent. Mais cela ne signifie pas que le FLN n’avait pas d’influence. A ce moment de la guerre de libération, le FLN est doté d’instances dirigeantes pour les commandes desquelles se battent déjà des fractions « politiques » et « militaires », « intérieures » et « extérieures ». Mais c’est bien ce sigle et celui du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) qui sont scandés et écrits sur les murs et les banderoles par les manifestants algériens. En revanche, lorsque Ferhat Abbas demande aux masses de rentrer chez elles et de laisser ce nouveau gouvernement algérien gérer l’indépendance, il n’est pas écouté. Partout on continue à manifester, dans différentes régions on commence même à sortir après cet appel à rentrer. Pour les habitants des villes, le FLN du quotidien représente souvent des militants de base complètement intégrés à la vie du quartier. Et de ce point de vue, le FLN a été une instance de formation de pratiques, d’idées et de militants indépendantistes. Il a eu une influence évidente dans l’engagement et la politisation des classes populaires. Mais il n’était pas tout seul, d’autres organisations indépendantistes ont joué un rôle dans la politisation des classes populaires et dans la conquête de l’indépendance. Cette enquête montre qu’il faut en plus considérer l’héritage d’idées et de pratiques accumulées par les résistances populaires à travers les époques ainsi qu’une dynamique autonome dans le devenir révolutionnaire du prolétariat colonisé.
Cela se passe 3 ans après la « bataille d’Alger ». Les habitants d’Alger ont-ils appris en 1960 à contourner les méthodes contre-insurrectionnelles utilisées par la France en 1957 ?
D’une certaine manière, oui. Les Algériens ont appris à survivre à la contre-insurrection durant cette prétendue « bataille d’Alger » et durant les autres campagnes de guerres policières menées partout en Algérie contre les classes populaires. L’industrie militaire a mis en scène la « bataille d’Alger » comme le modèle d’une prétendue « excellence française en contre-insurrection ». Ce massacre est devenu un argument publicitaire sur les marchés « de la défense et de la sécurité ». Mais les classes populaires algériennes ont été soumises tout au long de la colonisation à des formes de répression militarisées face auxquelles elles devaient s’organiser collectivement pour rester en vie. Toute l’histoire de la vie quotidienne des colonisés a consisté à développer des répertoires d’évitement, de ruses, et parfois de confrontation avec le pouvoir colonial.
Vous dites effectivement que décembre 60 contredit la mythologie de la contre-insurrection et son marché mondial. Comment ?
Cette mystification du récit sur la « bataille d’Alger » repose sur l’idée que l’armée française avec ce modèle de contre-insurrection appelé « doctrine de la guerre contre-révolutionnaire » aurait réussi à éliminer définitivement les organisations politico-militaires (FLN et ALN) et toute résistance du côté algérien. Mais c’est faux. Les cellules politiques en ville et les unités de guérilla dans les maquis se recomposaient très vite. Et comme le montre cette enquête ainsi que l’histoire des femmes dans la guerre d’Algérie, les résistances populaires n’ont jamais cessé. Elles ont réussi à se rendre insaisissables par la contre-insurrection et ont traversé toutes les opérations répressives, jusqu’à décembre 60 puis au-delà. Elles ont dû changer de forme après l’indépendance mais elles ont encore resurgi, sous la forme d’un peuple en marche en février 2019. Décembre 1960 rompt ce mythe selon lequel la contre-insurrection aurait cette capacité à pacifier et à maintenir l’ordre alors qu’elle consiste en réalité à déployer une forme de guerre policière contre « des populations ». La contre-insurrection a été saisie par les blocs de pouvoir et s’est répandue mondialement parce qu’elle engendre des formes de guerre dites « de basse intensité », longues et profitables pour tout un tissu d’industries et pour les classes dominantes en général.
Quelle a été la conséquence de cet événement en dehors de l’Algérie ? Le liez-vous à Octobre 61 ?
Le soulèvement d’Alger le 11 décembre 1960 a lieu devant des journalistes du monde entier. Les images qui en sortent ont une influence très forte sur les pays du Tiers Monde et même du monde occidental. Cela permet d’imposer le droit à l’auto-détermination devant l’ONU. Et comme la victoire magistrale de Dien Bien Phu quelques mois avant le déclenchement de la lutte armée en Algérie, c’est un symbole, un signe, un signal pour les peuples opprimés du monde. Décembre 60 a eu d’autres postérités en termes répressifs. Le Général de Gaulle est alors en voyage en Algérie pour promouvoir le projet néocolonial. A son retour à Paris, il est accueilli, notamment, par le préfet de police Papon, lui-même ancien préfet extraordinaire en Algérie et formé à la contre-insurrection. Ces événements le marqueront et influenceront toute sa doctrine. A l’Ecole militaire, il tient des conférences dans lesquelles il brandit la menace d’une insurrection « nord-africaine » en plein Paris, prélude, selon lui, à une « invasion soviétique » sur le sol français. Un protocole contre-insurrectionnel est conçu pour réprimer dès l’origine tout ce qui ressemblerait à une manifestation de masse « nord-africaine ». Le 17 octobre 1961, un quadrillage policier de Paris est déployé en quelques heures, avec des unités chargées de rafler et d’interner en masse, appuyées par des lieux d’internement. La répression de décembre 1960 a préparé celle d’octobre 1961 et toutes deux s’inscrivent dans la longue histoire des crimes coloniaux.
Cette histoire est-elle connue en Algérie ? Et en France ?
Cette histoire est quasiment inconnue en France car elle a été dissimulée, notamment à travers les lois d’amnistie qui ont permis à l’Etat français de s’autoamnistier et de faire disparaître la plupart de ces crimes. Je recense au moins 250 morts algériens au long de ces 3 semaines, c’est un massacre d’Etat. Il faudrait s’interroger sur sa disparition des mémoires des luttes et de la culture populaire au même titre que le 17 octobre 1961 avait disparu avant que témoins, militants et chercheurs ne coopèrent pour le faire exister dans des mémoires collectives contemporaines. En Algérie, cette histoire est plus connue, mais principalement par les anciennes générations. La jeunesse, jusqu’en février 2019 [Ndlr. Début du mouvement hirak], la connaissait assez peu. Elle en entend parler brièvement à l’école et au travers de commémorations officielles qui emportent une méfiance générale. Mais il en persistait des traces vivantes, dans les corps des témoins.
Décelez-vous une continuité de cette même dynamique dans l’Algérie post-indépendance ? Le décelez-vous dans le Hirak de 2019 ?
Au début du hirak de 2019, j’ai eu l’impression de voir se reformer ce « corps commun » qui avait été démembré. Mais il faut écouter ce qu’en disent les Algériens et les Algériennes. Ils et elles ont ressorti le slogan « Un seul héros le peuple » en le recodant à nouveau de diverses manières. Les manifestant.e.s de 2019 ont commencé à construire une mémoire collective des soulèvements de décembre 60 qui tisse des liens entre générations révolutionnaires.
Voyez-vous une continuité dans le traitement des quartiers populaires dans la France actuelle ?
A Alger en décembre 1960, les Algériens des bidonvilles et des quartiers pauvres sortent mais aussi ceux des nouveaux grands ensembles à peine construits et qui sont les prototypes de ceux qui seront construits en France dans les années suivantes. Les témoins décrivent des chasses policières aux Arabes à travers des halls et des coursives similaires à celles d’aujourd’hui dans les cités de l’Hexagone. Les habitants d’hier profitent comme ceux d’aujourd’hui de leur connaissance du terrain pour tenter d’échapper aux violences des forces de l’ordre ou se défendre. Certains se font abattre, d’autres tabasser ou torturer. Avant même l’indépendance, les policiers revenaient en métropole avec ces expériences, ces répertoires d’idées et de pratiques pour y faire la police des travailleurs immigrés. Ce sont eux qui vont encadrer les jeunes recrues et les premières brigades chargées, au début des années 70 de « faire la guerre au crime » dans les quartiers populaires français. C’est la naissance des BAC [Ndlr « Brigades anti-criminalité »]. Décembre 1960 est aussi l’une des premières scènes d’emploi de nouvelles grenades lacrymogènes et offensives sur des manifestations civiles. Il y a des mutilés par membres arrachés et des évanouissements par asphyxie qui rappellent des contextes contemporains.
On observe une continuité de pratiques et d’idées pour assurer la domination des quartiers « indigènes » aux colonies et des quartiers populaires en métropole. Mais avec des évolutions constantes. Ce ne sont pas les traces persistantes d’une époque dépassée, c’est le fonctionnement d’une colonialité qui continue de structurer en profondeur les sociétés capitalistes occidentales.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : « Un seul héros le peuple », Marc Riboud, Alger, le 2 juillet 1962.
Cet article est paru initialement sous forme moins longue sur le site Middle East Eye (édition française)