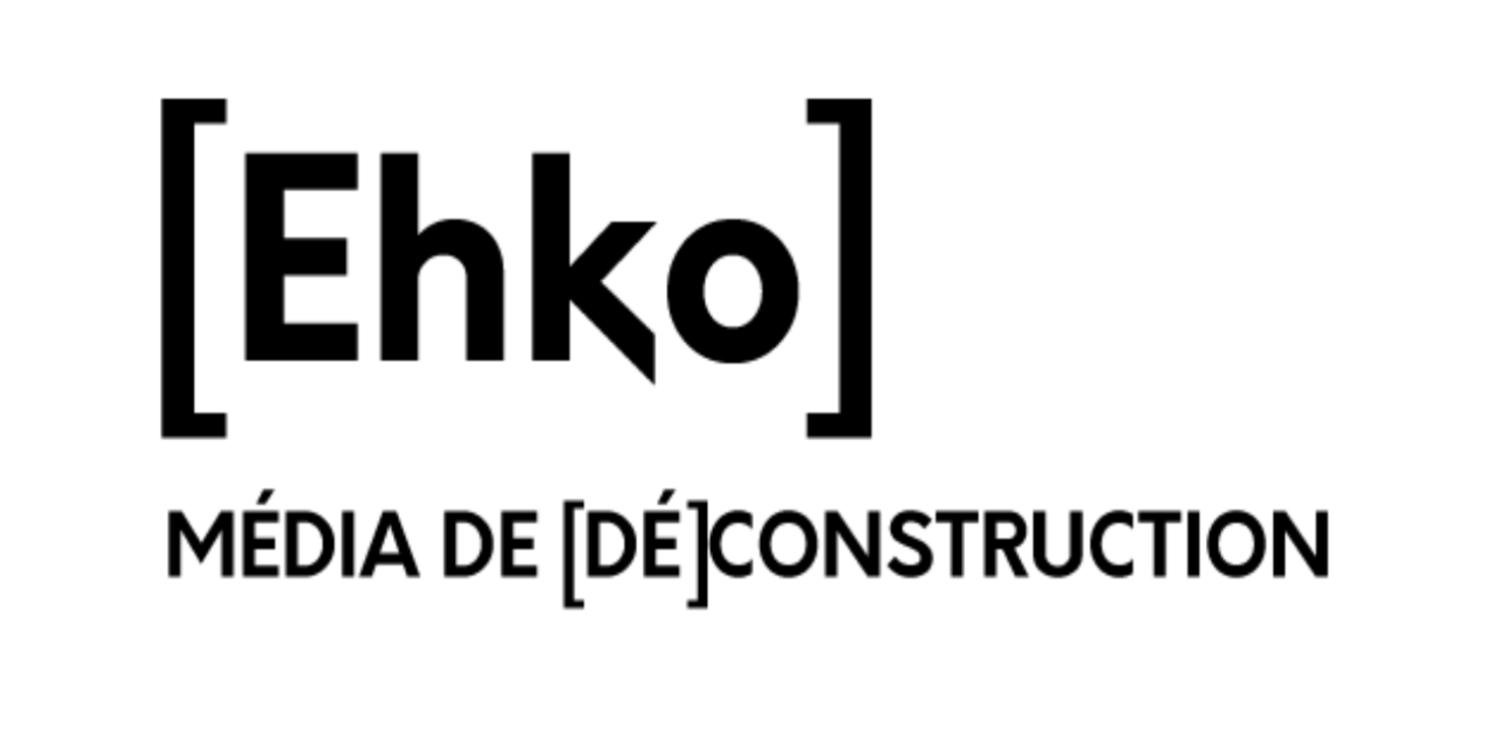Le projet de la loi dite « anti-casseurs » est à l’étude à l’Assemblée depuis ce 29 janvier. Annoncé le 7 janvier par Edouard Philippe et s’appuyant sur une proposition du 23 octobre (donc antérieure au mouvement « Gilets jaunes »), son but serait – entre autres mesures- d’interdire aux casseurs identifiés de manifester. Un pas de plus vers la lente radicalisation du tout-sécuritaire de l’État français.
La grenouille ébouillantée
[Faites une expérience]. Prenez une grenouille – si tant est que vous en ayez une sous la main. Si vous plongez subitement cette bestiole innocente dans l’eau chaude, elle s’échappera d’un bond. Si vous la plongez dans l’eau froide et que vous portez très progressivement l’eau à ébullition, elle ne sentira pas la température s’élevant dangereusement et s’engourdira… avant de finir ébouillantée.
Cette allégorie résume l’esprit sécuritaire qui hante la France. Ce qui vaut pour une simple grenouille vaut-il pour les libertés publiques ? La lente mais certaine accumulation de lois sécuritaires est semblable à cette mise en ébullition progressive, dans laquelle tout un pays et sa population s’engourdissent insensiblement. Le bond attendu tarde à venir, malgré les nombreux appels des ONG et juristes profondément préoccupés par la tranquille (et redoutablement efficace) accumulation législative sécuritaire.
La loi dite « anti-casseurs » est au stade de discussion parlementaire mais plusieurs points inquiètent déjà. L’interdiction de manifester, telle qu’elle est prévue à l’article 2 de la proposition de loi sénatoriale, déposée par le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau et qui sert de socle à ce projet de loi anti-casseurs, pose que « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ».
Cette formulation juridique semble être devenue le sésame qui ouvre à l’autorité administrative des prérogatives qui limitent de fait droits et libertés. Cette formulation se retrouvait déjà dans l’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 qui venait modifier l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. C’est cette loi de 1955 qui servit de socle juridique à l’instauration de l’état d’urgence au soir du 13 novembre 2015. La loi de 1955 permettait d’assigner à résidence alors les personnes dont « l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ». La loi du 20 novembre apporta une nouvelle formulation qui permettait désormais au ministre de l’Intérieur de prononcer l’assignation à résidence d’une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
Le glissement est saisissant, d’une activité à un comportement, d’une matérialité du comportement « avéré » vers de « sérieuses raisons de penser ». De l’objectivité à la subjectivité et l’appréciation aléatoire. D’une matérialité réelle des actes dangereux, constatés a posteriori et objectifs (activité qui s’avère dangereuse), la loi passe à une absence de tout acte (comportement), donc supposé a priori et totalement subjectif (sérieuses raisons de penser que). La formule « sérieuses raisons de penser » renvoie en effet à une appréciation relative qui a peu à voir avec une quelconque objectivité juridique. Elle dessine un possible arbitraire, puisque tout dépendra en définitive de l’autorité à laquelle il reviendra de « penser » qu’un « comportement » induit une « menace ».
Ce glissement n’est pas que rhétorique. Il portait en lui-même une révolution juridique dangereuse qui a fait florès depuis. Il devient alors plus facile de passer de la menace à « l’ordre public » à celle à « l’ordre établi », surtout en l’absence de tout garde-fou préalable d’un juge contrôlant cette décision. Dans l’État de sécurité qui se dessine, ce flou juridique se normalise, dans tous les sens du terme. Il se banalise et devient la norme.
Car comment juger de la dangerosité d’un comportement, en l’absence de tout acte matériel ? Le droit pénal n’a pas à s’interroger principalement sur les intentions, mais sur les actes et leur matérialité concrète. Palpable, mesurable, avec des conséquences, ou de possibles conséquences. Un ultime glissement dangereux s’opère alors au sein du droit pénal : la création d’infractions qui relèvent plus de l’intention supposée ou de l’opinion avérée.
Ce projet de loi pose évidemment la question de sa constitutionnalité. Une autorité administrative peut-elle priver quelqu’un d’une liberté constitutionnelle, celle du droit de manifester ? On pourrait y ajouter, par capillarité, la liberté de circuler, d’opinion et le droit de grève. Autre tropisme sécuritaire que porte aussi ce projet de loi, cette décision de manifester serait prise par une autorité administrative. Donc dépendante du pouvoir exécutif. Or, sous la Vème République, c’est l’autorité judiciaire, indépendante, qui doit « assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme ». Le pouvoir judiciaire se voit-il priver, peu à peu, au prétexte de « réactivité » et d’efficacité, de prérogatives qui assurent par elles-mêmes l’équilibre et la séparation des pouvoirs donc de l’Etat de droit?
Limiter les libertés pour les défendre?
Pourtant, pour Christophe Castaner, il s’agit de « donner les moyens que le droit fondamental de manifester puisse être garanti ». Protéger les libertés en les limitant en somme. Un paradoxe qui n’est en rien unique car c’est précisément au nom de la protection des droits et libertés que se constate une propension à les limiter. Amnesty International remarque ainsi, dans un rapport sur les lois antiterroristes en Europe une étrange inversion, tendance lourde des démocraties parlementaires soumises au choc du terrorisme : « Ces deux dernières années ont vu se dessiner un changement radical à travers l’Europe : l’idée selon laquelle le rôle du gouvernement est d’assurer la sécurité, afin que la population puisse jouir de ses droits, a laissé place à l’idée que les gouvernements doivent restreindre les droits de la population, afin d’assurer la sécurité. La conséquence de ce changement a été une redéfinition insidieuse de la frontière entre les pouvoirs de l’État et les droits des personnes ».
Ce projet de loi « anti-casseurs » s’inscrit dans un mouvement législatif plus large, qui traduit le glissement de l’Etat de droit vers l’Etat de sécurité, voire sécuritaire. De l’Etat qui restreint dans le temps et l’espace les mesures dérogatoires à un état dérogatoire permanent et généralisé.
Lors de l’adoption du projet de loi anti-terroriste qui intégrait certains points de l’état d’urgence dans le droit positif, Mireille Delmas-Marty, professeur honoraire au Collège de France avait déjà averti. Selon elle, cette loi antiterroriste marquait, ni plus ni moins, qu’une « rupture anthropologique ». Cette conception sécuritaire conduirait d’une société de la responsabilité vers une société de la suspicion, « avec le risque de ne plus protéger les citoyens contre l’arbitraire ». Il s’agirait là d’une réécriture sécuritaire du droit administratif, comme du droit pénal qui « ferait disparaître la présomption d’innocence ». On en viendrait alors à un processus « qui ressemble à une déshumanisation, par retirer de la communauté humaine les individus suspects, comme on retire des produits dangereux du marché. Cette rupture, qui pourrait être qualifiée d’anthropologique, ou même de philosophique, est consommée dès lors que la punition n’est plus l’objectif d’un droit que l’on persiste à nommer “pénal”, alors qu’il tend vers des mesures qui sont imposées à une personne non pas pour punir les crimes qu’elle a commis, mais pour prévenir ceux qu’elle pourrait commettre », expliquait-elle au journal Libération.
La juriste émérite décrit en langage juridique la vision de biopolitique développée par Foucault, ce régime de surveillance généralisé qui met des individus entre parenthèses, limitant et réglant leurs capacités de déplacement et de vie. Et leurs droits. Le scénario du film dystopique de Steven Spielberg, Minority Report (2002) en somme, où les individus sont arrêtés non pas pour ce qu’ils font ou ont fait mais pour ce qu’ils pourraient faire.
L’Etat sécuritaire
Un état de l’exception permanente ou un Etat sécuritaire s’esquisse-t-il à travers ce feuilletage de lois sécuritaires ? Cet Etat sécuritaire serait, par nature et définition, contraire à l’État de droit. Car là où l’État de droit suppose d’être limité et corseté par la norme, auquel il doit se plier, l’état d’exception permanente permet à l’État de déroger à cette même norme limitative. Au nom de la sécurité. Au nom de lois sécuritaires floues qui, parce qu’elles courent justement après un concept indéfini, le terrorisme ou désormais « le casseur », prétendent à la même plasticité. Or, l’État de droit ne se résume en rien au droit de l’État. Il en est même souvent le contraire, l’exacte opposition. L’État de droit suppose l’idée que l’État doit se soumettre, pour se limiter et assurer la sûreté et la sécurité des citoyens, à un ensemble de règles, principes, libertés qui lui sont supérieurs. Auxquels il ne saurait déroger, au risque de changer alors de nature et d’essence, et de n’être plus précisément un État de droit.
Si l’État de droit devient un État sécuritaire, n’est-ce pas alors là l’indice éclatant de sa propre radicalisation ? Pour le chercheur Arun Kundnani, il faut mettre le terrorisme en parallèle avec une autre radicalisation – celle de l’État. Lui aussi voit dans le 11-Septembre un basculement, « l’événement absolu, la « “mère” des événements », selon le mot prophétique de Jean Baudrillard. Depuis lors, les gouvernements américain et français se sont radicalisés aussi, devenant toujours plus répressifs. Les attentats de 2015 peuvent aussi être qualifiés de matrice de ce mouvement législatif sécuritaire qui avait trouvé dans la menace terroriste sa justification.
Dans l’État de droit, les institutions d’exception autorisent à s’écarter temporairement de certaines normes constitutionnelles, lorsque les circonstances l’exigent. Selon le penseur italien Giorgio Agamben, qui a le mieux examiné cette exception permanente, les démocraties occidentales évoluent vers quelque chose qu’il faut, d’ores et déjà, appeler État de sécurité, The Security State aux États-Unis. L’état d’urgence, dans cette optique, n’aura donc pas été une parenthèse dans l’État de droit, sa suspension temporaire, mais l’indice plus large d’une sortie de cet État de droit vers l’État de sécurité. Lequel évidemment désigne, par litote, un État d’insécurité et un état d’insécurisation permanente.
Le philosophe note aussi dans Le Monde que « l’état d’urgence est justement le dispositif par lequel les pouvoirs totalitaires se sont installés en Europe. Ainsi, dans les années qui ont précédé la prise du pouvoir par Hitler, les gouvernements sociaux-démocrates de Weimar avaient eu si souvent recours à l’état d’urgence (état d’exception, comme on le nomme en allemand) qu’on a pu dire que l’Allemagne avait déjà cessé, avant 1933, d’être une démocratie parlementaire ».
Il n’y a pas si longtemps, on aurait trouvé impensable d’interdire des manifestations, car il s’agit d’une liberté fondamentale. L’Etat sécuritaire n’est pas la garantie de la sécurité. Bien au contraire. Il est encore temps que la grenouille, mithridatisée par la température qui monte, ait enfin ce sursaut de vie démocratique.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Fresque Paris 19e, Gilets jaunes. Crédits : Cheep