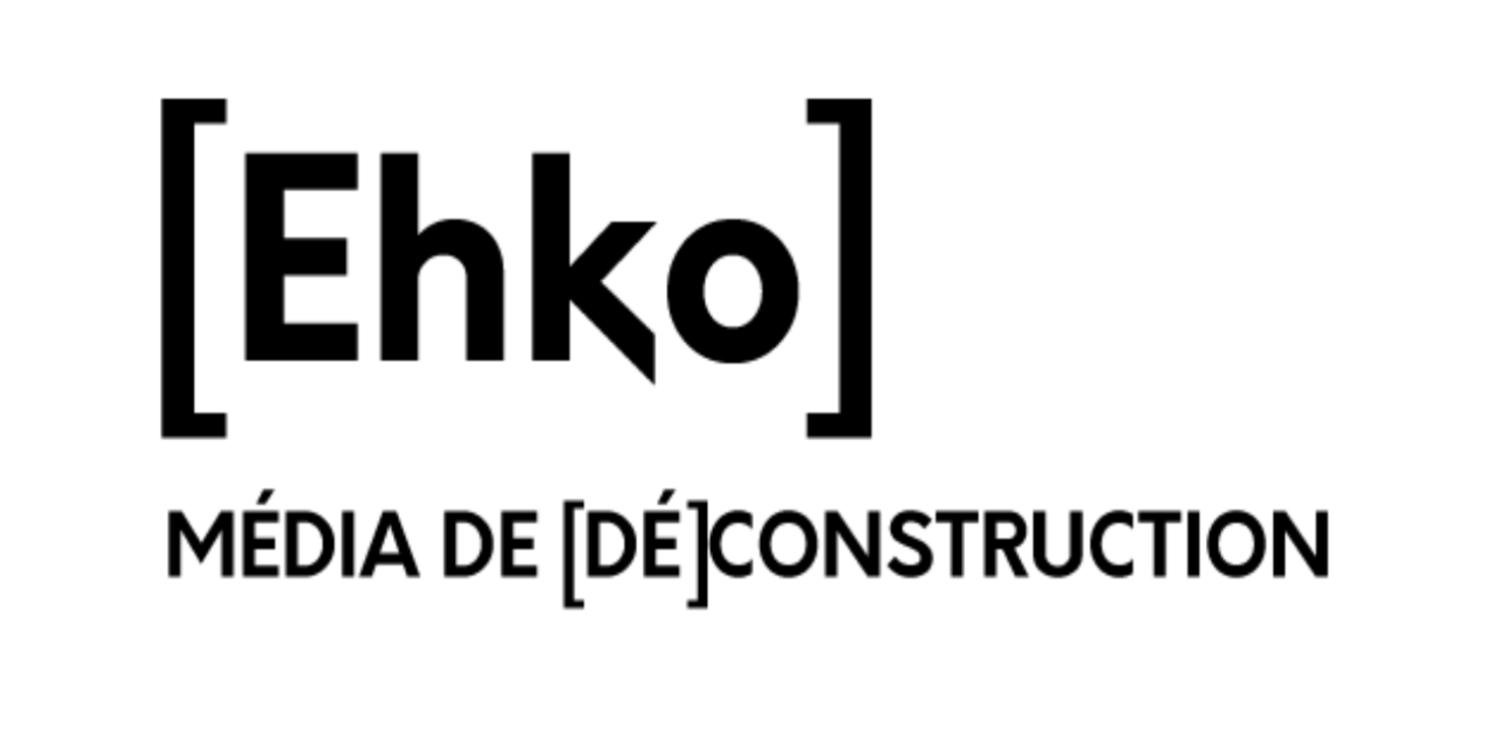Puisqu’il faut se présenter, puisqu’il faut dire d’où je parle, puisqu’il faut dire « je » tout simplement. Pourtant le journaliste est tout sauf un « je ». C’est du moins l’usage du métier. Il est surtout « tu », « il », « elle », « vous », « ils », « elles », mais jamais, au grand jamais, il ne laisse transparaître ce « je » qui ferait trop écran. On nous apprend à le cacher, ce « je », derrière un « autre »: la doxa, l’opinion, les dépêches crachées avec une régularité de métronome, les déclarations officielles, les faits, l’objectivité. Dans son travail, ce journaliste bien impersonnel s’accorde le droit au « on » à défaut du « nous » trop inclusif. Ce « on » indéfini, qui impose son diktat imperceptible. Celle de l’air du temps, de « l’esprit de gramophone » à la chanson obsédante. A défaut du « je », le « on » qui n’est personne mais s’impose à tous.
Pourtant les journalistes que j’aime ont tous su dire « je ». Ils en ont même fait leur marque. Joseph Kessel couvrant la guerre israélo-arabe de 1948. Orwell en Catalogne, Orwell dans la dèche à Londres et Paris, Orwell sur les quais de Wigan. Jack London dans les bas-fonds londoniens. Gunther Wallraff au « je » d’un ouvrier turc miséreux et exploité. Florence Aubenas au « je » de femme de ménage harassée sur les quais de Ouistreham. La philosophe Simone Weil qui a voulu vivre la condition ouvrière et dont le « je » a porté la voix des damnés du labeur. Tous ces « je » ont aimanté le mien, mon « je » de journaliste, lui indiquant son axe cardinal.
Alors, voici ce « je ». De façon succincte. Je suis ce qu’on appelle une anomalie statistique. Un affront certain à la loi des déterminismes sociaux. Pourtant il me semble que je passe mon temps à rencontrer des anomalies statistiques. Cette réalité, ma vérité, je compte bien la montrer avec Ehko. Le journalisme est, pour mon « je », plus qu’un métier même s’il n’est pas un sacerdoce. Il est une façon d’être au monde, aux autres, aux choses et aux faits. L’information est partout, elle bruisse de faits à recueillir, à ordonner, à vérifier, à analyser, à expliquer. J’entends aussi le journalisme comme un acte d’éducation populaire, comme un acte de résistance et comme un acte d’humanisme. Un plaidoyer pour la fraternité aussi.
Ce « je » suffira à résumer le « nous » qui vivra à travers Ehko. Ce « nous » de Warda et moi. Ce « nous » qui sera créé avec nos lecteurs, les Ehkotiers, comme nous les appelons déjà. Ce « nous » qui sera consolidé avec les plumes et talents que nous voulons découvrir.
Pour conclure, un dernier « je ». L’ultime « je » qui porte ce site. Laissez-moi vous raconter l’histoire du mot « Ehko ». Imaginez Bethléem, face à l’Eglise de la nativité. Une tente montée à la hâte pour protéger du soleil de mai des femmes palestiniennes. Assise à même le sol, chacune tient le portrait d’un fils, d’un frère, d’un mari. D’un être cher. Tous en prison. Tous en grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. L’une d’elle, 70 ans, visage beau et délicat entouré d’un fin voile blanc, tient le portrait de son fils. Elle est droite, stoïque, le portrait repose de façon tout aussi droite sur son giron. Elle nous raconte, à mon amie Esther et moi, la prison, son fils absent depuis 14 ans, son fils qui n’a jamais pu embrasser sa fille de 13 ans, née après son arrestation. « On » écoute, « on » filme, « on » prend des notes, « on » acquiesce, « on » compatit. Puis au moment du départ, elle me saisit la main et me dit « Ehko! Ehko! Ehko! ». « Racontez! Racontez! Racontez! ». Voilà qui est fait.
Le reste est à découvrir sur notre site qui sera aussi le vôtre…
Hassina Mechaï
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.