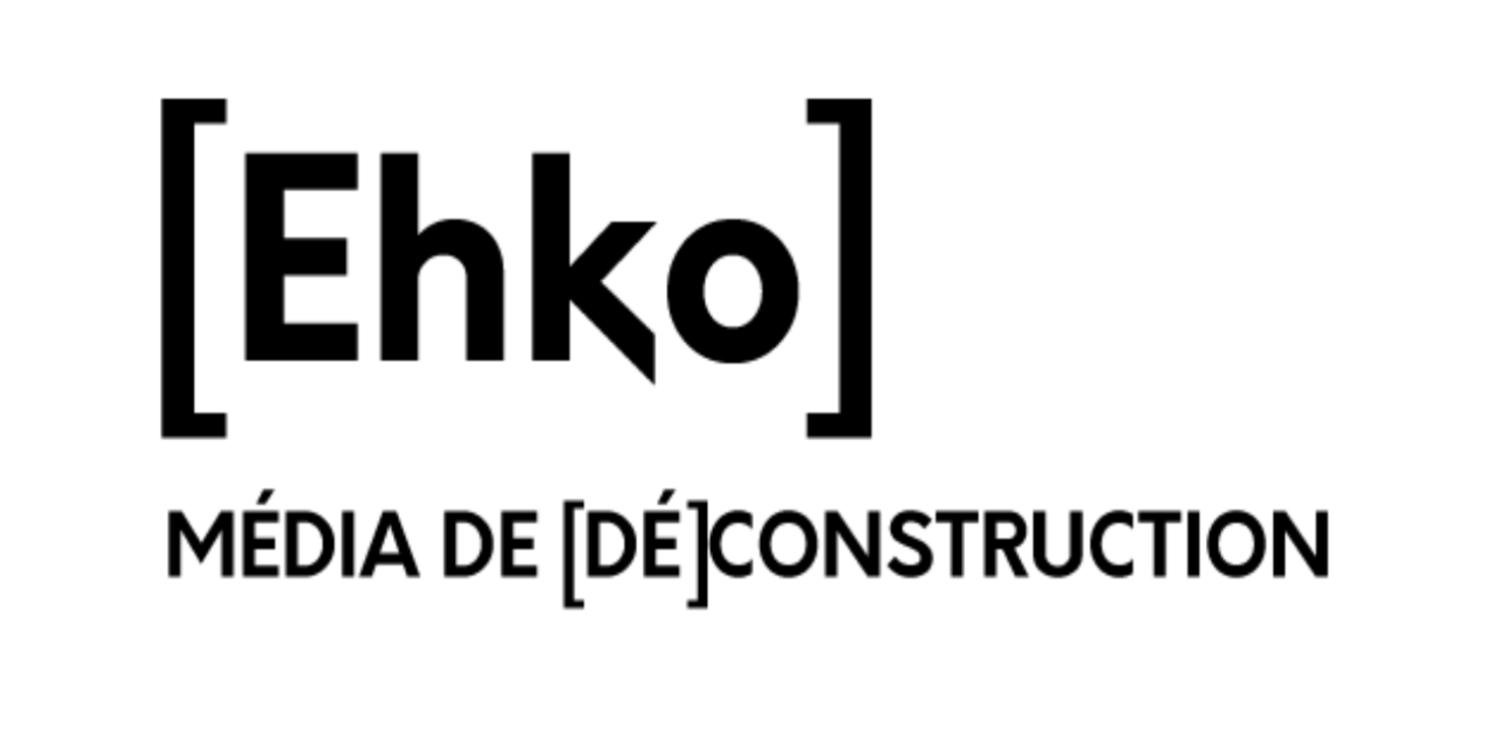Une résolution de députés français devrait être déposée en vue de faire de l’antisionisme un délit, à l’instar de l’antisémitisme. [Ehko] a jugé bon de reproduire un article consacré au parcours de Yonatan Shapira. Israélien, descendant de victimes du nazisme, pilote et commandant dans l’armée israélienne, désormais refuznik et inlassable vigie de la politique israélienne, son parcours éclaire cette question. Les opinions d’Israéliens juifs telles que les siennes pourraient-elles devenir illégales en France ? S’il venait à s’exprimer, comme d’autres Israéliens très critiques de la politique de leur pays le font déjà, sera-t-il déclaré hors-la-loi en France ? Qui pourra désormais interroger la politique israélienne, comme pour n’importe quel pays ?
[« Il me semble que nous sommes une société dans un état psychotique avancé], une sorte de dédoublement de la personnalité, et que la seule manière pour nous d’y survivre est de nous enfermer et de disparaître dans notre propre bulle ». C’est ainsi qu’en 2003, Yonatan Shapira, alors pilote dans l’armée israélienne, exprimait toute son incompréhension devant la spirale de violence en Israël et en Palestine. Cette bulle, il a tenté de la faire éclater après le 22 juillet 2002, date d’une « opération » sanglante à Gaza.
Imaginez. Ici, un hélicoptère transportant des victimes israéliennes d’un attentat, le sang, les larmes. Le pilote, Yonatan Shapira, observera de son cockpit, alors qu’agonise derrière lui l’une des victimes de l’attentat qu’il transporte d’urgence à un hôpital, un paisible mariage israélien qui se déroule au sol, dais nuptial et festivités sereines. Là, des victimes palestiniennes, prises dans le feu d’un missile « ciblant » Salah Shéhadé, considéré comme le responsable de la branche armée du Hamas.
Le chemin de Damas de Yonatan Shapira passera donc par ces deux horreurs, comme les deux pôles d’une seule tragédie : « Lors de cette mission à Gaza, 14 humains ont été tués et plus de 150 autres blessés. 4 familles, 9 enfants, 3 hommes et 2 femmes ont été liquidés par l’équipe de l’avion qui a frappé la cible dans l’entière conviction qu’ils étaient en train de défendre les Israéliens », se rappelle l’ancien soldat. « Exactement à la même date, 12 ans plus tard, en 2014, l’armée israélienne a déversé 100 bombes d’une tonne dans la partie sud de Gaza, tuant encore plus de gens », rappelle Yonatan Shapira.
De retour à la base, Dan Haloutz commandant des forces aériennes, délivrera aux soldats un blanc-seing moral. Il poussera même la sollicitude jusqu’à les envoyer dormir, après cette mission exécutée « à la perfection ». Le réveil se fit alors pour certains.
Désarroi moral face à l’occupation israélienne
Ce sursaut, Yonatan Shapira nous le racontera avec gravité. Parfois affleurera dans son récit comme une intonation quasi mécanique, une nécessaire distance : « J’ai réalisé que je ne voulais plus faire partie d’un cercle de violence absurde. Même si alors j’effectuais des missions de sauvetage et que je n’ai jamais tiré sur quiconque, je devais prendre mes responsabilités et dénoncer ». Suivra un an plus tard l’initiative d’une lettre publique de 27 pilotes, coup d’éclat dans un ciel moral israélien apparemment serein : « Nous, pilotes vétérans et pilotes actifs, ensemble, qui avons servis et continuons à servir l’Etat d’Israël pendant de longues semaines chaque année, nous refusons d’exécuter des ordres illégaux et immoraux d’attaques que l’Etat d’Israël effectue dans les Territoires ».
L’engagement de Yonatan Shapira traduit parfaitement, dans sa singularité, les mouvements et contradictions de la société israélienne. Tout le destinait à rester ce qu’il appelle lui-même avec le sourire un « garçon naïf et sioniste ». « J’ai grandi dans une base aérienne et je m’identifiais totalement avec Israël. J’adhérais à la narration sioniste qui pose que mon pays recherche la paix avec ses voisins et le monde, et souffre parce qu’il est entouré d’ennemis. C’est là typiquement le genre de narration selon laquelle les enfants de ce pays sont élevés. Je dis souvent que parmi les morts ce jour-là, il y eut aussi le garçon naïf et sioniste que j’étais. Si je n’ai piloté que des engins de secours et n’ai jamais pris part à ce genre d’action, j’ai eu l’impression que ces bombardements avaient été faits en mon nom ».
Lors de nos entretiens, Yonatan Shapira insistera sur le désarroi moral qu’il a ressenti lorsqu’il s’est rendu compte du fossé entre les valeurs enseignées à l’armée et la réalité dans les territoires palestiniens. « On m’a menti et cela a été difficile pour moi de l’admettre. Je croyais à ce qui m’avait été enseigné à l’armée. J’étais sincèrement persuadé de la moralité de l’action des soldats israéliens ».
Parmi ces valeurs inculquées à tout soldat israélien, le fameux concept de « pureté des armes » (tohar haneshek). Théoriquement, l’utilisation de la violence militaire se conçoit dans l’unique objectif de neutraliser l’ennemi armé, en tentant d’éviter de porter atteinte aux populations civiles. Ce principe est intimement lié au «Yishouv» (terme utilisé pour désigner l’ensemble des juifs présents en Palestine avant la création de l’État d’Israël) pré-étatique et à la Haganah, embryon de la future armée, qui avait adopté une doctrine dite de « restriction », la Havlagah. Les travaux des Nouveaux Historiens ont largement contredit depuis ce mythe qui a prévalu notamment pour la narration de la guerre de 1948.
En 1994, le code militaire dit « l’Esprit des forces israéliennes de défense » (Ruach Tsahal), va faire reposer l’éthique militaire sur la « tradition de l’Israel Defense Forces »; « les traditions de l’Etat d’Israël, ses principes démocratiques » ; « la tradition du peuple juif à travers son histoire » et « les valeurs universelles basées sur la valeur et la dignité de la vie humaine ». Cet effort de codification repose donc sur « des traditions » vagues, subjectives et potentiellement contradictoires. Plus encore, ces valeurs morales ne se basent pas explicitement sur les principes actifs et objectifs du droit international. Une tension se déploie aussi entre normes juridiques, morale religieuse et héritage sioniste. Ce code sera marqué par un certain échec dans un pays où l’identité de l’Etat est en balancement constant entre judéité et sécularité.
Quoi qu’il en soit, ce vade-mecum flou permettra longtemps à l’armée israélienne de se vivre comme « l’armée la plus morale du monde ». La guerre du Liban de 1982, la première et seconde Intifada ont pourtant mis à jour sa contradiction inhérente. Cette contradiction se retrouve jusque dans le nom même de l’armée israélienne, Israel Defense Forces (IDF, forces israéliennes de défense), qui pose le principe d’une armée non offensive dans sa nature. Coincés entre cette croyance de défendre le pays selon la locution souvent entendue en Israël « eïn brera » (« pas de choix ») et la crue réalité de l’occupation, des soldats, sans s’opposer ouvertement, choisiront alors de ne pas effectuer certaines missions, au nom de leur seule éthique personnelle.
Car comment concilier les évidentes contradictions d’un code moral qui participe plus de l’auto-limite que de l’impératif juridique ? Comment ce code essentiellement animé par des références aux valeurs juives et sionistes pourrait-il servir de balise morale alors que selon certaines interprétations, le judaïsme (entendu comme promesse divine inaliénable sur Eretz Israël) et le sionisme (entendu comme mouvement de libération nationale non-clos) légitimeraient dans le même mouvement l’occupation, pourtant cause originelle de l’injustice faite aux Palestiniens ? L’attitude morale trouvera vite dans ces contradictions insolubles ses propres limites.
Yonatan Shapira a vécu lui aussi dans cette tension intenable : « J’ai simplement cessé de me soucier des miens seulement, et me suis préoccupé de tout le monde. J’ai cessé de m’inscrire uniquement dans une ethnie, une tribu, une religion ou une couleur. C’est un changement de perspective qui modifie tout. Toutes ces valeurs humanistes dans lesquelles j’ai grandi, je les ai appliquées à tous. Mais c’est un changement intenable pour ceux qui sont encore enfermés dans leur point de vue raciste. Je me suis toujours senti partie prenante de mon pays, c’est une part évidente de mon identité. Lorsque j’ai commencé à interroger la question du Bien ou du Mal qui était faits en mon nom, il a été plus facile de se sentir suffisamment confiant pour parler ouvertement ».
Alors quoi ? Moralité de façade ? Hypocrisie ? Pas si simple. Les Israéliens interrogés, et c’en est frappant, croient sincèrement que leur armée agit moralement. Et chaque fois que les simples faits, dans leur brutalité, viennent les heurter dans cette foi, le vacillement qui en résulte est vite compensé par les mantras moraux inculqués. Plusieurs raisons à cela. D’abord c’est le signe d’une vraie ignorance du sort des Palestiniens. Sous prétexte de sécurité, la société israélienne est ainsi maintenue dans une ignorance infantile de la réalité crue de l’occupation et du sort de l’occupé.
Cette illusion d’une moralité intangible est aussi devenue une nécessité quasi existentielle pour une société qui n’a pas encore résolu ses tensions internes. Tensions entre les strates migratoires de sa population, tensions entre laïcs et religieux et tensions économiques, cette société est traversée par des lignes de fractures horizontales et verticales intenses. Les tensions externes avec les Palestiniens sont ainsi paradoxalement utiles puisqu’elles créent mécaniquement un « vivre contre » plutôt qu’un vivre ensemble national.
Dès ses origines, Israël a balancé entre un désir de normalité dans le concert des nations et un rejet des règles qui régissent habituellement les relations internationales, hors de cette realpolitik froide qui avaient trouvé dans le génocide juif l’ultime aboutissement monstrueux. Ce balancement contradictoire se devine dans la déclaration d’indépendance qui fonde la légitimité à l’existence d’Israël sur trois principes : les liens spirituels qui lient le peuple juif à ce qui était alors la Palestine, l’irréductibilité de l’antisémitisme des nations qui démontrait « le caractère urgent » de l’existence d’une patrie protectrice et enfin le droit international, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, notamment la résolution de l’Assemblée de l’ONU du 29 novembre 1947.
Trois justifications qui portaient pourtant en elles les germes d’une équation insoluble, la même que celle qui se lit en filigrane dans le code moral de l’armée. Se réclamer du droit international seul aurait supposé respecter les droits nationaux des Palestiniens également reconnus dans cette résolution de 1947. Se réclamer du seul lien historique et spirituel avec la Palestine biblique signifiait s’engager sur le terrain glissant de la place de la religion et de son interprétation aléatoire dans un Etat qui se voulait moderne. Restait alors l’antisémitisme comme fondement terrible pour un pays qui ne pouvait dès lors que se recroqueviller sur lui, dans cette « posture du gladiateur » que l’on retrouve de façon physique chez les soldats israéliens suréquipés et surarmés. Car faire de la Shoah l’horizon indépassable empêche de voir les autres souffrances, fussent-elles celles qu’on inflige. Le danger est de devenir une société qui entretient un traumatisme rendu nécessaire à sa justification, ethos du pathos qui enferme dans cette bulle opaque décrite par Yonatan Shapira.
Lui-même a peut-être été enfermé dans cette bulle. D’abord pilote dans l’armée puis militant contre l’occupation, comme beaucoup de ses compagnons d’armes, ses engagements premiers traduisent les mêmes contradictions propres à son pays. Son histoire personnelle le fait héritier à la fois de la mémoire de la Shoah (plusieurs membres de sa famille ont été décimés) et du sionisme historique (son père a été également pilote et ses frères, refuzniks également, ont été soldats). Confronté à la réalité, cette tension intenable éclatera le 22 juillet 2002.
L’armée qui possédait un pays
En Israël, il n’est pas rare d’entendre, par dérision, qu’Israël n’est pas un pays avec une armée, mais qu’il s’agit de la seule armée au monde qui possède un pays. L’armée y a un rôle social et symbolique fondamental. S’opposer ouvertement à elle peut avoir des conséquences personnelles et professionnelles lourdes. Trois voies légales s’offrent pourtant à ceux qui veulent refuser.
La première voie avait été esquissée timidement par la Cour suprême israélienne, notamment sous l’égide du juge Aharon Barak. Pour la première fois en 1988 dans l’affaire Schnitzer, toutes les décisions y compris celles prises dans le cadre de la sécurité d’Israël, pourront être contrôlées par le juge, ce qui revient de facto à poser un contrôle juridique sur le conflit. La Cour Suprême est ainsi devenue active, créant par ricochet une stratégie du recours pour les citoyens souhaitant le contrôle juridique de la légalité des opérations. Cependant, dans de nombreux domaines relevant de l’éthique militaire, allant des méthodes employées lors des interrogatoires aux obligations humanitaires israéliennes dans les territoires palestiniens au regard du droit international, le juge a de fait inscrit dans la jurisprudence le principe de proportionnalité. Dans l’ensemble le juge israélien a donc surtout posé des limites a posteriori mais a peu interdit.
La seconde voie légale a été le contournement de l’armée par l’implication de l’opinion publique et de la société civile israélienne, notamment par l’utilisation d’appels publics de soldats, comme le firent Yonatan Shapira et ses camarades en septembre 2003. Tous s’appuient sur les principes démocratiques de liberté d’expression et de conscience. Dans les années 1970, 27 lycéens avaient ainsi déclaré publiquement leur objection et demandé le retour d’Israël aux frontières de 1967. Ils furent condamnés à un an de prison. Peu de temps avant la guerre du Liban, naît le mouvement « Yesh gvul », « Il y a une limite ou une frontière », pirouette syntaxique pour réaffirmer qu’Israël se doit de se définir et de se limiter aussi bien moralement que géographiquement. 170 conscrits déclarent leur opposition à cette guerre. Ils seront jugés et condamnés à un an de prison. De nouveaux mouvements d’objecteurs apparaissent au moment de la deuxième Intifada, en septembre 2000. En janvier 2002, 52 officiers lanceront le mouvement « Le courage de refuser ».
Ces officiers demanderont à être jugés par un tribunal civil et non militaire, comme la règle le veut pourtant. Généralement, l’armée préfère utiliser des procédures souples d’exclusion plutôt que des procès formels. Ceci évite la confrontation avec des éléments de défense politique et juridique, notamment l’argument du caractère illégal de l’occupation selon la loi nationale et internationale. Cependant, une véritable culture du recours juridique s’est quand même développée chez les objecteurs de conscience tentant de porter le débat hors de l’armée. C’était là une façon de passer de l’objection de conscience individuelle vers une réflexion collective sur la nature d’un pays occupant. Mais l’armée a parfois contourné l’écueil en évitant tout emprisonnement pouvant mener à un procès-tribune publique. Yonatan Shapira et ses co-signataires échapperont ainsi à la prison en 2003.
« Un procès nous aurait donné l’attention voulue. Le seul moyen pour eux de nous mettre en accusation et nous envoyer en prison était de prouver que les ordres dont nous disions qu’ils étaient illégaux étaient légaux. Et ils ne pouvaient justifier, même devant une Cour israélienne, que lancer des bombes et des missiles sur des civils étaient un acte légal », se souvient Yonatan Shapira. Il précise : « Après la publication de la lettre, les réactions furent très négatives dans l’establishment militaire. Mais nous avons aussi eu des soutiens surprenants de militaires. J’ai eu ainsi le soutien de mon commandant d’escadron. J’en fus surpris car cette lettre pouvait être considérée comme un acte de mutinerie. Cela montre la complexité des choses. D’autres pilotes ont exprimé leur soutien en privé mais ils précisaient qu’ils avaient trop peur des conséquences s’ils nous rejoignaient dans cet appel. Je pourrais parler de ceux qui furent punis, mais il me semble intéressant de dire la complexité des choses. Ceux qui restent dans le système passent par un processus lent où ils finissent par accepter les choses. Beaucoup de pilotes qui étaient d’accord avec moi aimaient trop voler pour y renoncer. Peu à peu, ils ont accepté les règles, s’identifiant au système. Maintenant, ce sont des meurtriers de masse. Personne dans ce monde ne peut dire qu’il ne sera jamais fasciste du moment où il s’adapte et se trouve des excuses ».
Enfin la troisième voie légale pour ceux qui s’opposent aux actions de l’armée, notamment les jeunes recrues, est de demander le statut d’objecteurs de conscience devant un comité militaire. La Haute Cour de justice ayant posé le principe de l’exemption du service militaire pour objection de conscience, l’armée respecte théoriquement cela mais à la condition subjective qu’elle soit convaincue que ces points de vue sont sincères. De plus, le comité qui examine la demande d’exemption détermine si elle est « véritablement motivée par la conscience, et non par des facteurs politiques, sociaux ou autres ». Ainsi, même si les motifs sont jugés « sincères », le comité peut toujours rejeter la demande si elle semble fondée sur la « désobéissance civile » plutôt que sur l’objection de conscience. Une nuance qui dit beaucoup. En effet, la désobéissance civile se définit comme une protestation motivée par des opinions politiques et qui vise à amener un changement dans la politique de l’État. Cela va donc au-delà des besoins ou de la conscience de la personne. Or l’exemption sera systématiquement refusée si elle découle de croyances idéologiques et politiques qui visent les circonstances dans lesquelles l’armée doit effectuer des tâches à un moment donné.
L’armée israélienne favorise donc une objection de conscience grise, dépolitisée. Elle maintient la conscience des jeunes objecteurs dans la seule zone morale floue plutôt que dans l’affirmation politique claire. Là encore on retrouve cette tension entre morale et droit. L’armée préfère réformer pour raisons de santé, religieuse ou psychologique plutôt que de laisser la jeunesse exprimer politiquement son refus.
Yonatan Shapira a pu lui aussi observer chez ses camarades cette objection feutrée : « C’est un phénomène général, pas seulement en Israël. Seule une minorité décide de s’exprimer ouvertement. Puis il y a ceux qui sont persuadés du bien-fondé du système. Et enfin il y a cette part floue de ceux qui sont mal à l’aise mais refusent de risquer leur stabilité sociale et trouvent des accommodements. Certains trouvent des excuses pour ne pas servir en Cisjordanie ou pour ne pas participer à des attaques qu’ils désapprouvent intérieurement. Je sais que certains pilotes admettent qu’ils évitent de participer à ces missions. Ils se font porter pâles et évitent ainsi d’interroger un système qui produit oppression et crimes. Ce système tolère cette »objection grise », il produit un »consentement industriel ». Cela n’aide en rien car alors d’autres exécutent ces missions».
Internationaliser la question israélo-palestinienne
Un fait est frappant dans certaines déclarations publiques des refuzniks. La principale victime, le peuple palestinien, y apparaît à peine. Même la « lettre des pilotes » initiée en septembre 2003 porte en elle cette étrange absence-présence. Il y est certes parlé de « victimes civiles » et d’occupation, mais le peuple palestinien n’y apparaît pas comme tel. Tout se passe comme si le but premier de ces appels avait été de préserver l’innocence ontologique d’Israël, la souffrance palestinienne n’apparaissant que de façon périphérique. Le peuple palestinien semble ainsi quasi réduit à un objet transitionnel d’auto-compassion et comme dépouillé de son statut de victime première.
Cette invisibilité-visibilité apparaît déjà en filigrane dans le concept militaire de « tirer et pleurer » (bokhim vé yorim) des soldats en territoires occupés. Elle trouve son apogée dans la fameuse phrase de Golda Meir, qui fut Premier ministre : « Nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants », qui au-delà de son caractère insultant et raciste, annule encore une fois chez le Palestinien toute réalité de sa souffrance voire de son humanité, et nie toute responsabilité israélienne dans cette souffrance. Et là s’esquisse un principe terrible d’inversion : car si le Palestinien n’est plus victime, il faudra donc qu’il soit la cause des actes commis contre lui. La responsabilité de chaque soldat en sort dès lors au mieux partagée donc diluée, au pire occultée. Car dans son paroxysme, cette inversion suppose que le soldat devienne la victime de sa victime, et l’occupation une simple conséquence défensive et non la principale cause offensive.
Pourtant une révolution mentale fondamentale se fait peu à peu chez certains refuzniks. L’occupation, comme tout projet colonial, tend à effacer l’occupé jusque dans les empreintes historiques, économiques, sociales qu’il laisse sur la terre convoitée. Or l’effacer dans la volonté de paix participe de la même folie que l’effacer dans la volonté de guerre. Ne pas donner une juste place aux Palestiniens dans la résolution du conflit, c’est se condamner à l’inefficacité et plus largement à la continuation de l’injustice et du mépris. Voilà pourquoi des ONG comme Combatants for Peace ou encore Ta’ayush font collaborer activistes palestiniens et d’anciens soldats israéliens. « Pour moi, il est très important de parler avec les Palestiniens. Les seuls Israéliens qu’ils voient entrent dans leur maison au milieu de la nuit enlèvent leur père, frère. Ils n’avaient jamais rencontré d’Israéliens prêts à aller en prison pour ne pas servir dans l’armée. Cela leur donne espoir », résume Yonatan Shapira, membre fondateur de « Combatants for peace » (organisation avec laquelle il a pris depuis ses distances). Et quand on lui demandera ce qu’il souhaite pour les Palestiniens, il refusera nettement de s’exprimer en leur nom : « J’ai compris qu’il nous faut accepter d’être dirigés par eux dans cette recherche de la paix et non pas les guider ou décider pour eux ».
Mais pour ce faire, sur quoi s’appuyer ? Là encore une autre approche va naître peu à peu, qui inscrit les actions de refuzniks dans la légalité internationale. Ce glissement du légalisme vers l’internationalisme est d’ailleurs intéressant sur ce qu’il dit aussi de l’évolution d’Israël, et de la possible résolution de son balancement constant entre le lien spirituel avec la terre de Palestine, l’antisémitisme et le droit international. Ce caractère d’ethno-démocratie laisse de côté les Palestiniens. Le droit international présente trois avantage : d’abord c’est une norme objective et extérieure à Israël, contrairement à la loi nationale, au judaïsme ou au sionisme. De plus, il permet de jouer sur la hiérarchie des normes juridiques en se basant sur la plus haute légalité. Car comme le notait le juge à la Cour suprême israélienne Aharon Barak, « Israël n’est pas une île enclavée, mais fait partie d’un système international ».
Cette dynamique internationaliste permettra à Yonatan Shapira et à ses compagnons de justifier ainsi leurs tentatives d’entrer dans Gaza par voie de mer. Cette mince bande de terre est encore considérée sous blocus par l’ONU, malgré le retrait de 2005 et sa situation humanitaire contrevient évidemment à la quatrième convention de Genève de 1949. Les membres des différents équipages, dans une stratégie de rupture, avaient inscrit leur tentative de briser le blocus dans le légalisme international comme socle et la non-violence comme moyen d’action. A chaque arraisonnement, la légalité nationale violente israélienne s’est heurtée alors à la légalité internationale non violente. La question de la légitimité morale se déduisait d’elle-même.
Ce genre de tentative sort le principe de non-violence de la philosophie attentiste pour la placer dans la réalité dynamique du jeu des pouvoirs et de l’opinion publique. Une étude très intéressante a ainsi démontré que la non-violence était un choix rationnel et éminemment efficace. Deux chercheuses américaines, Maria Stephan et Erica Chenoweth, ont ainsi étudié 323 campagnes de lutte syndicales ou nationales entre 1900 et 2006, incluant la Première et la Seconde Guerre mondiales. D’après leurs recherches, les luttes non-violentes ont 53 % de chances d’atteindre leur but, contre 26 % pour les luttes violentes.
Cette évolution du mouvement des refuzniks vers l’internationalisme se cristallise aussi dans le mouvement mondial BDS que de nombreux refuzniks ont rejoint : BDS – Boycott, Désinvestissements et Sanctions. BDS est le fruit d’un appel des Palestiniens, publié en 2005, devenu depuis l’outil central de la lutte non-violente contre les violations israéliennes des droits palestiniens. Prenant modèle sur le boycott contre l’Afrique du Sud de l’apartheid, ce mouvement a le mérite d’internationaliser la question de l’occupation et de mettre chaque Etat mais également chaque citoyen devant ses responsabilités, dans le contexte d’une société internationale en constante interaction horizontale. Yonatan Shapira insiste : « Il me semble que nous devons »coller » à ce que les Palestiniens veulent, à leur façon d’envisager leur lutte. Donc soutenir leur appel au mouvement BDS et ne pas avoir peur de dire des choses qui effraient l’opinion israélienne. Ce mouvement BDS est non-violent. En tant qu’Israélien, je dois suivre ce que les Palestiniens disent, car ce sont eux qui luttent contre l’oppression, ce n’est pas une lutte israélienne ».
Les refuzniks montrent peut-être la voie de cette normalisation nécessaire. Normalisation entendue comme soumission aux normes mais aussi comme banalisation en tant qu’Etat pour que cesse enfin cette hésitation entre l’en-dedans et l’en-dehors dans la psyché israélienne. Cela permet aussi de réinscrire la Shoah non pas comme un totem autorisant tout mais comme un tabou ne permettant rien, l’Holocauste, sacrifices humains au Moloch du national-socialisme, cessant alors d’être une sorte de divinité figée. C’est le sens peut être du geste de Yonatan Shapira qui inscrira sur le mur du ghetto de Varsovie : « Libérez tous les Ghettos, libérez Gaza et la Palestine ». Il se souvient qu’alors, « en Israël, les réactions ont été vives. Les gens ne comprenaient pas comment un ex-capitaine de l’armée de l’air pouvait comparer Gaza à un ghetto. Pour moi cela semblait pourtant évident ».
Ce geste peut se voir comme une réappropriation d’un souvenir figé pour en faire une mémoire vive. Il rejoint en cela les mots d’Avraham Burg, ancien président de la Knesset qui appelle à sortir « hors des cendres de la Shoah ». Et en cela paradoxalement ce geste et les actes de tant d’autres refuzniks reviennent aux fondements même du judaïsme qui inscrit la mémoire dans la justice et dans la responsabilité individuelle, et non dans l’autojustification et l’irresponsabilité collective.
Yonatan Shapira jette sur ce « conflit » israélo-palestinien le regard lucide de celui qui le vit au quotidien. Il observe qu’ailleurs dans le monde, cette situation sert aussi de réceptacle à des non-dits qui ne concernent en rien la situation en Israël-Palestine : « Désormais, le processus de fascisation [de la société israélienne] se poursuit et continuera en réaction aussi aux condamnations de la communauté internationale devant les actions d’Israël. Cependant, il me semble que, parfois, il est facile pour les gens (…) d’oublier les problèmes de leur propre pays. Je choisis les mots les plus extrêmes quand je parle de mon pays et des choses qui se font ici, mais je voudrais lutter avec la même passion avec ces gens contre les crimes de leur propre gouvernement, les crimes qui se passent en leur nom dans leur pays. Il est parfois plus facile de devenir un militant de la question israélo-palestinienne et d’oublier ce qui se passe dans son propre pays. J’insiste sur ce point ».
[Apostille] Cet article est né de plusieurs entretiens entre l’auteure et Yonatan Shapira et de reportages en Israël. Un premier portrait avait été publié pour la revue Alternatives non violentes. Une interview a été publiée sur le site Middle East Eye.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Capture d’écran Democracy now! Interview de Yonatan Shapira.