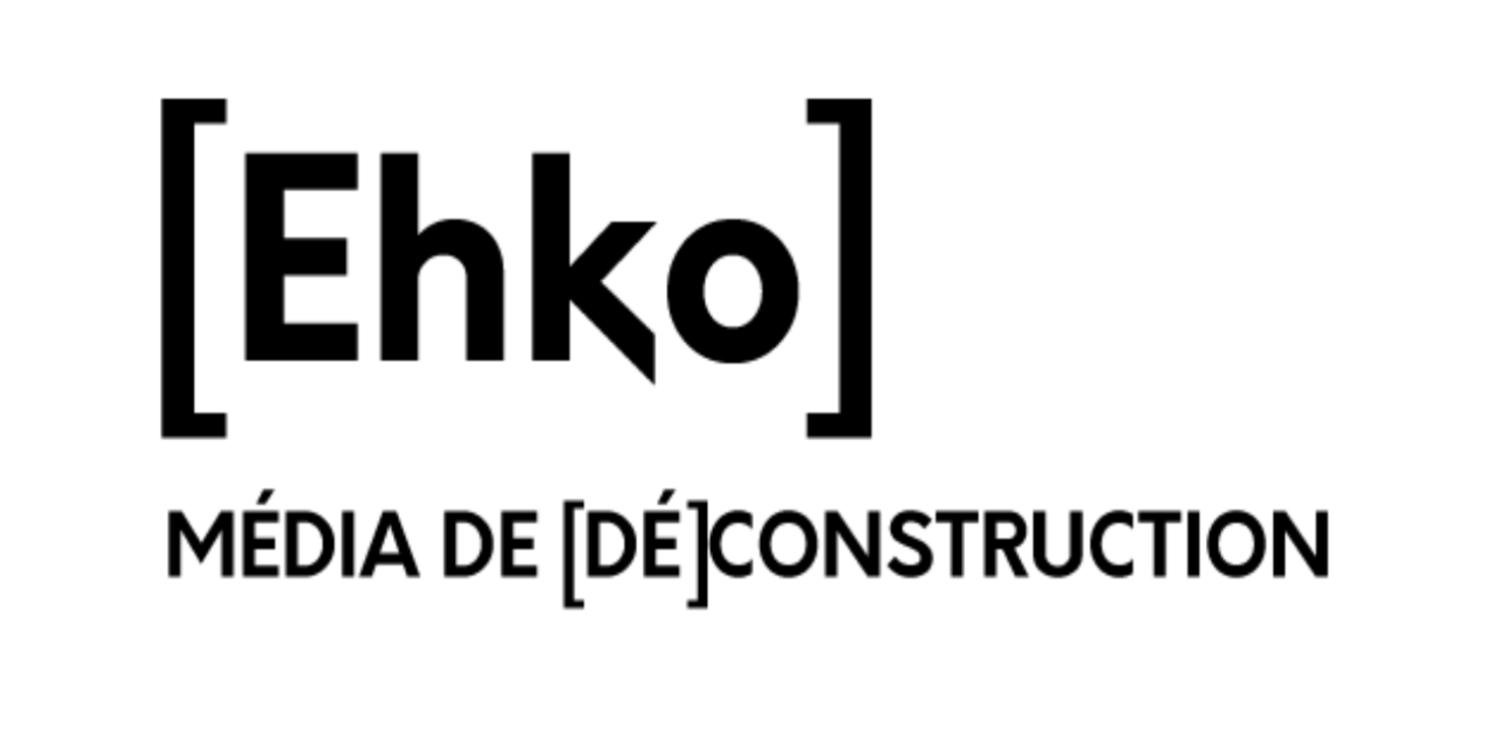[Le monde a peur]. La Peste à Thèbes, les sauterelles bibliques, le choléra et les tremblements de terre…Les mythes et mots sont emplis du récit catastrophique, celui qui fait tout à la fois office de dévoilement, de clôture d’un ordre ancien, et pour les plus optimistes, évènement inaugural d’autre chose. « Nous ne reviendrons pas à la normalité car la normalité était le problème » disent certains. D’autres attendent avec impatience cette normalité ouatée, tour de manège et tapis de course qui permettent de se mouvoir sans avancer. Avec cette pandémie mondiale du coronavirus, nous sommes entrés tous à pieds joints ou disjoints dans ce récit dont nous refusons pourtant d’être les protagonistes. Nous vivons ce que nous avons lu dans des dystopies poussives, vu sur des écrans désincarnés, imaginé pour nous faire peur. Et voici que soudain, c’est notre réalité à tous. Nul Orson Welles pour nous dire à la fin que c’est une blague, que c’était pour jouer à se faire peur. Le réel nous cogne à chaque coin de rue, il nous cueille groggy et hagard, frôlant les murs de villes désertées. On suspend sa vie pour la protéger. On s’accroche à une crépusculaire tension de l’être, les gens sont précautionneux dehors, comme s’ils flottaient dans un entre-deux, hésitant à s’affirmer encore vivants. On convoque Paul Valéry et ses civilisations mortelles. On relit Camus plutôt que Giono ou Boccace. On s’arrime à Delumeau, Toynbee ou Spengler. René Girard parfois. Après tout, pourquoi pas. L’heure est aussi à la méditation sur des ruines non encore fumantes. Mais tout autant, on s’agite et s’étonne. Les cartes sont rebattues, celles de la géopolitique comme celles de l’intime. D’autres sont renversées. Restera-t-il des joueurs seulement ? Entre le confinement heureux des Madame Verdurin qui tiennent salon dans nos journaux (et tiennent leurs journaux dans nos salons), et celui redondant d’un prisonnier déjà en prison, quoi en commun ? Les pouvoirs publics font ce qu’ils savent mieux faire, obliger et imposer. « Nous sommes en guerre » clament des dirigeants. Ou le claironnent-ils plutôt, sans nommer l’ennemi. Or ne pas nommer l’ennemi, n’est-ce pas la certitude que chacun pourra le devenir ? Puis la guerre comme continuité d’une absence de politiques publiques (désormais criantes) par d’autres moyens martiaux, est-ce bien raisonnable ?
On tente de saisir les faits, de les apprivoiser en séquences, un réel sécable plutôt qu’une vague d’irréalité. Quoi dire qui ne soit ni lieux communs qui n’ont déjà été arpentés, circonscrits et piétinés par d’autres ? Dire que ce virus est un scandale, au sens premier, qu’il fait donc « trébucher » nos sociétés arc-boutées sur la mort de la mort, prétendument terrassée par le principe de précaution, la prophylaxie, la certitude de vivre en paix ? Ou affirmer que ce virus est un scrupule, un petit caillou qui gêne la marche, oblige à claudiquer en incertitudes elles-mêmes boiteuses ? Est-il une répétition, un bégaiement, une cacophonie? Est-il un révélateur, un dévoilement, un retournement ? Les angoisses diffuses, le mal être, le flottant spleen civilisationnel s’effacent pour faire place à la peur bien lourde, pesante, celle non pas de mal vivre mais tout simplement de mourir. Au fond, n’est-ce pas la seule question humaine, le vivre et le mourir ? Le reste n’est que péripéties. Mais il n’en demeure pas moins que 2,6 milliards d’individus sont assignés chez eux. Vertigineux. Tous unis en une seule pensée, univoque. Le voilà peut-être l’universel enfin atteint. Celui qu’a réussi à créer la peur, mortier qui lie autant qu’il fragmente.
Puisqu’il faut bien faire sens et interroger l’évènement, [Ehko] a posé ses questions à l’écrivain et chercheur Christian Salmon, auteur, entre autres, de Storytelling, L’ère du Clash, Le projet Blumkine. Dans cette « histoire au présent » qui se fait sous nos yeux, débroussailler et élaguer ainsi le trop plein de sidération pour aller au cœur de l’évènement.
Quel serait l’ordre, ou désordre, narratif, que cette pandémie impose à chacun ?
J’observe dans les réactions qu’on peut lire ou entendre, une sorte de réaction réflexe, allergique, chacun opposant à la catastrophe sanitaire, ses idées préconçues, ses obsessions, ses penchants. Chacun puise des explications dans son propre vivier idéologique en une réaction « machinale », et appose sa grille de lecture aux évènements. Or ce qui est intéressant me semble-t-il dans cette crise, c’est qu’elle nous déborde de toutes parts, qu’elle nous échappe, qu’elle met en crise nos habitudes de pensées. Elle se manifeste par son côté imprévisible, inattendu, impensable dans ses conséquences. Elle déjoue nos systèmes de défense immunitaire mais aussi nos systèmes de pensée, notre compétence narrative. Elle nous laisse aussi sans recours narratif. Ce n’est pas seulement une crise sanitaire, c’est une crise de narration. Cette épidémie est la troisième crise du XXIe siècle qui dépasse les effets des deux crises précédentes, celle du 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008. Dans mon dernier livre « L’Ere du Clash », j’ai qualifié l’attentat contre le World Trade Center de « ground zero du récit » pour rendre compte de cet effondrement narratif devant l’impensable. L’épidémie de coronavirus n’est pas un attentat terroriste mais elle nous lance le même type de défi narratif.
L’attentat contre le WTC ne s’attaquait pas seulement à des tours et à des symboles de la puissance, mais à la possibilité d’en rendre compte par un récit. Il visait à désarticuler toute possibilité d’un récit crédible. A la fin du XIXe siècle, Joseph Conrad, qui fut le témoin de l’essor du terrorisme anarchiste en Europe, a élaboré dans son roman « L’Agent secret » ce qu’il appelle « une philosophie du terrorisme ». Selon Conrad, l’acte de terreur absolu, celui qui réaliserait l’essence du terrorisme, serait un acte impossible à expliquer, dont on ne saurait déchiffrer ni les mobiles, ni les auteurs, pour lequel les journaux n’auraient pas d’«expressions toutes faites ». Son efficacité serait donc proportionnelle à sa puissance de dérèglement du discours médiatique. En s’en prenant à l’Observatoire de Greenwich, l’anarchiste de Conrad ne s’attaquait pas à une cible habituelle (une banque, un palais, une église) mais aux repères spatio-temporels sans lesquels il n’y a pas de récit possible. Frapper le méridien de Greenwich, c’était viser les coordonnées mêmes d’une expérience possible, c’est-à-dire ruiner les conditions de possibilité d’un récit. Les avions n’apportaient pas un message politique ou idéologique, ils mettaient en cause la capacité américaine, voire occidentale, à ériger et imposer un ordre narratif du monde. Une épiphanie à l’envers. L’attentat n’apportait pas la connaissance, mais l’ignorance. Il ne révélait pas un sens caché jusque-là, mais la dislocation de tout sens et de tout récit.
Tout ce qui nous arrive depuis le 11 septembre, terrorisme, catastrophes écologiques, crash financier, appartient à cette ère du Clash et nous lance ce même défi narratif. Peut-être faut-il simplement prendre la mesure de cette opacité, de cette illisibilité. Non pas seulement comme une insuffisance, une lacune, un manque d’informations ou un retard de l’information sur l’évènement, mais comme le seul véritable évènement. Une situation que les grecs nommaient ‘anekdiegesis’, absence et impossibilité du récit.
Qu’est-ce qui nous arrive de plus que le 11 septembre ? Quels défis nouveaux nous sont-ils lancés ?
Le 11 septembre était circonscrit dans le temps, dans l’espace et dans son ampleur. Cela s’est passé à New-York, cela a duré quelques heures et 3000 personnes sont mortes. Le bilan de la pandémie est incommensurable : il réalise un 11 septembre tous les trois jours. La pandémie n’est pas circonscrite dans le temps et dans l’espace. Elle progresse partout en même temps. Elle n’a pas non plus d’auteur identifié. Nous n’avons aucun Ben Laden sous la main pour nous soulager et lui imputer le crime. Nous pouvons bien nous déclarer en guerre, mais l’ennemi est invisible et le champ de bataille s’étend jusque dans nos chambres. C’est un évènement sans auteur, sans raison, sans limite dans le temps et dans l’espace. Et qui nous attend au coin de la rue. Le 11 septembre, on pouvait se déclarer Américains ou New-Yorkais, mais on vivait la tragédie à distance en spectateurs, comme on vit les guerres et les catastrophes. Mais cette fois la menace peut nous tomber dessus comme un drone. Tchernobyl avait bien unifié l’Europe sous un même nuage radioactif mais bien peu en avaient conscience. Nous voici mondialement confinés, acteurs et victimes, ensemble et séparés, dans cette situation dont Kafka avait eu l’intuition géniale lorsqu’il écrivit dans son journal : « L’histoire mondiale enfermée dans les chambres ».
Dans ce vide du récit se multiplient pourtant les journaux de confinement ou témoignages, tout aussi viraux que le coronavirus. Un récit du vide est-il la seule réponse ?
Oui, on écrit beaucoup. Beaucoup d’histoires circulent dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Car ce sont les questions sans réponses qui produisent les récits. Les récits complotistes mais aussi les récits contraints du pouvoir. Les journaux débordés par l’ampleur indescriptible de la maladie confient leurs pages à des écrivains qui à leur tour confient leurs états d’âmes à des lecteurs pour qu’ils se reconnaissent en eux. Qui aurait dit que le loft de la télé-réalité deviendrait un jour le modèle de la vie en société, incluant le confessionnal et l’exposition de soi, par écrit ou dans des vidéos de performance sur les balcons. C’est le plus souvent un symptôme, une réponse à ce défi narratif que nous lance l’épidémie. Il faut en prendre acte. Mais souligner aussi qu’il s’agit d’une injonction quand ce n’est pas une commande. Pourquoi ce besoin d’écrire, cette injonction d’écrire ? Or il n’est pas facile d’écrire sur un évènement qui est de l’ordre de l’indicible, de l’inappropriable. Ceux qui se sont essayés à cet exercice se sont heurtés à l’opacité et la gravité de l’évènement. Car le nœud narratif est pris en tenaille entre le récit de la catastrophe et la catastrophe du récit, c’est à dire de l’impossibilité ou l’effondrement de la représentation possible de l’évènement.
J’aimerais interroger ce mot « crise ». Faut-il l’entendre doublement « crisis » comme assaut de la nature ou manifestation violente d’une maladie, mais aussi le sens grec de « krisis », lequel signifie jugement ou décision ?
La première signification du mot s’impose à nous. Mais la seconde est plus difficile à cerner. Ce qui arrive n’était pas imprévisible. C’est le résultat de plusieurs dérèglements ou révolutions enchevêtrées : la crise de la souveraineté étatique qui déstabilise l’exercice de la décision politique, l’essor du capitalisme financier, qui va conduire à la crise des subprimes en 2008, le dérèglement climatique qui menace l’écosystème planétaire, la révolution technologique et la gouvernementalité algorithmique. Le second sens nous pose la question de savoir comment traverser cette crise. Il y a plusieurs réponses évidemment, mais aucune ne me satisfait réellement. Le récit écologique dénonce le capitalisme, le consumérisme. Cela est vrai mais reste aussi insuffisant. Car sortir de cette crise par une société repensée me semble difficile à imaginer. On ne change pas la société, c’est elle qui nous change. N’est-il pas naïf de penser qu’un évènement va nous servir de prise de conscience ? Cela suffira -t-il à transformer la société, nous transformer, transformer les rapports des uns aux autres ? Puis cette idée fait du virus une sorte d’accusateur, la métaphore d’une punition divine qui viendrait pointer les défauts de la société. Or, selon moi, ce virus, plutôt qu’être un accusateur, est un révélateur, un aggravateur. Quelque chose qui fait de la surenchère sur cette société sur tous les plans, économique, sociologique, écologique. Il est même un renversement géopolitique avec ces médecins cubains, russes et vénézuéliens qui viennent aider l’Italie.
Un autre mot à interroger, celui qui a beaucoup circulé au moment de l’épidémie : Apocalypse. Faut-il l’entendre aussi au sens premier de révélation et de dévoilement ?
J’ai du mal avec cette idée de dévoilement, car elle suppose que des voiles cacheraient la réalité pure. Il n’y a pas de réalité qui ne soit tissée de représentations. Pas plus qu’il n’y a de faits bruts qu’il suffirait de révéler. Nous pourrions plutôt y voir une forme de déchirement de la réalité. Nous touchons le fond, car d’une certaine manière il n’y a rien à dire. Il n’y a plus de réel et nous en touchons la vérité. En ce sens c’est une révélation. Mais c’est une révélation d’une absence de réel et de sens. Il ne reste plus de réel que la trame du virus qui envahit nos vies. Des vies qui étaient de toute façon déjà décolorées et dévitalisées. La révélation serait multiple : révélation du désordre du monde, du corps aussi, métaphore de notre vie mondialisée aussi. C’est ce défi narratif que les catastrophes ont lancé aux humains de tous temps. La religion y répondait avec son grand récit biblique : colère divine ou punition, la catastrophe était un message à déchiffrer. Au XVIIIe siècle alors que les épidémies se multiplient (la peste en 1720, le choléra en 1832, l’explication religieuse cède du terrain. Les Lumières vont laïciser les épidémies, tenter d’en comprendre les causes naturelles. Mais une explication scientifique n’est pas un récit. C’est le roman et la littérature qui va devoir relever ce défi. Dans un texte écrit lors de l’épidémie de choléra à Marseille en 1832, Chateaubriand se plaint ainsi de la dépoétisation du monde de la catastrophe, ramenée à « un banal accident sanitaire ». « Le choléra nous est arrivé dans un siècle d’incrédulité, de journaux, d’administration matérielle. Ce fléau sans imagination n’a rencontré ni vieux cloître, ni religieux, ni caveau, ni tombe gothique » écrit-il. Il parle d’un « fléau sans imagination ». Il répond ainsi par la romantisation à un défi narratif.
Dans le système religieux, la punition est toujours singulière ou sui generis, comprise comme la réponse adéquate à la faute précise. Dans le champ séculier ou profane, à quelle « faute » correspondrait ce virus ?
C’est le privilège du récit religieux ; il fournit non pas des histoires mais un récit maître qui apprivoise la sauvagerie de l’événement et à la violence de l’incompréhensible, il substitue la peur à la stupeur. Dans le champ religieux une catastrophe n’est jamais dépourvue de signification. Hors du champ religieux, rien ne nous permet d’échapper à la violence de l’imprésentable. Nous sommes hors champ. Le virus ne s’attaque pas seulement à l’organisme, aux fonctions du corps, mais au corps social qu’il désorganise, déstabilise, menace dans ses fonctions essentielles de protection, d’alerte, de secours et de coordination des activités.
Mais plus encore aux fonctions du langage, sa capacité à fluer l’expérience, à relever le défi de l’imagination. Qu’est-ce que la littérature sinon cette capacité à mobiliser le langage afin d’expérimenter de nouveaux rapports au corps et temps et l’espace ? Que signifie faire une expérience ? Le mot vient du latin « ex-periri » qui veut dire, traverser les périls. Comment traverser le péril lorsque nous sommes assignés à résidence ? Notre rapport au corps, au temps et à l’espace sont devenus problématiques. Nous regardons nos mains et nous ne voyons plus le prolongement de notre corps, la capacité d’appréhender, de toucher, de saisir ou de caresser, mais le vecteur possible d’un virus. Il s’agit de ne plus rien toucher, pas même son propre visage. Sortir de chez soi est une opération de funambulisme où le toucher est prohibé, où il peut nous mettre en danger. Il s’agit de ne rien toucher de ce qui l’a été par quelqu’un d’autre. Une sorte de vertige du tactile se déploie là.
Tous les sens qui servent à appréhender le réel et l’expérience sont comme débranchés. L’un des symptômes de la maladie n’est-il pas la perte du goût et de l’odorat ? Nous devenons tous des personnages beckettiens, enfermés dans un temps immuable, cette « inertie polaire » dont parlait Paul Virilio, le théoricien de la catastrophe.
2,6 milliards de gens ont été confinés en même temps. Pour rester dans la métaphore religieuse, sommes-nous dans le mythe de Babel revisité, celui d’avant la dispersion, quand l’humanité ne formait qu’ « une seule lèvre », « une seule pensée » ?
Nous vivons l’inverse de la dispersion de Babel. Un retour à la conscience d’une universalité de la condition humaine. Peut-être touchons-nous là non pas ce qui nous sépare mais là où nous nous croisons. Un lieu commun. Ce mythe de Babel peut être compris comme Dieu dessaisissant les hommes (êtres) de ce pouvoir d’unification, un pouvoir totalitaire au fond puisqu’il s’agit d’avoir la même pensée au même moment pour tous et chacun. Ce confinement monolingue, obsessionnel, n’est pas du tout un idéal. C’est l’impossibilité du dialogue et du récit qui interdit toute possibilité de narration. C’est ce mutisme qui est le terreau de la rhétorique guerrière.
Yuval Harari a forgé l’idée de « corona-dictature » pour qualifier la syntaxe autoritaire de la gestion de crise par certains Etats. Que nous disent ces réponses en autoritarisme ?
La réaction du pouvoir face à une épidémie est à la fois le rétablissement d’un ordre sanitaire mais aussi le retour à un ordre disciplinaire. Les moments de crise sont des occasions à saisir pour le pouvoir. Nous pensions que la société de contrôle (Deleuze) s’était substituée à la société disciplinaire (Foucault). En fait on découvre qu’ils (elles ?) peuvent parfaitement cohabiter et se renforcer. Que dit cette fameuse autorisation que nous devons nous adresser à nous-mêmes pour sortir dans la rue ? Nous pouvons en rire mais c’est exactement ce qu’analysait Foucault dans Surveiller et punir, à savoir le pouvoir d’écriture qui s’installe dans la société disciplinaire avec l’apparition des registres d’entrée et de sortie.
Nous voici libres de tenir notre propre registre d’entrées et de sorties, au risque d’être verbalisés pour nous protéger. Qui d’autre tient désormais ces registres sinon les GAFAM ? Ils transforment vie et actions en profil et modules calculables. C’est un état de guerre qui s’installe à la faveur de l’épidémie. Plusieurs états ont déjà suspendu leur Parlement (Israël, Turquie…) La rhétorique guerrière est son pendant narratif, une rhétorique de la mobilisation qui va de pair avec une injonction paradoxale à rester chez soi. Une sorte de cantonnement de la population, de guerre de tranchées, avec les héros en blouse blanche en première ligne et les héroïnes de supermarchés qui assurent l’approvisionnement des troupes confinées. Les présidents eux-mêmes sont mobilisés, devenus chefs de guerre ou comme se définit Donald Trump « wartime president », président de guerre. C’est une drôle de guerre. Une guerre sanitaire. Mais aussi une guerre narrative dont la première victime n’est pas seulement « la vérité » selon la célèbre formule de Kipling mais le récit.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Jérome Bosch, Saint Christophe, 1540.