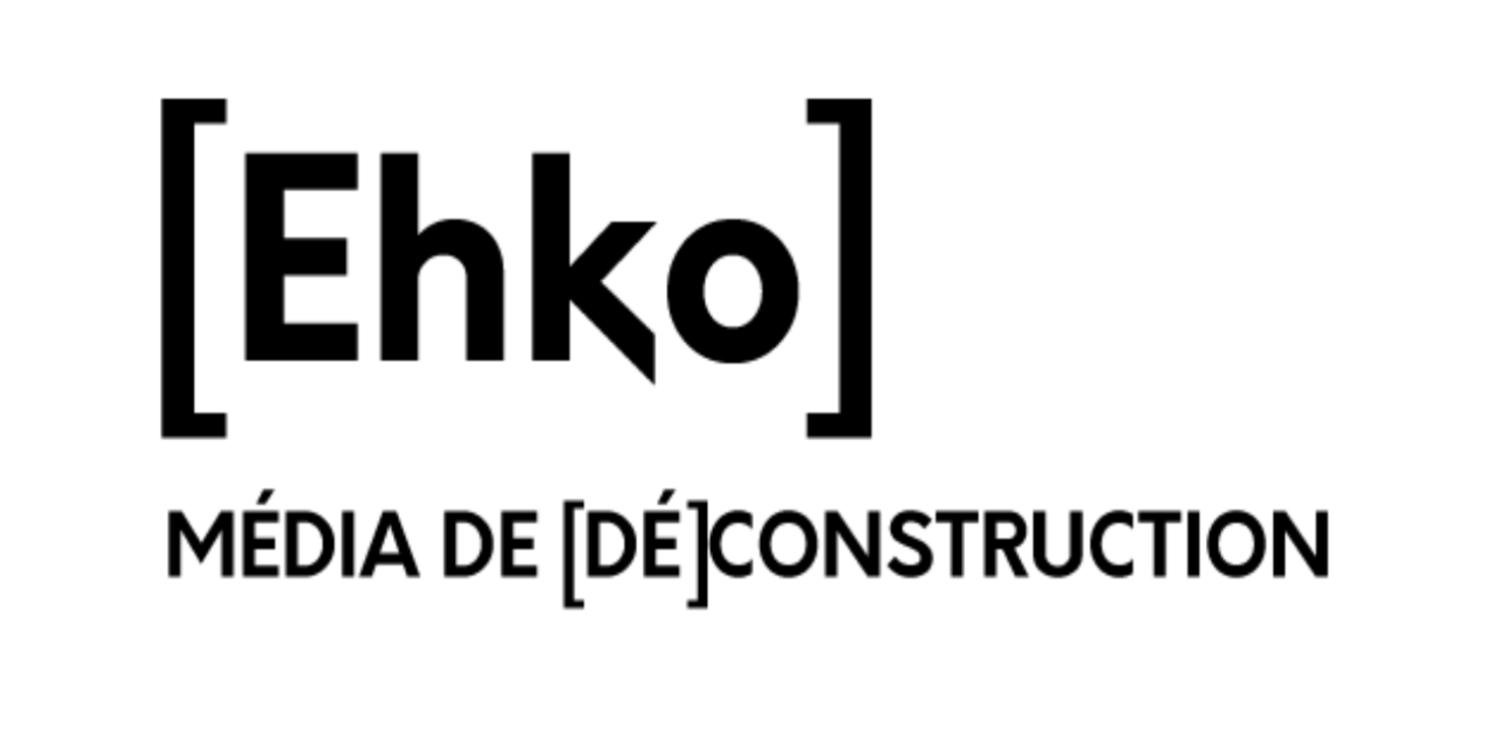Si elle était Américaine, Sihame Assbague, 32 ans, serait certainement présentée en France comme une activiste et citoyenne courageuse, par ceux-là même qui la désignent comme une ennemi de la République. Mais elle est née et a grandi en France. C’est donc dans ce pays qu’elle mène ses combats, dans le courant de « l’antiracisme politique », qui considère que le racisme structure le pouvoir politique, les institutions et les relations sociales et donc qu’il fait système, en opposition à « l’antiracisme moral » ou individuel [1].
Depuis 2012, elle travaille sur les violences policières. Elle émerge cette année-là en tant que porte-parole de l’association « Stop le contrôle au faciès » sur la promesse de campagne de François Hollande d’obliger les agents de police à donner un récépissé aux personnes dont ils contrôlent l’identité – majoritairement les individus perçus comme noirs ou arabes selon de nombreuses études, avant d’être repérée Outre-manche par The Guardian puis les Etats-Unis et d’exploser médiatiquement face à Alain Juppé, à qui elle fera reconnaître qu’il existe « un racisme structurel, évidemment », avant qu’il ne revienne sur ses propos.
« Il n’y a pas qu’à Ferguson » écrit-elle en 2014 avec une autre militante devenue journaliste comme elle, Rokhaya Diallo. Dans cette tribune, elles établissaient un parallèle entre Mike Brown et Bouna Traoré, pour parler « des 320 morts recensés en moins de 50 ans » et « rappeler qu’en France aussi, la police tue. » Des morts niées, invisibilisées quand elles ne sont pas considérées comme justifiées. « Si les circonstances de ces drames ne sont jamais exactement les mêmes, elles ont toujours les mêmes causes et donc, les mêmes conséquences. […] Depuis 1979 ce même scénario est récurrent : une intervention policière tourne mal, un (jeune) homme est tué ; la police plaide légitime défense ou mort « naturelle » ; les médias relayent la version officielle ; le quartier s’embrase ; la révolte est réprimée ; la famille du défunt se constitue partie civile ; les policiers sont acquittés. La routine assassine. Si le processus est similaire, c’est le traitement médiatico-politique qui diffère […]. Lorsqu’il s’agit de couvrir un crime policier aux Etats-Unis, le prisme racial semble évident (même pour nos commentateurs nationaux !) : un policier blanc tue un citoyen noir et cela s’inscrit dans un contexte de racisme structurel et historique. En France, pays historiquement esclavagiste et colonial, et alors même que les médias sont généralement friands de ce genre de détails, on « omet » opportunément la précision. C’est le fameux point d’aveuglement républicain. Pourtant, sur les centaines de morts recensées : plus de 90 % sont des non-Blancs tués par des policiers blancs. Jamais ce point n’a été soulevé, la criminalisation systématique des victimes permettant de museler ces questionnements et de justifier l’injustifiable.»
En 2015, elle participe à l’organisation d’une « Marche de la dignité » à Paris, 100% féminine et avec « des personnes subissant le racisme d’Etat », contre le racisme et les violences policières. La même année, le collectif Stop le contrôle au faciès participe à une action en justice contre l’État français pour des contrôles de police discriminatoires. Une première. L’État est condamné sur cinq dossiers en appel (sur treize présentés). Il se pourvoit en cassation mais la condamnation est définitivement confirmée pour trois des cas.
Avec Fania Noël, elle organise l’année suivante le « premier camp d’été décolonial », destiné aux « personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français ». Tollé médiatique et politique puisque l’initiative est présentée comme « interdite aux Blanc.he.s »… Et ce, jusqu’à l’Assemblée nationale : lors d’une séance des questions au gouvernement, la ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem condamne fermement l’initiative. Même le Premier ministre Manuel Valls réagira.
Sihame Assbague travaille donc depuis 7 ans sur les violences policières. Pourquoi n’est-elle pas considérée comme une lanceuse d’alerte alors qu’elle s’évertue à traiter du racisme et des violences policières sur les réseaux sociaux, à l’université (Paris 8 dans le cadre de « Paroles non-blanches » par exemple) ou ailleurs ? Pourquoi le système médiatique efface celle qui dit être devenue journaliste « par obligation » sur ce sujet qui émerge enfin, depuis que ces violences touchent les « Gilets jaunes », au profit d’autres figures jugées plus « neutres » et donc « légitimes » ? Surtout, dira-t-on d’elle dans un futur plus ou moins proche – à supposer que ses combats politiques aboutissent – qu’elle a porté haut les valeurs de la République française ? Car finalement elle ne demande que l’application de ses principes.
Sihame Assbague incarne, peut-être malgré elle, une forme de militantisme qui vise à faire évoluer le rapport de force avec les institutions, jusqu’au plus haut niveau. Son parcours est particulier, singulier. Bien qu’elle insiste toujours fortement sur le fait qu’il s’inscrit dans celui des générations précédentes et actuelles de militants et dans un cadre collectif, justement parce que l’individualiser est aussi pour elle une façon d’affaiblir « la lutte ».
Pour toutes ces raisons, [Ehko] a choisi de l’interviewer. Elle qui refuse les interviews de médias français en général a néanmoins accepté de raconter à [Ehko] son parcours et de commenter ce nouvel intérêt pour les violences policières.
[Ehko] : Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous devenue une militante considérée comme « radicale » [au sens premier du terme, donc pas péjoratif] ?
Sihame Assbague : Comme tous les militants de ma génération, je pense, je daterais le début de ma politisation à 2004. Deux faits majeurs ont fait basculer notre perception politique : la loi de 2004 contre les signes religieux – une loi contre le voile pour parler clairement – et les révoltes urbaines de 2005 suite à la mort de Zyed et Bouna.
En 2004, j’ai suivi les débats avec beaucoup d’attention car j’avais une amie qui portait le voile dans ma classe, donc on a tous été touchés. On en discutait beaucoup. Je crois qu’avec les mobilisations pour la Palestine, les manifestations contre cette loi sont mes premières manifestations. À ce moment-là, je ne suis pas du tout militante. Personne ne l’est autour de moi, ni ma famille ni mon entourage. Des sujets me touchent, m’intéressent, mais je suis loin des sphères militantes. Je vais découvrir ce milieu et tous ses apports théoriques progressivement.
En 2005, il y a la loi sur le rôle positif de la colonisation. Elle charrie aussi son lot de propos abjects, de racisme, de révisionnisme. Puis les révoltes de novembre suite à la mort de Zyed et Bouna. C’est un marqueur, un tournant, pour tout le monde je pense. Je n’arrivais pas encore à le formaliser et politiser comme je peux le faire aujourd’hui mais déjà le traitement médiatique et politique me faisait péter un câble. Pareil pour la question des violences policières. Étant une femme non-blanche, c’est une violence à laquelle je ne suis pas confrontée mais les hommes de mon entourage l’ont été et le sont encore. Novembre 2005 fait écho à tout ça. Il y a quelque chose qui vient interroger, bousculer même, brutalement notre place dans l’ordre social en France. Donc 2004-2005, c’est une période extrêmement violente, je pense que la plupart des militants – ou non d’ailleurs – de ma génération s’en souviennent.
Savez-vous déjà que vous êtes perçue comme « Arabe » à ce moment-là ?
Oui. Parce que t’as beau cartonner à l’école, tu sens, dans les interactions avec les adultes notamment, que tu n’appartiens pas au corps social légitime. On le sent dans nos tripes, même si on n’arrive pas forcément à mettre les bons mots sur les choses, à formuler le rapport social dont il s’agit. On sait, on sent. Mais ça ne m’a pas du tout empêchée de croire aux promesses républicaines. Au contraire, je pensais que malgré tout, il suffisait de le vouloir, de travailler dur, etc, pour s’en sortir. En 2004-2005, la réflexion prend une autre dimension et je commence à tout relier : de la colonisation à notre statut ici, en France, etc. Ce sont des balbutiements mais je commence à interroger les choses, à écrire, etc. Mais sans plus.
A ce moment-là, je ne sais absolument pas à quoi je me destine. Je sais que je veux faire plein de choses mais j’ai peur de m’enfermer dans une filière. Au lycée, ma prof de français me conseille de faire prépa. Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce que c’est : je kiffe juste l’idée que je pourrais poursuivre toutes les matières et que je n’aurais pas à me spécialiser tout de suite. Après, la prépa c’est vraiment un autre monde. Je fais deux ans de classe préparatoire littéraire et commence un double cursus à la fac, en lettres modernes appliquées à l’information et la communication et sciences politiques et lobbying, toujours avec l’idée de continuer un parcours le plus généraliste possible.
Y a-t-il des militants dans votre université ? Vous souvenez-vous de communications comme celles, marquante, du Parti des indigènes de la République (PIR), avec la carte d’identité française barrée du mot « Indigène » ou « Racaille » ?
Non, mais je me souviens de L’Appel des Indigènes de la République et de la polémique qui a suivi et je me souviens surtout des interventions médiatiques de Houria Bouteldja. Je devais avoir 18/19 ans. Je ne sais plus ce qu’elle disait, et je ne sais même pas si j’écoutais vraiment, mais il y avait quelque chose d’extrêmement digne et de puissant qui en émanait… La présence d’une femme arabe, en résistance, dans des espaces blancs, dans des espaces de déploiement et d’amplification des rapports sociaux de race, c’est quelque chose. Ce sont des moments importants. Surtout qu’à cette période, il y avait très peu d’espaces pour les non-Blancs dont les discours ne coïncidaient pas avec ceux de l’idéologie dominante. C’est toujours le cas mais avec les réseaux sociaux, le développement de médias indépendants, etc, d’autres portes se sont ouvertes et il y a aujourd’hui plein de belles et importantes sources de réflexion.
Qu’est-ce qui a joué un rôle, en plus des événements de 2004 et 2005, dans votre politisation ?
Le rap a joué un grand rôle dans ma politisation. Je n’écoute quasiment que ça. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai fait des études de lettres, je voulais y consacrer une thèse. Et c’est comme ça que j’ai abordé l’enseignement du français quand j’étais prof. T’imagines apprendre à faire une analyse de texte en travaillant un jour sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire et le lendemain sur « Temps Mort de Booba ?» Finalement je n’ai pas fait de thèse mais un mémoire de fin d’études : « Du bitume et des plumes : de la stratégie esthétique du rap français. » En le relisant quelques années plus tard, j’ai trouvé que c’était très naïf et pas assez politique mais il y avait du potentiel et c’est un sujet qui m’intéresse toujours autant. Mais j’ai galéré à trouver un directeur de recherche. J’étais à la Sorbonne et je crois que j’ai fini par envoyer un mail à tous les profs tellement j’étais dépitée. J’avais reçu refus sur refus et la date butoir approchait. Les réponses m’ont scotchée. Il y a ceux qui m’ont dit que ce n’était pas un vrai sujet, qu’il valait mieux que je m’intéresse à de la littérature française, ceux qui ont tout simplement ignoré mon mail et ceux qui m’ont expliqué que c’était scandaleux de proposer un tel sujet dans une fac comme la Sorbonne et que je n’avais qu’à tenter ma chance à Paris 8.
N’avez-vous pas envisagé un sujet qui cadrerait davantage avec la Sorbonne et ne vous fermerait pas les portes, ni à l’université ni après ?
Non, pas du tout. C’est le rap qui m’a menée aux études de lettres. Pas de rap, pas de filière littéraire. Pour moi, c’était indissociable. A chaque fois que j’apprenais quelque chose de nouveau, par exemple en cours de stylistique, j’essayais de le confronter à un texte de rap. Le reste ne m’intéressait pas autant. Suite à tous les mails de refus, j’ai décidé d’écrire au président de la Sorbonne. Il m’a convoquée dans son bureau, on a discuté et il a accepté de diriger mon mémoire. Il était dans un esprit de challenge, du genre : « Je veux bien te donner une chance, même si le sujet ne me parle pas vraiment, mais vas-y convaincs-moi ». Et ça s’est super bien passé. Il m’a même fait évoluer sur la manière de voir, concevoir et poser les sujets et les problématiques. Forcément, la problématique que tu poses au début de tes recherches finit par évoluer. C’est une évidence maintenant mais ça ne l’était pas quand j’ai commencé à travailler mon mémoire. Et j’ai kiffé le cheminement. Un cheminement qui ne s’arrête jamais finalement puisque ce que j’ai écrit dans mon mémoire, je l’écrirais différemment aujourd’hui, il y a des choses avec lesquelles je suis désormais en profond désaccord. Mais bon, j’ai quand même obtenu un 18 avec les félicitations du jury ! Et comme ce qui fait la fierté de la daronne fait ma fierté…
Vous êtes vous déjà engagée dans une organisation politique ou syndicale, à la faculté ou ailleurs ?
Non, jamais. Je n’ai jamais adhéré à un quelconque parti ou syndicat. Et jamais je ne le ferai. Ce n’est pas comme ça que je veux m’engager. J’ai fait mon stage de fin d’études dans une mairie d’arrondissement [Ndlr. A Paris], au cabinet du maire, avec le groupe EELV. La mairie était PS mais je travaillais surtout avec les élus Verts. Quand j’ai fini les cours, un poste s’est libéré et ils m’ont proposé un contrat. J’ai fait mon travail mais sans jamais m’engager politiquement. On était plusieurs chargés de mission dans ce cas. Franchement, ça a été une période super intéressante et formatrice. Ça m’a ouvert les yeux sur le racisme de gauche, et notamment sur l’islamophobie du PS. En France, même si ça a légèrement évolué, on a tendance à penser que le racisme est l’apanage de la droite et de l’extrême-droite, comme si les partis de gauche pouvaient y échapper. Ce n’est évidemment pas le cas. Ce que je comprends, à cette période, c’est qu’une partie de la gauche a un problème particulier avec les musulmans. Elle rêve d’Arabes assimilés, d’Arabes qui ont rompu avec tout ou partie de leur culture, de leur religion, de musulmans « light ». Ça, et tout le reste, m’a définitivement vaccinée de ce type d’organisation.
La première et seule association avec laquelle je me suis engagée c’est le Collectif Stop le contrôle au faciès, en 2012. Le côté très concret et informel m’a plu. Il y avait une revendication claire, sur un sujet important, des manières libres de l’aborder. J’ai beaucoup appris avec le collectif, dont j’ai été l’une des portes-paroles entre 2012 et 2015. Le militantisme c’est une formidable école d’apprentissage et de politisation. Tout n’est pas toujours tout rose, loin de là, mais c’est là qu’on apprend et qu’on se perfectionne sur nos sujets. C’était vrai avec le collectif et ça l’a été encore plus durant les années qui ont suivi, auprès de toutes les organisations et figures de l’antiracisme. Quand je regarde en arrière, je me dis qu’il y a plein de choses sur lesquelles j’ai évolué. Les manières de faire, de penser, de poser les discours, ne sont plus tout à fait les mêmes. Et hamdoullah [Ndlr. Dieu merci], je suis contente du chemin parcouru. Je suis surtout contente des retours que j’ai. C’est un milieu violent et difficile, notamment vu les attaques contre nos mouvements, le manque de moyens, le temps que ça prend etc, mais quand des gens te disent que tu es utile, que tu as permis de faire avancer tel ou tel truc, que le travail que tu fournis est important, ça encourage. Et ce sont des victoires collectives. Ce sont toujours des victoires collectives.
Comment travaillez-vous sur le sujet des violences policières ?
J’essaie depuis quelques années déjà de visibiliser autant que possible les différents cas de violences et de morts dans le cadre d’interventions des forces de l’ordre. Le plus souvent, je suis contactée par les familles, des gens du quartier ou des associations. J’essaie alors de recueillir le maximum d’informations et de témoignages. Qui est la victime ? Où a eu lieu l’interpellation ? Sait-on pourquoi ? À quelle heure ? Y avait-il d’autres personnes ? Des témoins ? Que s’est-il passé exactement ? Et après ? Que dit la police ? Etc. J’essaie aussi de récolter le maximum d’éléments pouvant constituer des preuves. Il y a par exemple de plus en plus de vidéos et c’est très bien, il y en a parfois plusieurs pour une même affaire, prises sous des angles différents. Ces images peuvent s’avérer extrêmement importantes, surtout quand on se retrouve dans des affaires avec la parole de policiers contre celles d’habitants des quartiers populaires, et a fortiori de non-Blancs. Je sais qu’à Bobigny, 80% des affaires de violences policières qui atterrissent sur le bureau du procureur sont ouvertes grâce à des vidéos. C’est énorme. Je sais aussi qu’il pourrait y en avoir beaucoup plus mais que certaines personnes craignent parfois de verser leurs images au dossier de peur de représailles de la part des agents de l’État. Convaincre ces témoins oculaires de diffuser ces images ou de les confier à un média ou une association pour qu’ils puissent le faire, ça fait aussi partie du travail. En tout cas, le travail sur les faits est extrêmement important. C’est un moment crucial qui nécessite rigueur et précision. Une fois que j’ai la réponse à toutes ces questions, ou en tout cas à la majorité d’entre elles, je commence à en parler sur les réseaux sociaux. C’est marrant parce que grand nombre de détracteurs m’y accusent de « relayer sans savoir » ou de « sauter sur la moindre occasion, sans aucun élément, pour critiquer la France ». À chaque fois je me dis « Mais s’ils savaient le taf qu’il y a derrière chaque post !» Et cette rigueur, c’est même pas une rigueur journalistique, c’est une rigueur militante. Parce qu’on ne blague pas avec les histoires de violences policières. Et parce qu’on ne veut pas que nos erreurs aient une quelconque répercussion sur ce combat. Alors, on prend le temps. Sur la mort d’Ange Dibenesha, par exemple, on est plusieurs à avoir été contactés le vendredi 29 mars [Ndlr. Le lendemain du contrôle de police] assez tôt dans la journée. J’avais la vidéo de la maman ainsi que d’autres messages mais j’ai choisi de ne rien diffuser parce qu’il manquait des éléments. Je comprends ceux qu’ils l’ont fait parce qu’il fallait relayer l’appel à l’aide et parce qu’un tel message interroge. J’ai commencé un thread [Ndlr. Série de tweets] dessus après avoir parlé à des proches et après avoir reçu le communiqué de la préfecture. J’essaie de toujours donner les deux versions. Après, je vais être honnête, là où 95% des médias ont tendance à systématiquement croire la version policière, j’ai tendance à la questionner d’emblée. C’est l’expérience qui veut ça. En vrai, c’est ce qu’est censé faire un journaliste, non ? Ne privilégier aucune thèse, respecter le contradictoire, interroger les versions, poser des questions, etc. C’est ce que je fais, quitte à être cataloguée et harcelée. Depuis que la presse a publié l’information selon laquelle Ange Dibenesha aurait « ingurgité 25 grammes de cocaïne », j’ai dû recevoir une centaine de messages me demandant de m’excuser et de supprimer mes tweets. Mais je n’ai pas à en changer une ligne. Je maintiens tout ce que j’ai écrit : à savoir qu’il est mort lors d’un contrôle routier, que selon la version policière il aurait avalé une « substance » désormais identifiée comme de la cocaïne, que c’est ce qui aurait provoqué des convulsions et une crise cardiaque… mais que des questions restent entières. Par exemple, que s’est-il passé durant les 20 minutes de l’interpellation ? Ça veut dire quoi concrètement « ingurgiter 25 grammes de cocaïne » ? Est-ce que la police a usé de la force pour lui faire recracher le sachet ? Peut-être en se mettant sur lui à plusieurs policiers ? Une technique d’interpellation telle que le placage ventral a-t-elle été utilisée ? Je n’affirme pas que la mort d’Ange n’est pas d’origine toxique, elle l’est peut-être, sans doute, mais ça ne dit rien sur les conditions d’interpellation. Ça me fait d’ailleurs penser à un cas sur lequel j’ai travaillé en 2017, la mort de Massar Diaw, un jeune homme mort à la gare du Nord. Là aussi, on a parlé de « pochon de crack ingurgité » et des témoins ont raconté qu’il y avait eu usage de la force. Est-ce que ça a eu un impact sur la dégradation de l’état de la victime ? Ce sont des questions qu’on doit pouvoir poser. C’est en tout cas ce que j’ai essayé de faire ces sept dernières années : visibiliser ces affaires, faire en sorte qu’elles retiennent l’attention du plus grand nombre et veiller à les inscrire dans le contexte et l’Histoire qu’on connaît, c’est-à-dire des pratiques héritées de la colonisation et utilisées pour constamment rappeler à l’ordre social et racial les corps jugés « illégitimes », les non-Blancs donc, et les classes populaires.
Vous considérez-vous comme une lanceuse d’alerte ?
Je ne me suis jamais posé la question et je crois qu’on ne m’a jamais affublée de ce titre. Mais c’est quoi concrètement un « lanceur d’alerte » ? Quelqu’un qui interpelle sur un danger, un scandale, un problème ? Dans ce cas-là, il y en a beaucoup des lanceurs d’alerte autour de moi, mais ils ne sont jamais définis comme tels et quasiment personne n’y prête attention. Si on regarde la définition – sur Wikipédia, mais on va faire avec – on apprend que le lanceur d’alerte est quelqu’un de « bonne foi et animé de bonnes intentions : il n’est pas dans une logique d’accusation visant quelqu’un en particulier mais affirme divulguer un état de fait, une menace dommageable pour ce qu’il estime être le bien commun, l’intérêt public ou général. » Je crois que c’est l’une des raisons pour lesquelles des gens comme moi ne peuvent pas être qualifiés de lanceurs d’alerte. Dans l’imaginaire collectif, les journalistes ou militants de l’antiracisme politique ne sont pas « de bonne foi » et « animés de bonnes intentions », vu qu’ils portent une critique radicale de l’État français. Ça renvoie à tous les débats sur la prétendue neutralité, la pseudo-objectivité, etc. Moi je ne pourrais pas être « objective » en parlant de la police, mais des journalistes blancs, qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question, le seraient. Comme s’ils ne faisaient pas également partie de cette société. Comme s’ils étaient extérieurs aux rapports sociaux de race. Comme s’ils ne bénéficiaient pas, d’une manière ou d’une autre, de ces rapports de domination. Il faut être sérieux. En tout cas, la question de qui est légitime à être considéré comme un lanceur d’alerte est très intéressante ! Même si je sais d’emblée que je ne le suis pas vu que je travaille sur des violences qui sont considérées comme légitimes par une très large partie de la société. Dernière chose, fondamentale : les lanceurs d’alertes pointent ou dénoncent des dysfonctionnements or nous alertons sur le fonctionnement normal des institutions. Les violences policières ne sont pas une dérive, la police joue son rôle. Voilà pourquoi on ne nous fait pas entrer dans cette catégorie.
Comment interprétez-vous les violences policières contre les « Gilets jaunes » ? Les inscrivez-vous dans la ligne droite de ce qui se passait dans les quartiers populaires et dans les dérives de l’état d’urgence ?
Oui et je les inscris surtout dans la droite ligne de la violence d’État qui s’exerce en France depuis des décennies contre les groupes opprimés : les descendants de l’immigration post-coloniale, les anciennes colonies départementalisées et les populations les plus précaires. Ceux qui travaillent sur ces questions depuis des années n’ont pas été spécialement surpris par cette violence, même si la répression est terrible et massive. On savait déjà ce dont l’État est capable pour protéger ses intérêts et les classes dominantes, on assiste simplement à une intensification et un élargissement du pouvoir répressif contre le mouvement social. Ce ne sont pas des comportements individuels déviants dont on parle, c’est un système de domination dont la raison d’être est le maintien de l’ordre racial, social, économique et politique. A ce titre, il faut souligner que si les violences policières contre les Gilets jaunes sont spatialement et temporellement délimitées, ce n’est pas le cas pour les autres groupes sociaux visés. Les violences dont on parle depuis quelques semaines ont généralement lieu le samedi, dans le cadre des manifestations. Ça n’a absolument rien à voir avec les violences qui visent les non-Blancs, les habitants des quartiers populaires et les anciennes colonies. Ces violences-là ne connaissent pas de pause, elles sont quotidiennes et ne visent pas forcément des gens pour ce qu’ils font mais pour ce qu’ils sont. Attention, il ne s’agit nullement de justifier les violences contre les Gilets jaunes, loin de là. Mais il faut qu’on se le dise, lorsque ces manifestants – majoritairement Blancs donc – enlèvent leurs vestons, qu’ils reviennent à leur vie quotidienne, loin de l’effervescence jaune, il y a très peu ou pas du tout de risques qu’ils se retrouvent contrôlés abusivement, frappés, mutilés ou même tués. Tout le monde en France ne peut pas en dire autant. Mais c’est une période intéressante. C’est comme si une partie des Français avait suivi en accéléré une formation-immersion dans le système de la domination policière. Ils n’ont pas tout vu ni tout eu, mais suffisamment pour se poser certaines questions sur les violences donc, le silence médiatique autour de cette question et, à l’inverse, l’hypermédiatisation des attaques contre les biens matériels, la criminalisation des manifestants et des victimes, l’inversion de la charge de la responsabilité, la reprise des catégories fallacieuses « modérés » et « radicaux » pour diviser le mouvement et tenter d’imposer une justification de la violence des forces de l’ordre, le recours à l’armée qui n’a rien d’inédit quand on s’intéresse à ce qu’il se passe parfois en région parisienne ou à La Réunion, Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, etc. En somme, des choses qui sont dénoncées depuis des décennies dans les milieux de l’immigration et des quartiers populaires.
Comment avez-vous perçu l’émergence de ce sujet des violences policières sur les Gilets jaunes dans les médias, sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps ?
Ah… Comme d’habitude ! Un sentiment ambivalent. D’un côté, on ne peut que saluer que de plus en plus de personnes – médias, journalistes, politiques, avocats, etc – s’intéressent à ces questions. C’est vraiment un sujet politique majeur et on ne peut donc qu’espérer une prise de conscience collective. Mais d’un autre côté, là encore, l’expérience est formatrice. On n’est pas dupes. On sait pourquoi ces violences-là intéressent et pourquoi elles jouissent désormais d’une telle couverture médiatique et politique, même s’il a fallu attendre quelques semaines. On sait aussi que tout ça n’aura aucun impact positif sur la manière dont sont traitées les violences policières contre les non-Blancs et les quartiers populaires. Depuis novembre 2018, il y a d’ailleurs eu des tas d’occasion de se mobiliser et de s’intéresser à cette brutalité structurelle… Pourtant, hormis ce qui a été impulsé par quelques collectifs militants, notamment les structures portées par des familles de victimes, ça ne s’est pas fait. Pourquoi ? C’est simple : les violences policières contre les corps indigènes, ces corps illégitimes, sont, au fond, considérées comme légitimes, justifiables et nécessaires.
Êtes-vous sollicitée pour votre expertise sur le sujet ?
Presque pas du tout en France, même si, à la décharge des médias hexagonaux, je refuse depuis quelques années les interviews. Pour plein de raisons que l’on peut deviner d’ailleurs. Mais il peut m’arriver de répondre à la presse étrangère. J’ai reçu pas mal de demandes de médias étasuniens, anglais, allemands ou belges. Je n’ai pas toujours donné suite. Parce que j’estime que sur cet angle précis, d’autres avaient des choses plus intéressantes à dire et parce que j’ai de plus en plus besoin de formats longs. Les réactions qu’on nous demande sont dans un format trop court pour déployer une pensée sur des sujets aussi complexes.
N’assiste-t-on pas à une visibilisation de nouveaux relais sur ces questions, au détriment de figures qui travaillent sur le sujet des violences policières depuis de longues années ?
Oui et non. C’est compliqué. Il y a toujours de nouveaux relais et c’est très bien. La question c’est : qui ? Pour traiter quoi ? Comment ? Et pour quelle réception ? Ce qui est intéressant ce sont les différences de traitement et d’émois provoqués par ces violences. Par exemple, la polémique suscitée par le passage du ministre de l’Intérieur dans l’émission « Au tableau ! » m’a frappée. Il a jugé utile d’expliquer à une classe d’écoliers l’utilisation du LBD [Ndlr. « Lanceur de balle de défense » ou « Flashball »]. Ça a suscité, à juste titre, une large vague d’indignation, « Comment peut-on parler de ça à des gosses ! » Mais que dit-on quand des enfants sont eux-mêmes visés par ces LBD ? En 2011, à Mayotte, un enfant de 9 ans a été éborgné par un gendarme alors qu’il jouait sur la plage. Il ne me semble pas que ça a provoqué une telle émotion. Plus récemment, à l’occasion de la victoire de la France à la Coupe du monde de football, des mineurs ont été éborgnés ou sévèrement blessés au visage par des tirs de flashball. J’en reviens sans cesse à ça parce que je suis sidérée par le manque de réactions. Il y a plein d’autres choses que l’on pourrait relever, comme la différence de traitement médiatique et politique entre le décès de Zineb Redouane et les blessures de Geneviève Legay, on le fera au moment opportun.
Pour en revenir à la question des relais, je pense qu’il y a aussi une dimension liée à la nature des violences que l’on traite. Encore une fois, le problème avec nous, journalistes et militants qui travaillons sur ces questions, c’est que nos enquêtes concernent des violences qui reçoivent, implicitement ou explicitement, consciemment ou inconsciemment, un assentiment quasi général. Ça, c’est la première chose. La deuxième chose, et là encore je me répète, c’est que nous sommes d’office suspectés de partialité, de proximité avec les corps violentés… Comme si on ne pouvait pas traiter les choses honnêtement. Mais personne n’irait interroger la neutralité d’un journaliste blanc, fût-il engagé, qui traite les violences contre le mouvement social blanc. Il y a de vraies discussions à avoir, notamment sur la manière dont les médias ont progressivement construit la figure, quasi providentielle, d’un « homme contre les violences policières » en la personne d’un journaliste indépendant. C’est sans doute trop tôt pour en parler, entre autres parce que les mobilisations ne sont pas terminées, mais c’est important. Évidemment, ce n’est ni le journaliste ni l’homme qui sont visés, c’est pour ça que je ne cite pas son nom. Lui a fourni et fournit toujours un travail utile sur la répression contre les Gilets jaunes, une répression qui a ses spécificités et qui doit être traitée comme telle. Par ailleurs, je ne sais que trop bien ce qu’un tel suivi coûte, en temps, en énergie et en engagement. Ce n’est pas ça que je remets en cause, c’est la construction médiatique et politique de cette séquence, ce sont les discours qui vont avec, les effacements qui vont avec, les choix qui vont avec. Ça, ça impose une discussion critique, à laquelle je compte bien contribuer Inch’Allah.
Quels sont vos projets futurs ? Création de média ? Nouveau camp d’été décolonial ? Autre ?
Il y a plusieurs projets en cours, dont je ne peux pas parler pour l’instant. L’un d’eux est sorti et se construit petit à petit, il s’agit du site medias-etcetera.fr, une plateforme de critique média, mais pas que, avec un gros prisme sur la question raciale. Elle portera et accompagnera d’autres initiatives. Des drôles, parce que ça manque, et d’autres beaucoup moins. Mais ça va aussi dépendre du soutien financier. Les gens ne le savent pas forcément mais tout ce travail est bénévole. Et les gens filent un coup de main bénévolement. Ça marche dans certains cas, ça bloque dans d’autres… Quoi qu’il en soit, ce n’est pas viable. Si on trouve le moyen de financer les projets qu’on a tête, et de se rémunérer, ne serait-ce qu’avec un SMIC, on pourra faire des trucs archi lourds. Lourds de chez lourds même. On verra.
[1]: Lire Ces clivages qui agitent la lutte et les mouvements antiracistes sur Bastamag.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Capture d’écran vidéo « Procès de l’antiracisme politique ». Copyright : Christophe Montaucieux.