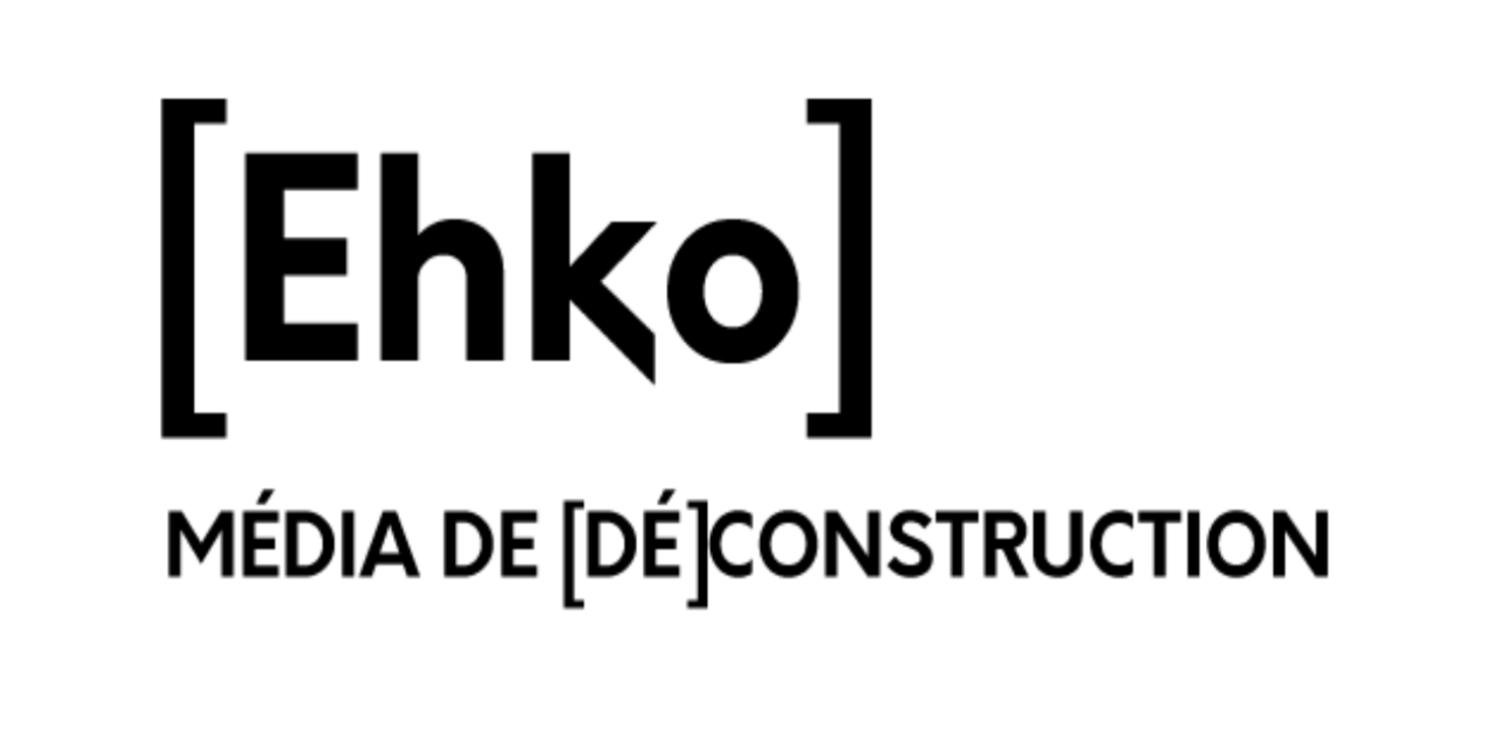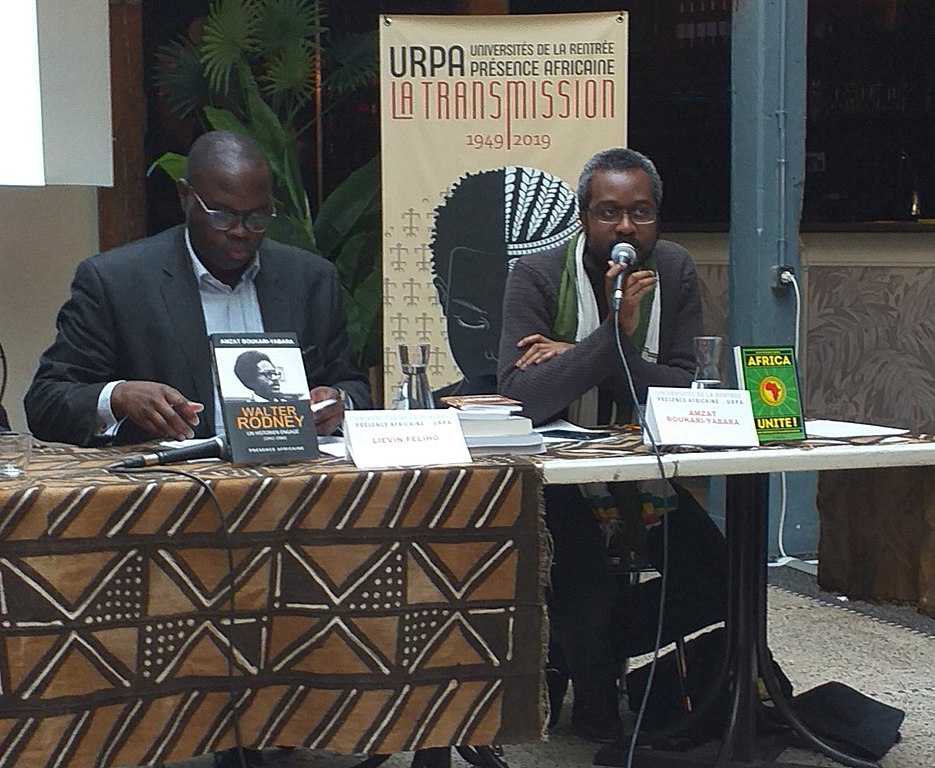Libye, Mali, Rwanda ou encore Biafra. Autant de « crises » africaines d’hier et d’aujourd’hui gérées depuis l’Occident. Pourtant, une alternative existe : le panafricanisme. Une réponse africaine aux questions africaines.
[C’est un lieu commun]. Au chevet des crises à travers le monde se pose toujours ladite « communauté internationale ». Terme qui regroupe au fond, pour peu qu’on s’y arrête, les États occidentaux et plus précisément ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Sans la Chine et la Russie, donc.
La majorité des États subissent beaucoup plus l’ordre international occidentalo-centré tel qu’il est né de la Seconde Guerre mondiale qu’ils n’y participent de façon effective. Pourtant, des ordres internationaux alternatifs ont pu émerger à travers l’Histoire, ordres normatifs et narratifs qui offraient une alternance à l’ordre international occidental.
Parmi eux, le panafricanisme, tant dans sa dynamique politique qui promeut l’indépendance totale du continent africain que dans sa dimension transnationale et civile qui prône la solidarité entre les Africains et les personnes d’ascendance africaine. Comment ce mouvement peut-il éclairer autrement les crises internationales, quelles solutions offre-t-il, quelle est sa dynamique ?
Amzat Boukari-Yabara, historien et docteur à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), auteur de Nigeria (De Boeck, 2013), Mali (De Boeck, 2014) et Walter Rodney (1942-1980) : les fragments d’une histoire de la révolution africaine (Présence africaine, 2018) répond à [Ehko].
[Ehko] : Qu’est-ce que le panafricanisme ?
[Amzat Boukari-Yabara] : Le panafricanisme est un mouvement né dans un contexte précis, celui des résistances qui sont apparues au sein des populations africaines déportées et réduites en esclavage dans les Amériques sous la contrainte du colonialisme, du capitalisme et du racisme. Trois systèmes qui sont encore présents et structurent le monde actuel. Le panafricanisme serait donc une contre-histoire de l’Occident : une réparation par des populations d’origine spécifique (noires et/ou africaines) à travers des projets de libération et d’émancipation de tout ce que l’Occident a produit de dégâts humains, culturels, écologiques. Depuis deux siècles et demi, ces résistances se sont incarnées dans des projets collectifs, des projets d’unité continentale ou des projets d’État-nation. C’est donc un mouvement historique et politique qui participe des relations internationales et qui s’est institué dans des congrès.
Pourtant, ces congrès n’ont jamais été pris en compte dans la structuration de l’ordre international.
Une date marque ce mouvement de destruction par le colonialisme : 1492 avec la « découverte » des Amériques et la mise en place des hiérarchies et concepts raciaux.
Le panafricanisme est aussi un projet d’unité visant à rééquilibrer l’ordre international. Il s’est incarné dans des projets culturels, économiques, politiques et également dans des créations qui lui donnent un caractère tangible dans la diaspora et sur le continent. Le panafricanisme renvoie à tous ces espaces que l’Afrique a fécondés.
En quoi offre-t-il un contre-modèle au système international tel qu’il est ?
Le panafricanisme est apparu comme un grain de sable dans ce système des relations internationales. C’est la tentative de construire un ordre alternatif face au système international qui repose sur l’idée westphalienne d’États. Avec le congrès de Vienne de 1815, l’Europe met en place son système international qu’elle va étendre au reste du monde. Lors de la première conférence panafricaine qui a eu lieu à Londres en 1900, les militants essaient de coaliser Haïti, le Liberia et l’Éthiopie, qui à l’époque étaient les trois seuls États dirigés par des Noirs, pour leur demander de parler au nom de tous les Noirs qui n’avaient pas accès à un appareil d’État.
La question du panafricanisme a souvent été mise de côté car considérée comme étant de l’ordre du ressentiment. Les dirigeants qui l’ont incarnée, de Kadhafi à Sankara, pour citer deux cas assez récents, ont fini de la même manière [Ndlr. Assassinés dans des conditions encore obscures]. Leur refus de considérer l’Occident comme le centre du monde révèle une forme de blessure narcissique des Occidentaux hostiles à l’idée d’un autre monde possible. L’Occident n’aime pas qu’on lui fasse la morale et infantilise le reste du monde.
Mais le panafricanisme n’est-il pas contraint par un système international dont l’acteur principal reste l’État ?
La question de l’État-nation va s’imposer tout simplement parce que l’histoire de la colonisation va modifier la manière dont les structures étatiques et politiques africaines fonctionnaient. En Afrique, il y avait des empires, des royaumes, des cités-États, des républiques et également des sociétés sans État. L’Occident n’aime pas qu’on lui fasse la morale et infantilise le reste du monde. Le système colonial a imposé le modèle de l’État-nation qui a été perpétué au moment des indépendances. Le mouvement panafricaniste va accompagner les mouvements de décolonisation du XXe siècle en quête d’un État indépendant. Le panafricanisme s’incarne aussi dans les mouvements sociaux et les sociétés civiles car les États africains ne font pas de la lutte contre le capitalisme, le colonialisme et le racisme leur axe idéologique. Ils sont beaucoup plus dans la volonté d’intégrer l’Afrique dans la mondialisation.
Ces mouvements sociaux de la société civile estiment que la souveraineté et certains combats pour l’émancipation ont été capturés et oubliés par les élites. Le panafricanisme s’incarne donc en dehors des structures institutionnelles. Il tend vers ce que j’appellerais les « secondes indépendances », questionnant la dette, le commerce international, les mécanismes qui rognent la souveraineté des États. C’est l’axe politique du panafricanisme.
Vous semblez faire de l’indépendance de Haïti en 1804 et de la réaction des États européens, qui ont imposé une « dette de l’indépendance » pour compenser la perte de la colonie, un paradigme encore actuel…
L’indépendance de Haïti marque la première décolonisation de l’histoire d’un peuple du Sud. Cette notion d’indépendance apparaît. Haïti s’oppose à la France, l’Espagne, l’Angleterre, la Prusse, les États-Unis, donc un embryon de communauté internationale. La particularité de Haïti est qu’elle a été une révolution qui sublime la révolution française et met en application ses idéaux – contrairement à la France, qui connaîtra une contre-révolution puis un ordre napoléonien de restauration de l’esclavage. Le principe de la révolution de Haïti est d’aider ensuite d’autres révolutions émancipatrices. Simón Bolívar, par exemple, va y trouver un appui financier et des armes pour libérer la Grande Colombie de la domination coloniale espagnole. Il y a donc très tôt un lien entre le panafricanisme et le bolivarisme.
Haïti est la naissance à l’échelle internationale du mécanisme de la dette puisque le pays se verra imposer le paiement d’une dette en échange de son indépendance. Cette dette s’accompagne de menaces d’embargo et de recolonisation militaire qui obligent le pays à s’armer. Ce paradigme se poursuit jusqu’à nos jours.
Avec cette approche panafricaniste, comment comprendre la guerre contre la Libye ? Vous dites qu’on ne mesure pas à quel point la guerre dans ce pays a été racialisée…
Les négociations menées par la France et la Grande-Bretagne sous forme de pressions et d’ultimatums ont fait fi de toutes les propositions de médiation et de résolution faites par les dirigeants africains. Ceux qui ont voulu dire à ces deux pays qu’il s’agissait d’une affaire africaine ont été rabroués avec une forme d’arrogance, de racisme et des menaces très fortes. Ceux qui ont voulu dire à [la France et la Grande-Bretagne] qu’il s’agissait d’une affaire africaine ont été rabroués avec une forme d’arrogance, de racisme et des menaces très fortes. L’idée sous-tendue par l’Occident est que l’Afrique du Nord ne relève pas de l’Union africaine mais du Conseil de coopération du Golfe ou de la Ligue arabe. On a ainsi neutralisé les propositions de solution africaines dans une crise exogène qui allait avoir des conséquences sur tout le continent africain.
Ensuite, dans la manière dont la guerre a été menée, on a fait comme si la Libye était un pays isolé alors qu’elle s’inscrit dans un ensemble continental africain. Or, le panafricanisme suppose que quand on s’attaque à un pays africain, c’est toute l’Afrique qui est attaquée. En outre, la géopolitique africaine de la guerre en Libye a été totalement effacée par le traitement médiatique et politique de la crise. Notamment, la question du poids économique de ce pays vis-à-vis des pays sahélo-sahariens. Ce poids a été falsifié par la construction de discours migratoires. Il y avait un à deux millions de travailleurs subsahariens avant la guerre en Libye. Or, les moyens de production de ce pays ont été détruits, ce qui a laissé ces personnes sans ressources, comme leurs familles. Il ne s’agissait pas simplement d’assassiner un dirigeant qualifié de dictateur par des dirigeants occidentaux qui n’ont rien de démocrate, mais de détruire un pays. Dans la logique nationale qui a traversé les combats, ces travailleurs noirs ont très vite été assimilés à des mercenaires de Kadhafi. Comme s’ils ne pouvaient être que cela. Qu’ils l’aient été ou pas, ils y ont été assimilés, avec des représailles.
La Libye n’était pas parfaite, mais la gestion des groupes ethniques par Kadhafi permettait un certain type d’équilibre qui a été balayé. En cela, il y a eu une dimension racialiste avec une construction de la division des populations libyennes alors que c’est l’État qui les faisait tenir ensemble. On a détruit cet État selon un processus de balkanisation puis on a attribué aux populations des haines interethniques pour faire de la partition du pays un élément de solution. C’est le retour des vieux récits colonialistes.
La crise migratoire a aussi racialisé la question de la migration. D’abord, en classifiant les migrants en fonction de leur couleur. L’idée est apparue dans les médias et ONG de présenter les migrants syriens fuyant Bachar Al-Assad comme de « bons migrants » et ceux fuyant la Libye en guerre, majoritairement noirs, comme une menace pour l’Europe.
En outre, ces deux pays ont été le terrain de guerres et destructions par procuration. La guerre asymétrique a alimenté des réseaux et mouvements rebelles qui ont récupéré les armes libyennes mais aussi les armes laissées par la coalition [Ndlr. composée principalement de la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, sous l’égide de l’OTAN et de l’ONU]. La création d’une situation d’insécurité et d’instabilité ne pouvait que permettre de justifier la construction de la menace terroriste, et donner à des groupes l’opportunité de trouver là un terrain d’entraînement. On a aussi fait de l’assassinat d’un chef d’État un simple détail alors que c’est aussi un acte terroriste.
Cette guerre a eu des complicités médiatiques criantes car elle a d’abord été une entreprise de communication. Un récit a été construit dans lequel les médias se sont engouffrés. Le système français pose aussi question car on peut entrer en guerre sans consulter le Parlement.
Et pour le Mali ?
Pour le Mali, le récit a été construit autrement pour présenter [l’ancien président] François Hollande en sauveur alors que les manifestants maliens protestaient aussi contre les soldats français. L’opinion française reste prisonnière d’un récit colonial qui veut que la France soit pure, inattaquable et intervienne pour maintenir l’ordre. Il est très compliqué de remettre en cause ce récit, au risque d’être taxé d’ennemi de la République. Le Mali apparaît comme une histoire de famille. On construit un récit d’un Mali se battant contre les « rebelles » ou les « djihadistes », sans contextualisation, sans aucun lien avec la Libye. Alors que le Mali est une continuité de ce qui se passe en Libye en matière de politique coloniale. Cette présence française participe de la politique impériale de la France.
[Apostille] : Cet entretien est paru initialement sur Middle East Eye
Illustration : Amzat Boukari-Yabara à droite de l’image. Table ronde « Du panafricanisme à l’afroscepticisme ». Paris, Octobre 2019. Crédit : Azaromérique.