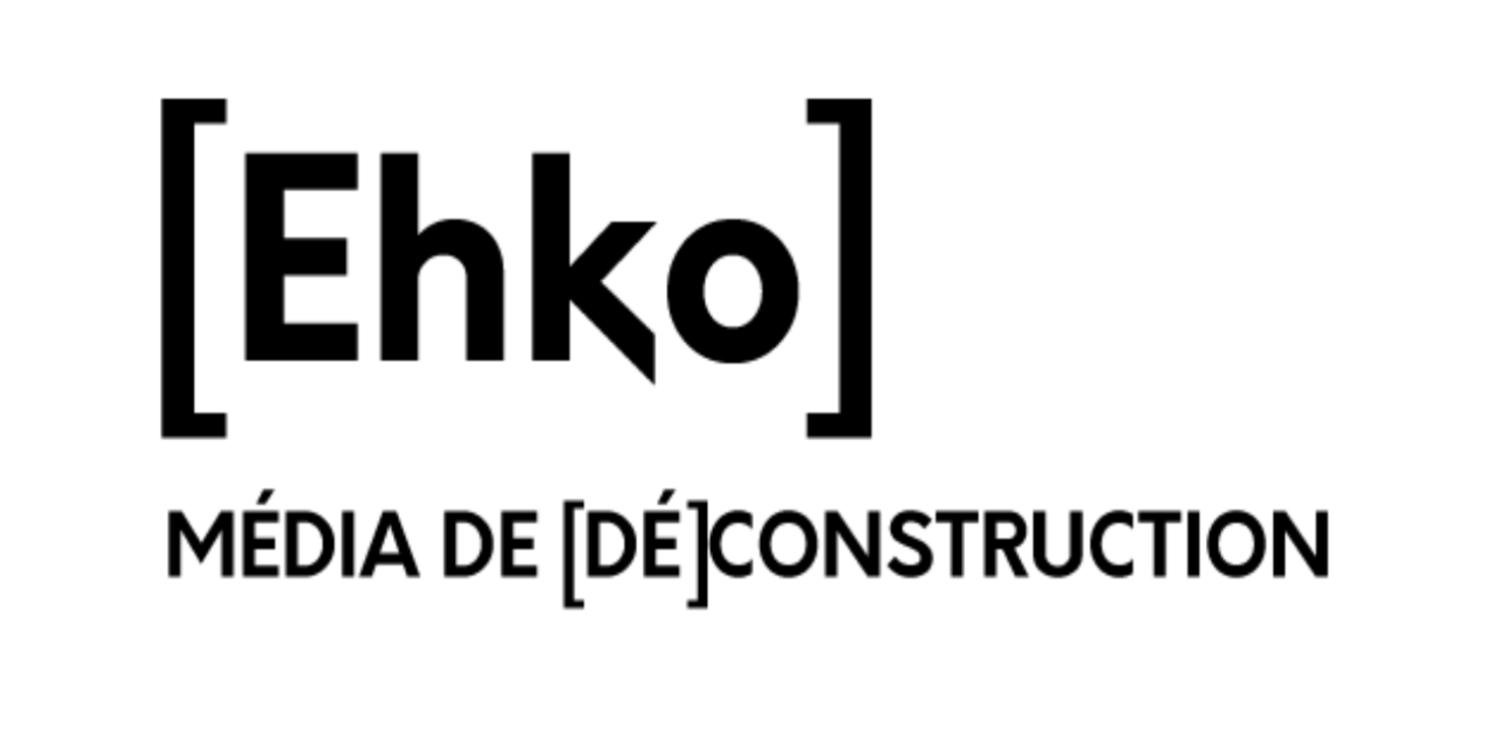[Les mouvements sociaux] se multiplient dans le monde. Leur répression prend appui sur un ordre sécuritaire né de la nécessité de l’application d’un ordre libéral de plus en plus contraignant. En cela, la dite « lutte contre le terrorisme » a pu offrir un arsenal législatif utile à ces répressions sociales.
Un enfièvrement mondial (ou presque)
Le monde s’enfièvre-t-il en luttes sociales ? De Bagdad à Beyrouth, de Paris à Santiago, d’Alger à Quito s’égrènent des manifestations et crises sociales d’abord jugées comme sporadiques et qui pourtant durent. Un paradigme semble même se dessiner. D’abord un pays chauffé à blanc par une situation économique mauvaise ou morose. Sur ce terreau, une colère se cristallise après une décision publique apparemment en peccadille budgétaire. Cette colère s’approfondit et s’élargit à d’autres doléances en suspens. S’en suit une réponse autoritaire de l’Etat, avec l’armée déployée qui vient s’ajouter au maintien policier de l’ordre.
Au Chili, cette « irruption sociale » est venue d’une augmentation anodine du ticket de métro. Le feu social s’est propagé dans le pays, même dans des endroits ne disposant pas d’infrastructures métropolitaines. Une révolte généralisée qui a pris pour cible la politique économique et sociale du gouvernement de droite nommé par Sebastian Piñera. L’État d’urgence et un couvre-feu militaire ont été instaurés, et des militaires ont patrouillé dans les rues pour la première fois depuis la fin de la dictature en 1990.
Au Liban, ce fut l’instauration d’une taxe « WhatsApp » qui mit la population en colère. Cette taxe devait venir financer le déficit abyssal du pays qui atteint plus de 150 % du PIB. Dans un pays où le coût des communications est l’un des plus élevés au monde, l’annonce a eu l’effet de la goutte de trop dans des limbes pourtant insondables d’incurie politique. A cette colère libanaise sont venues s’agglomérer d’autres revendications contre la corruption et l’incapacité d’une classe politique qui, en quelques années, a fait d’un pays considéré comme la « petite Suisse » orientale un pays au bord du gouffre économique. Devant les manifestations toujours plus fortes, le président Michel Aoun avait appelé le commandant de l’armée du pays à rétablir l’ordre, tenant aussi de réunions d’urgence avec le ministre de l’Intérieur comme avec celui de la Défense. Là encore, l’armée a été déployée à l’intérieur des frontières libanaises, avec des niveaux de violence dont Amnesty International s’est déjà émue.
En Equateur, c’est après l’annonce de mesures économiques du gouvernement du président Lenin Moreno que la population s’est enflammée. La plus impopulaire a été la suppression de la subvention aux carburants qui, en multipliant le prix à la pompe par deux, aurait de façon mécanique augmenté les prix des produits de consommation de base. S’en est suivie une grève générale des transports. Et là encore l’instauration d’un état d’urgence avec déploiement de militaires et de policiers.
Qu’ont en commun ces trois pays (et d’autres tels la France, l’Argentine, la Tunisie, en un sens l’Algérie…). Tous ont pris l’engagement de restructurer leurs politiques économiques, donc sociales, selon une orthodoxie libérale portée par des instances internationales telles le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale ou les instances européennes pour la France. Ces institutions financières internationales prêtent aussi de l’argent à leurs pays membres en proie à des difficultés économiques. Mais cet argent n’est pas « gratuit ». Il se paye en contreparties lourdes faites de politiques d’ajustement structurel, de cahier des charges qui prévoit une mise au pas ordo-libéral du marché du travail, du marché intérieur national, d’ingérences dans les choix de politique économique. Parmi ces mesures normatives, figurent souvent la dévaluation de la monnaie du pays et la libéralisation des prix des produits de base. Ceux-là même qui, subventionnés par l’Etat, sont consommés par les plus pauvres. Conséquences de cette orthodoxie financière comme credo ? Le risque de l’anathème futur en cas d’écart de la doxa. Mais aussi un marché intérieur ouvert aux quatre vents, un Etat factotum de décisions prises hors tout choix démocratique et impulsée depuis les centres névralgiques du pouvoir économique mondial. Une coupe réglée des dépenses de l’Etat qui limite de facto et de jure la souveraineté de l’Etat.
L’Etat privilégiera aussi les coupes dans les dépenses sociales plutôt que dans les dépenses régaliennes (police et armée) qui le structurent encore comme source de violence légitime. Car il faut bien que ce bras armé subsiste, voire soit renforcé, pour contrer tout mouvement de la population en opposition à ces restructurations, qui n’ont de structurantes d’ailleurs que le nom. Yanis Varoufakis révèle ainsi dans son livre, Conversations entre adultes, qu’au plus fort des négociations sur la dette grecque, jamais la Troïka européenne n’avait voulu imposer une réduction du budget militaire de la Grèce, pourtant le quatrième d’Europe. Mais elle avait traqué toutes les dépenses sociales de l’Etat, au risque d’une colère du peuple grec… qu’une armée maintenue en sa puissance aurait alors pu contenir.
C’est en échange d’un prêt de 4,2 milliards de dollars du FMI que l’Equateur avait pris des mesures impopulaires d’augmentations diverses. Au Liban, après la démission du gouvernement de Saad Hariri, appel fut fait à des bailleurs internationaux qui promirent 11 milliards de dollars. En contrepartie évidemment de réformes structurelles, de coupes budgétaires et de la mise en place d’un gouvernement dit de technocrates pouvant engager des réformes « d’urgence ». Mais « l’urgence » de ces bailleurs mondiaux n’est sans doute pas la même que celle de la population libanaise.
Le Chili, quant à lui, a une histoire douloureuse liée aux recettes néolibérales de l’école de Chicago. C’est dans ce pays que les « Chicago boys », adeptes des théories de l’économiste Milton Friedman, avaient appliqué sous la dictature de Pinochet leurs méthodes économiques brutales : privatisations à marche forcée, libéralisation de l’économie au pas militaire, réduction du rôle économique et social de l’Etat au profit d’une dictature militaire sans merci. Au fur et à mesure que l’Etat protecteur porté par Allende était sapé, l’Etat sécuritaire s’élargissait. Tout un pays fut mis au pas par une politique économique qui avait toutes les apparences d’une férocité sociale rarement atteinte. Si le pays est désormais devenu démocratique, il est resté inégalitaire. Une société en strates sociales profondément marquée par des décennies de politiques économiques ultra-libérales. Et c’est avec cette histoire douloureuse en contrepoint que, dans un climat insurrectionnel, le chef de l’Etat chilien actuel a pu parler de « guerre ». Comme si un ennemi intérieur menaçait le pouvoir. Des chars ont aussi été déployés dans les rues, en extension du domaine de la guerre vers l’intérieur du pays. L’histoire patinait et bégayait.
Extension du domaine de la guerre sociale
Le développement du capitalisme s’est accompagné en la croyance quasi magique que le « doux commerce » cher à Montesquieu ne pouvait que pacifier les rapports sociaux et les liens et la richesse entre les Nations. Cette idée « libérale » établissait un lien quasi irréfragable et automatique entre libéralisme économique et libéralisme politique. Pourtant dès 1933, quatre ans après la crise économique mondiale de 1929 et année de l’avènement au pouvoir de Hitler, l’économiste Friedrich Pollock notait que « ce qui se termine, ce n’est pas le capitalisme mais seulement sa phase libérale. Sur les plans politiques, économiques et culturels il y a aura à l’avenir pour une majorité d’hommes encore moins de liberté ». Selon la prédiction de Pollock, les deux libéralismes, économique et politique, iraient s’opposant de façon toujours plus frontale. Au lieu d’une convergence harmonieuse, les normes démocratiques (élections, séparation des pouvoirs, souveraineté) ne pourraient qu’entrer en collusion avec les normes économiques. Deux ordres en conflit. Yanis Varoufakis rapporte ainsi que lors d’une réunion de l’Eurogroupe portant sur la situation grecque, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble avait déclaré : « Les élections ne peuvent pas changer quoi que ce soit. Si à chaque fois qu’il y a une élection les règles changeaient, l’Eurozone ne pourrait pas fonctionner ». Une variante de la remarque de Jean-Claude Juncker, « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Le paradigme appliqué à la Grèce éclatait là dans sa brutale crudité : entre les principes démocratiques et l’ordre économique, le second prévaudrait toujours.
Dans un monde saisi par l’ordre économique libéral, la puissance publique se trouve concurrencée, voire dépossédée de ses outils de régulation économique et sociale. D’abord par le biais de règles auto-générées d’un ordre économique mondial dans lequel tout Etat s’inscrit forcément par ses échanges. Ensuite par les instances « régulatrices » de ce même ordre que sont le FMI ou la Banque mondiale. Ou pour l’Europe, par la politique économique et monétaire. Par contrecoup de cette dépossession, le champ d’action de l’État ne peut dès lors que se concentrer, par effets quasi mécaniques, sur les questions sécuritaires. C’est en effet là que son autorité peut se justifier et se légitimer. Par l’investissement autoritaire, il s’agit d’établir que la puissance publique agit et peut agir encore, occulter en monstration autoritaire l’impuissance croissante de l’Etat sur les politiques économiques.
De façon tout autant mécanique, cet ordre économique supranational induit toujours plus d’Etats autoritaires. Que ces Etats soient en adéquation avec cet ordre économique ou qu’ils soient en réaction contre ce même ordre. Dans cet ordre économique mondial et normalisé, le rôle de l’Etat sera moins de protéger leur population contre ces normes économiques déstructurantes que de veiller précisément à leur application. Y compris malgré et contre leur propre population. L’Etat comme rapport de souveraineté et de protection sociale de sa population perd alors en consistance au profit d’un Etat qui s’autonomise par rapport à sa société et sa population. Le pouvoir y devient verticalisé en rapports autoritaires indépassables au fur et à mesure que la politique économique de l’Etat lui échappe au profit d’instances mondiales. C’est un « Etat stato-financier » (selon l’expression d’Emmanuel Todd) séparé, en quasi autonomie. Voire indifférence envers sa population, une fois passée l’élection comme simple procédure qui va apporter le vernis démocratique et légitimant, dans la fiction encore nécessaire de démocratie. Grégoire Chamayou a pu aussi le décrire dans La société ingouvernable : « Le néolibéralisme n’est pas animé d’une « phobie d’État » unilatérale. Les stratégies déployées pour conjurer cette crise convergent bien plutôt vers un libéralisme autoritaire où la libéralisation de la société suppose une verticalisation du pouvoir. Un « État fort » pour une « économie libre » ».
Cette notion de guerre et d’ennemi est profondément interrogée par le développement de ce libéralisme atopique. Car si la tension que porte le libéralisme a pu aussi être projetée à l’extérieur des frontières à travers la guerre entendue comme conflit avec un autre pays et une autre population, entrons-nous dans une phase d’une guerre de tous contre tous désormais étendue à l’intérieur même des frontières d’un même Etat ? C’est toute la polarisation « ami-ennemi » qui selon le philosophe du droit Carl Schmitt imprime le fait politique, qui est ainsi reposée dans sa forme ultime : celle du polémos. De la guerre donc, avec un brouillage croissant de la notion d’ennemi, de frontières et du rôle de l’Etat. Dans un excellent article, Le Moment Tchatcher d’Emmanuel Macron, le journaliste de Mediapart Romaric Godin rappelle ce que furent les grèves des mineurs sous le gouvernement Thatcher. « Margaret Thatcher n’hésite pas à comparer les grévistes aux Argentins qui, en 1982, ont envahi les Malouines. Désormais, elle mène la bataille contre « l’ennemi de l’intérieur » ».
Cette idée de brouillage ou de renversement du polémos vers l’intérieur des frontières se retrouve en France dès 2008, dans le Livre blanc de la Défense. A côté du classique concept de « Défense nationale » se glisse alors l’étrange notion de « sécurité nationale ». Ce véritable carnet de route de l’armée prévoyait la mise à disposition de 10 000 soldats, en cas de crise interne, ainsi que la création du conseil de défense et de sécurité nationale, sous l’autorité du président de la République. Emerge ainsi un continuum entre défense nationale et sécurité intérieure, sans plus que ne subsiste une séparation étanche.
De la guerre contre le terrorisme à la guerre sociale, le cas français
Naomi Klein avait montré dans La stratégie du choc comment les désastres, qu’ils soient naturels ou provoqués, avaient permis aux apôtres du capitalisme d’appliquer leur doctrine et politiques que l’essayiste canadienne qualifie d’ultra-libérales. Elle note ainsi que c’est à la faveur de divers désastres que l’école économique de Milton Friedman a pu diffuser sa doctrine ultra-libérale à coup de privatisation de l’énergie ou de la sécurité sociale dans certains pays. Les politiques menées aux États-Unis, plus particulièrement sous l’administration Bush, sont symptomatiques de cette stratégie du choc. Les attentats du 11-Septembre ou encore l’ouragan Katrina auraient été utilisés comme des chocs « utiles » qui ont conduit, par exemple, à la privatisation progressive de la sécurité aux États-Unis, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Le terrorisme, ou plutôt la lutte déployée contre ce phénomène volatile, a été la voie royale qui a permis la mise en place d’une architecture légale et sécuritaire, échafaudage de mesures d’exception pérennisées. Cette architecture sécuritaire a pu être aussi utilisée comme moyen de contrôle permanent de tout désordre sociale et politique dans certains pays. En Tunisie, depuis la révolution de 2011, de régime dérogatoire l’état d’urgence est devenu quasi-permanent. Le terrorisme, la situation dans la Libye voisine, ont justifié ces mesures qui se sont élargies au fur et à mesure des soubresauts internationaux. Ce dispositif est désormais en vigueur de manière presque continue. Pour mémoire, cet état d’exception effectif avait été utilisé pour réprimer la grève générale déclenchée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) en 1978, les « émeutes du pain » en 1984 et la révolution en 2011. Après 2011, son approfondissement législatif a été concomitant de politiques économiques menées afin de répondre aux exigences des bailleurs mondiaux tels le FMI et la Banque mondiale. Pour l’International Crisis Group, « depuis 2016, la dégradation sensible des fondamentaux économiques augmente la probabilité d’émeutes incontrôlables ». Cette corrélation entre la mise sous perfusion économico-normative d’un Etat et la création ou approfondissement d’un arsenal législatif et sécuritaire se retrouve aussi en Egypte. Sous l’injonction d’assainir ses dépenses, l’Etat égyptien a réduit ses dépenses publiques globales, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Depuis 2011, le pourcentage d’Égyptiens vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 25,2 % à 32,5 %. Parallèlement, l’armée a continué de s’imposer comme un acteur économique incontournable et la clef de voûte d’un système politique et sécuritaire ultra-autoritaire. Rétabli en avril 2017, après deux attentats visant la communauté copte, l’état d’urgence a été prolongé pour la neuvième fois en juillet 2019. Les mesures d’exception qu’il permet ont servi à réprimer les mouvements aux revendications tout autant économiques que politiques de septembre 2019. Plus le pays est mis sous la coupe financière du FMI et de la Banque mondiale, plus la dite « lutte contre le terrorisme » est agitée par l’Etat.
Et la France dans tout cela ? Après le choc continu qu’ont été les attentats de 2015, l’état d’urgence a été instauré. Cet état d’exception confère à l’administration des pouvoirs extraordinaires. Il a été prorogé six fois, portant à près de deux ans son application – du jamais vu depuis la guerre d’Algérie. Tel qu’il a été instauré en France, il porte tout entier l’empreinte de la « guerre contre le terrorisme ». Depuis le 11 septembre 2001, le concept flou de terrorisme est devenu le nouveau paradigme qui permet d’analyser le monde. L’ennemi y est insaisissable – puisque, par définition, le terrorisme est un concept et non une entité humaine. Plasticité de la figure de l’ennemi qui permet de revêtir ainsi des identités successives. Se crée ainsi la possibilité d’une guerre mouvante, fluide. Le terrorisme était de fait le concept parfait pour une guerre perpétuelle.
Fort de ce précédent idéologique, François Hollande avait qualifié les attentats d’« actes de guerre » auquel il a répondu par l’état d’urgence. Là encore, le brouillage de la notion d’ennemi ne pouvait alors que suivre cette logique esquissée par le chef de l’État. Si la guerre est aussi intérieure, qui est l’ennemi ? Tout entrait alors en confusion : guerre à l’intérieur, opération de police à l’extérieur, armée déployée dans les rues de Paris tout autant que dans le ciel irakien et syrien. La réponse apportée, l’état d’urgence, a interrogé de façon presque automatique les rapports structurels qu’entretiennent la violence d’État, la mondialisation de la question du terrorisme et la gestion intérieure des populations. Car très vite, dans l’utilisation effective des mesures de l’état d’urgence, s’est constatée une utilisation opportuniste : assignation de militants écologistes pendant la COP21 ou encore interdictions individuelles de manifestation prises à l’encontre de militants opposés à la Loi Travail El Khomry. Ce régime juridique d’exception a donc été utilisé sciemment contre des mouvements d’opposition à des lois jugées antisociales. Il est frappant de noter que l’état d’urgence s’est construit presque en équivalence avec et contre ces mouvements sociaux. Mais aussi en parallèle à des expériences, telles les ZAD, où furent utilisées ces mêmes armes de guerre (grenade de désencerclement, qui sont des grenades offensives) qui sont désormais le lot quotidien des manifestations contre ladite « réforme » du régime des retraites. Si l’arme utilisée définit la nature de tout conflit, ces grenades qui pleuvent désormais sur les manifestants marquent cette gestion en polémos du conflit social national.
Ce régime d’exception a été précisément le moment pivot où l’ordre libéral s’est confondu avec un ordre sécuritaire justifié ainsi par la lutte contre le terrorisme. En même temps que ces mesures sécuritaires, en concomitance législative significative, étaient adoptées des lois de libéralisation du marché de l’emploi, des mesures fiscales ultra-favorables aux entreprises sur fond de politique d’austérité budgétaire afin de répondre aux exigences ordo-libérales de l’Europe. Loi travail et loi de lutte contre le terrorisme seront d’ailleurs votées en quasi-concomitance, en télescopage législatif symbolique.
L’introduction de certaines mesures de ce régime dans le droit commun, en pérennisation, a été une des premières mesures du président Macron. L’inscription dans le droit commun de certaines mesures de l’état d’urgence a donc, en dehors de toute situation de terrorisme ou de danger pour la nation, offert aux pouvoirs publics une formidable machine coercitive. L’état d’urgence s’est avéré un processus de normalisation de mesures sécuritaires généralisées. Un état d’exception effectif qui fonctionne désormais hors de toute urgence et nécessité liées au terrorisme.
Plus largement, un esprit de l’état d’urgence, fait de logique de suspicion (le principe de précaution) et d’ordre sécuritaire, a infusé le droit pénal français et s’est hybridé en diverses mesures élargissant les pouvoirs en matière de contrôle des populations. L’état d’urgence a-t-il été un laboratoire qui aura permis à l’État de tester in vivo des mesures de police administratives restrictives de libertés, notamment dans l’espace public ? La question mérite d’être posée et Michel Foucault l’a montré : la question de la puissance publique, celle de l’État, ne sera plus celle du droit de vie ou de mort, ou de la violence légitime, mais celle de la gestion de la vie humaine. Autrement dit la question du pouvoir de mettre la vie de chacun sous tutelle, notamment dans l’occupation de l’espace public.
Dès 1975, Samuel Huntington, avec ses co-auteurs Michel Crozier et Joji Watanuki, disait peu ou prou la même chose dans un rapport fondamental pour comprendre l’actuel. Il n’est pas anodin que celui qui fut considéré comme le père du « Choc des civilisations », théorie qui fournit la base idéologique de la dite guerre contre le terrorisme, fut aussi celui qui annonça la fin inéluctable de l’Etat-providence. Dans une démocratie toujours plus inclusive notent les auteurs, « les gens ne se sentent plus contraints d’obéir à ceux qu’ils avaient autrefois considérés comme supérieurs à eux-mêmes en âge, rang, statut, expertise, caractère ou talents ». Une déferlante d’exigences démocratiques menace alors, selon ce rapport, les structures du pouvoir, leur efficacité et leur autorité. Car les citoyens ont des « revendications » intenables. Alors, glisse ce rapport, « parce qu’ils insistent pour que davantage d’actions soient prises pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, plus de contrôle social est nécessaire ». Selon les auteurs, la fin de l’Etat-providence ne pouvait aboutir qu’au déploiement contre ses propres populations de dispositifs de guerre.
La crise des Gilets jaunes (commencée, faut-il le rappeler, en raison d’une hausse du prix du diesel) tout comme les mouvements sociaux contre l’uniformisation de la retraite à points ont été l’occasion d’une réponse violente de l’Etat. Le vocabulaire utilisé contre ces mouvements porte aussi l’empreinte de ce « paradigme terroriste » puisque des mots comme « radicalisation », « radicalité », « extrémisme violent » ont pu être utilisés pour qualifier (et disqualifier) ces mouvements pourtant sociaux. Les coupures d’électricité qui ont émaillé ces mouvements sont, selon les mots de certains médias, « revendiquées par les syndicats ». Comme pour un attentat terroriste. La quasi seule réponse de l’Etat a été celle de l’ordre et de la police. Pas politique, ni sociale. Sécuritaire. Comme si l’Etat ne pouvait plus intervenir que sur ce seul plan, en monstration sidérante. L’incapacité, voire impossibilité pour l’Etat français à admettre les violences policières n’est peut-être pas seulement cécité ou mauvaise foi. Elle indique aussi que la gestion de l’espace public glisse vers cette violence normative et normalisée de la relation politique. L’État sécuritaire serait-il ainsi devenu, selon le mot de Baudrillard dans L’esprit du terrorisme, le « prolongement de l’absence de politique par d’autres moyens » ?
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration: Composition, Policiers et Le Penseur de Rodin. Crédit : Creative Commons Zero – CC0