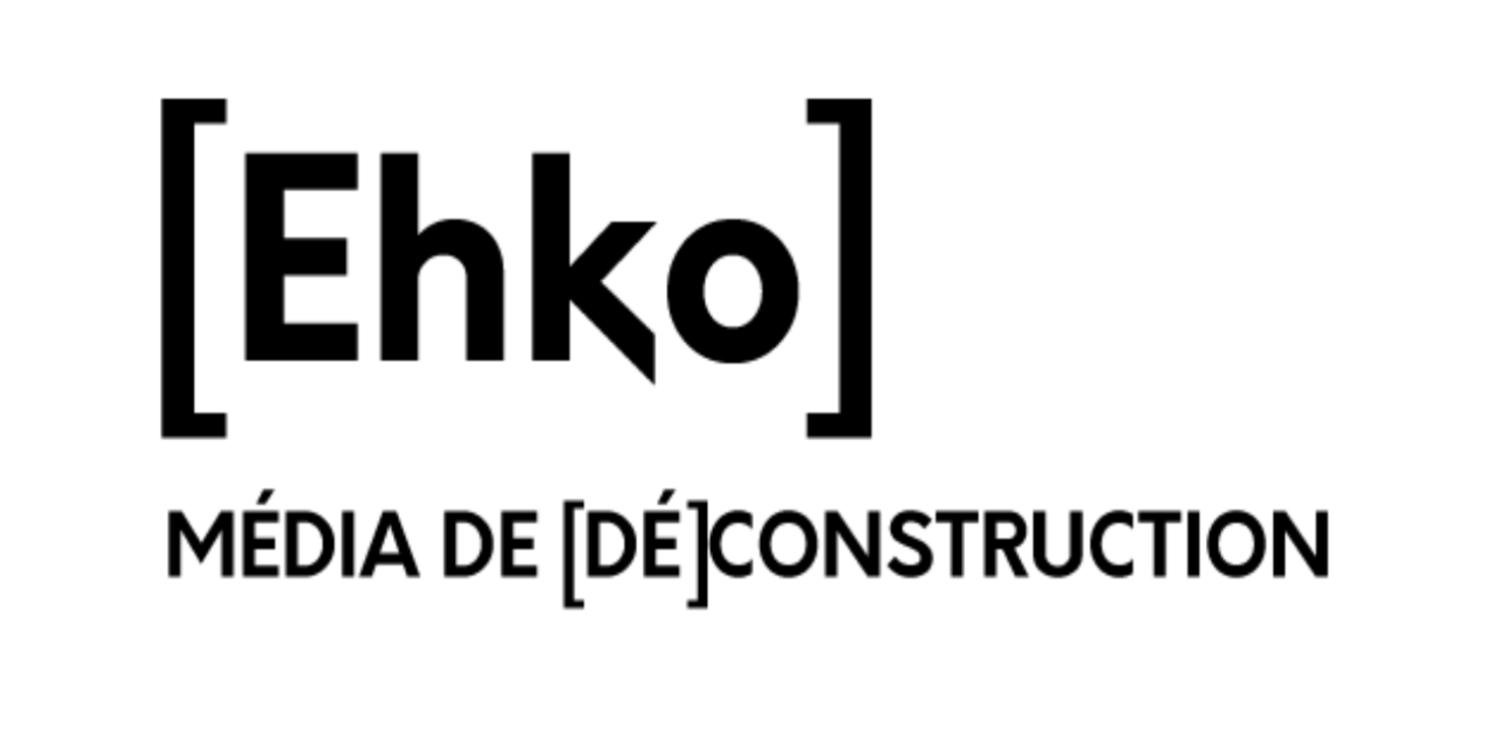« Enfants à (ne pas) adopter » : en 2005, le magazine Courrier international consacrait un numéro à la question de l’adoption suite au tsunami de décembre 2004. En Une, une petite fille vêtue de rose, aux couettes défaites, probablement issue des pays dévastés par cette catastrophe naturelle. Cette accroche, saisissante, allait à l’encontre du discours habituel sur l’adoption : il évoquait la dimension politique de cette démarche. C’est aussi le but de la réalisatrice Amandine Gay qui veut ouvrir le débat en France.
[Le travail d’Amandine Gay] sur les femmes noires et celles qui se désignent comme « afroféministes » a participé à faire émerger ces sujets dans l’espace médiatique et politique français. Son film « Ouvrir la voix » (OLV) sorti en 2017 est le premier film français autoproduit et auto-distribué parvenu à obtenir une sortie nationale, dans 11 salles. Il a enregistré « 17 000 entrées, 20 0000 à travers le monde, dans 9 pays», indique la réalisatrice. Cet « incroyable parcours » se poursuit en DVD et très prochainement à la télévision. « J’ai donné pour la première fois la parole à des femmes noires uniquement durant 2 heures, sans interruption d’experts », explique Amandine Gay, rencontrée il y a quelques jours à Paris, où elle est de retour après trois ans à Montréal. Forte de ce succès inattendu, la réalisatrice de 33 ans s’est lancée dans l’exploration d’un sujet tout autant important pour elle, et également aussi intime que politique : l’adoption.
« Née sous le secret »
Amandine Gay travaille sur un livre et surtout un film dont le titre provisoire est « Un enfant à soi ». « Le film donnera la parole aux adultes de 20 à 75 ans, avec recul. On questionne la vision occidentale et post-révolution industrielle de l’enfant comme propriété. Le sujet est à la fois intime et politique, alors on fait attention. L’objectif est qu’ils ressortent mieux de cette expérience, certainement pas de faire éclater des cellules familiales. » Comme pour OLV, Amandine Gay et son équipe « posent beaucoup de questions, s’assurent que les intervenant.e.s ont bien compris le concept du film ». Pourquoi ce format ? C’est pour elle le plus adapté. « Je pourrais me filmer et faire un monologue mais ce n’est pas intéressant. Je ne suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour lancer des conversations. J’arrive avec des présupposés, des intuitions, des interrogations mais je dois rester ouverte. Je confronte ma vision politique à la leur ». Avant de lancer ce projet, la réalisatrice a repris ses études. « La solidité conceptuelle vient du travail de recherche antérieur. J’ai toujours voulu consacrer un film à l’adoption. Mais d’abord, je devais opter pour une approche dépassionnée, il y avait une mise à distance à faire. Le travail universitaire n’était pas obligatoire pour alimenter le travail créatif mais je le trouve utile, même si je retourne à l’émotion, l’empathie, j’aime avoir des bases solides. J’ai toujours aimé l’école, apprendre et puis on apprend en transmettant, en synthétisant une pensée, en rendant intelligible un sujet opaque. » Si elle ne l’avait pas mené dans ce cadre, elle explique que « le mémoire réalisé à Sciences Po en 2006 sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société française a bénéficié à OLV. »
Ce travail de recherche correspond à une envie, à un besoin aussi – voire une injonction : « Quand on est minoritaire et que l’on veut exister sur des sujets politiques, il faut être solide sur les faits et analyses. On attend de nous une rigueur scientifique, on est attendus au tournant. Si j’étais un homme blanc de 50 ans je dirais ce qui me passe par la tête mais je suis une femme noire de 33 ans donc pour être écoutée, j’ai intérêt à être solide. » Ainsi, Amandine Gay peut se targuer d’une légitimité universitaire, qui vient appuyer son expérience personnelle. « Je suis née sous X en 1984 à Lyon », raconte-t-elle. « J’ai grandi à Montanay, près de Lyon. Ma mère était institutrice et mon père cantonnier. J’ai un grand frère noir de 45 ans. Mes parents sont Blancs, j’ai eu la chance de grandir dans une famille consciente de l’importance des origines. J’ai eu des poupons noirs, mes parents avaient un ami diacre guadeloupéen, j’allais dans son église, puis j’ai commencé le basket à 8 ans. Mes parents ont toujours veillé à ce que j’aie une proximité avec des personnes noires. Ils étaient sensibles à ce qu’on ait accès à la culture noire et à respecter notre différence, en revanche, ils n’avaient pas conscience du racisme systémique. » Dans son parcours se croisent les questions de l’adoption et de la découverte de « l’identité noire ».
« Je suis issue d’une génération où on ne cachait plus le fait d’avoir été adoptée. Je n’ai pas de souvenir du jour où on me l’a dit. Mes parents m’ont simplement expliqué ‘’Ta maman ne pouvait pas s’occuper de toi, on ne pouvait pas avoir d’enfants, tu es arrivée dans notre vie.’’ En revanche, la connaissance du fait que j’étais Noire s’est faite en grande section de maternelle, quand un enfant m’a dit ‘’Je te donne pas la main car tu es Noire’’. La race est une construction sociale, la norme c’est ce qu’on connaît, nos parents ne nous ressemblaient pas, notre entourage était composé de Noirs et de Blancs et c’est à l’école que l’on m’a posé des questions : ‘’Pourquoi tes parents sont Blancs ? Où est ta vraie maman ?’’» La petite fille va se passionner pour l’histoire. « La vie des personnes adoptées est marquée par le rapport aux archives, ce qui a trait au passé, la famille biologique… Petite, à l’école, j’adorais l’histoire : apprendre l’histoire en général donne une connaissance de soi. »
Et c’est à 17 ans qu’elle entreprend la démarche « d’ouverture de son dossier » pour découvrir les conditions de sa naissance. « Les personnes adoptées ont des moments charnière dans leur vie qui les poussent aux recherches : l’adolescence, la majorité, la parentalité et les questions des enfants, le vieillissement qui pousse à se dire ‘’Si je ne m’y mets pas, mes parents seront morts’’ et le décès des parents adoptants. » Elle est également portée par son « côté légaliste » : « j’ai le droit de savoir, du coup je veux savoir mais quand on est né sous X, sous le secret, on sait qu’il y a très peu de chances d’obtenir des infos. » Elle se lance seule « car c’est une partie de l’histoire qui m’appartient, c’est ma vie d’avant la rencontre avec mes parents. »
Tirer le fil de son histoire
Amandine Gay se souvient de cette journée particulière de novembre 2002. « Cela s’est passé dans un horrible bâtiment de la DDASS, il n’y avait aucun accompagnement en amont. J’avais décidé d’être seule mais une amie qui m’a appelée au moment où je m’y rendais a insisté pour m’accompagner. Elle a bien fait. L’assistante sociale m’a emmenée dans une salle et demandé ‘’Vous voulez être seule ou que je reste ?’’» Elle restera seule. « Je n’y suis pas allée en me disant que j’y trouverai le nom de ma mère mais mes origines. » Elle trouvera des informations, qui suscitent encore plus d’interrogations. « D’après le dossier, mon père n’était pas intéressé par la mère et l’enfant, ce qui ne veut pas dire grand-chose… Il y avait une lettre supposément dictée par ma mère biologique, Najat, à l’assistante sociale. Mais il y a tellement de paramètres non maîtrisés dans ce récit… Qu’a -t-elle raconté ? Qu’a noté l’assistante sociale ? Est-ce un verbatim ou a-t-elle uniquement noté ce qu’elle a jugé pertinent et intéressant ? Il y a quelques infos factuelles et si j’avais de l’argent, je ferais appel à un détective pour enquêter, mais cela coûte plusieurs milliers d’euros. »
Sur quoi mènerait-elle l’enquête ? « Les conditions de ma naissance. Ma mère est Marocaine, mon père est Français, peut-être Noir. L’assistante sociale n’a pas trouvé pertinent de connaître ses origines et ma couleur de peau laisse penser que mes deux parents sont Noirs. Même avec une mère Marocaine du Sud, je n’aurais pas pu avoir cette couleur avec un père blanc. L’assistante sociale peut être retrouvée, mais là encore, il faut avoir les moyens d’enquêter. »
L’effervescence de la découverte laisse place à la déception. « J’aurais adoré retourner dans mon ou mes pays d’origine. J’ai des amis adoptés coréens, qui ont découvert la culture, appris la langue et découvert un pays où ils ressemblent à tous les gens. Pour moi, c’est un peu désarçonnant : je suis née en France, un pays négrophobe, et le Maroc est un pays négrophobe également. Je n’ai pas envie d’y aller. J’ai grandi avec des Arabes et le premier mot que j’ai entendu c’est ‘’kehloucha’’ [Ndlr. « petite Noire », terme péjoratif et raciste] je savais que je ne serais pas la bienvenue au Maroc, et ce n’est pas la fête d’être Noir et Arabe à la fois ! J’ai été un peu déçue : si j’avais trouvé un père martiniquais, réunionnais ou guyanais, j’aurais pu y aller ! »
Et d’autres paramètres sont à prendre en considération : « en France, l’adoption coûte en moyenne 20 000 euros : inscription en agence, voyages, frais avocats, traduction de documents, etc., cette démarche n’est pas ouverte à tout type de famille. Il s’agit au moins de familles de la classe moyenne, voire carrément bourgeoises. En tant qu’adulte, qu’est-ce que ça veut dire de rencontrer une famille nettement plus pauvre ? Comment gérer la culpabilité de s’en être sorti ? Il peut y avoir une déception quand on est pris pour un porte-monnaie ambulant, mais peut-on leur en vouloir ? La recherche des origines, l’attente des retrouvailles ou le rapport au pays de départ peuvent être beaucoup plus complexes que ce qui a été imaginé ». La jeune femme prévient : « Il faut avancer à son rythme. Quand on voit arriver son dossier, il est illusoire de penser qu’on aura toutes les réponses. On tire un fil sans savoir ce qu’on va trouver. Certaines retrouvailles tournent à l’horreur. Ma démarche est très privée, je veux la mener seule et avant que mes parents biologiques meurent. » Autre choc pour la jeune adulte : « Je n’ai pas eu le droit d’emporter l’original de mon dossier, juste de le consulter un petit moment et faire des photocopies. Je voulais le prendre, je n’ai rien sur ma vie et même mon dossier original je ne pouvais pas l’avoir ! J’avais peut-être besoin de m’accrocher à quelque chose, je me suis sentie dépossédée de mon histoire. Je suis toujours en désaccord avec cette façon de faire. La fonctionnaire était froide, je suis sortie de là dévastée. » Depuis, il y a eu du changement « parce que des personnes adoptées ont milité. Un accompagnement psychologique est prévu en amont et à Lyon par exemple, il existe désormais une Maison de l’adoption. »
Comment passer du personnel, de l’intime, à un travail de recherche puis un film ? Plus simplement qu’il n’y paraît au premier abord, puisque le sujet est politique. « Avec OLV et ce nouveau projet, j’approfondis deux volets importants de mon identité, ce sont des sujets centraux. C’était une première en salle de cinéma de voir des femmes noires s’exprimer comme ce sera une première d’entendre la parole des personnes adoptées, avec une expertise et analyse. » Mais avant, la réalisatrice insiste sur « le travail pédagogique à mener en amont pour faire émerger ces sujets dans l’espace public ». « Il y a énormément de questions et de chantiers sur la question de l’adoption », prévient-elle, des questions spécifiques auxquelles seules les personnes concernées ont à faire face. « L’idée qu’on allait devenir des personnes hybrides et que l’on ne serait pas seulement assimilés n’a pas été pensé. »
Ce qui intéresse Amandine Gay, « c’est le droit des enfants et plus tard des adultes » et justement, de nombreuses interrogations légales entourent l’adoption en France et internationale.
De Pétain à aujourd’hui, un sujet éminemment politique
Selon la loi, en France – « l’un des pays les plus adoptants au monde » rappelle Amandine Gay – toute femme peut décider d’accoucher anonymement, « sous X ». Après un délai de 2 mois et si la mère n’est pas revenue sur sa décision de reprendre l’enfant, il devient pupille de l’État et peut alors être proposé à l’adoption. La réalisatrice se dit « très ambivalente sur la loi de 1941 qui crée le statut des nés sous X, cette loi qui portait sur l’accouchement anonyme. Elle a été instituée par Pétain pour les enfants nés de mères françaises et de soldats allemands. » En effet, ce décret-loi du 2 septembre 1941 sur « la protection de la naissance » pris par le maréchal Pétain entérine l’accouchement sous le secret tel qu’il existe toujours aujourd’hui, en prolongement d’un décret de 1939. Il a subi plusieurs modifications depuis et reste au cœur du débat. « Les mères sont libres de laisser quelque chose, ou rien. On a dû insister sur le fait que les enfants adoptés deviennent des adultes et qu’ils subissent un déni de droit, celui de connaître leur origine et au moins les antécédents médicaux. La loi a été changée en 2003. C’est un problème de santé publique. »
En France, les adoptions nationales sont en nette diminution. « Je suis d’une génération où les nés sous X sont majoritairement Noirs et Maghrébins. A partir des années 1990/2000, il y a eu une chute, aujourd’hui, moins d’une centaines d’enfants naissent dans ces conditions chaque année. Dans les années 1900, 150 000 personnes étaient abandonnées chaque année. Cette baisse est due à l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, au recul de l’âge auquel les femmes ont des enfants et à la baisse de la fertilité en Europe. Ces facteurs induisent le nombre de bébés blancs disponible, qui chute drastiquement dans les années 1970/1980. »
De son côté, l’adoption internationale « commence en 1945 avec la Seconde guerre mondiale, cela concerne donc des générations entières : ces enfants sont devenus grands-parents. La plupart des adoptés sont aujourd’hui des adolescents ou des adultes. Cela change le rapport aux institutions. » La question de l’adoption d’un point de vue politique est traitée dans le monde anglo-saxon « depuis plusieurs décennies. Le premier livre collectif d’universitaires adoptés a été publié en 2006 Outsiders Within : Writing on transracial adoption. En France, au Québec, en Suisse et dans les pays francophones, le nombre de mémoires de thèse sur ces sujets est en augmentation. » La France n’est pas en reste : le 6 octobre aura lieu à Paris « la première réunion de personnes adoptées francophones adultes, regroupant des personnes de France, du Québec et de Suisse : ‘’Les Adopté.e.s Se Réapproprient La Narration’’». Au Québec, une association a publié un premier livre sur le sujet auquel Amandine Gay a participé, La couleur de l’adoption. Il sera officiellement présenté en France le 12 octobre. Enfin, novembre sera « Le mois des adoptés ».
Avant tout, comment nommer les choses, les personnes concernées ? « Il existe énormément de façon de nous disqualifier dans le débat : en nous appelant ‘’enfants’’ par exemple. Les personnes adoptées militent contre le terme d’enfant adopté, au profit de celui de ‘’personne’’.»
Ensuite, « préférer le terme de ‘’séparation’’ à celui d’‘’abandon’’, surtout dans les cas d’adoption internationale, où le différentiel économique, les rapport Nord/Sud jouent un rôle. Les adoptions se font dans des pays en guerres, en proie à la famine, aux catastrophes naturelles, aux épidémies… » Amandine Gay appelle donc à réfléchir « au malentendu sur les conditions de l’adoption : quand il s’agit de pays du Sud dans lesquels les enfants sont élevés par la communauté, les parents pensent qu’ils confient leurs enfants à des personnes du Nord pour qu’elles assurent leur éducation seulement. Or l’adoption internationale rompt tout lien de filiation et on fait signer des documents à des personnes pour qui ce n’est même pas un concept, qui ne savent pas forcément ce qu’elles signent ou ne savent même pas lire. Peut-on parler d’abandon ? »
Pour la réalisatrice, « les personnes adoptées sont adultes, en mesure de parler, de demander des comptes à leurs familles et leur pays de départ et d’arrivée. Tout ceci est complètement nouveau, les institutions ne suivent pas, n’ont pas de moyens or en France, des milliers de personnes veulent connaître leurs origines. Aucun suivi ni financement n’est prévu pourtant la France a eu une politique nataliste, qui passait aussi par l’encouragement à l’adoption et nous a fait venir, avec un but : apporter de la vitalité au pays. »
Les rencontres de novembre seront l’occasion de revenir sur un dossier emblématique : le cas des enfants de la Creuse, lors d’un événement sur l’adoption et l’immigration.
Entre 1962 et 1984, le Bureau des migrations des départements d’outre-mer (Bumidom) a déplacé 2 015 mineurs réunionnais présentés comme relevant de l’aide sociale à l’enfance en métropole. Ces enfants de 5 à 15 ans ont été répartis dans 83 départements, la Creuse a à elle seule accueilli 215 enfants. Une commission d’information et de recherche historique mise en place en 2016 a rendu un rapport détaillant notamment les conditions de ces déplacements forcés, les mauvais traitements subis par les enfants et pointe la responsabilité de l’État français. « L’objectif sera de faire comprendre que c’est bien un sujet politique. Il s’agit d’une forme de migration forcée : la personne qui migre n’est pas l’agent de sa migration, elle est prise d’un espace pour aller vivre dans un autre espace, sans que son avis ne lui soit demandé. C’est l’équivalent de ce que vivent les mineurs isolés venus de Syrie. Qui est bienvenu ? Pourquoi ? Qui est déplacé ? Il y a une dimension utilitariste de l’adoption, la France par exemple est très intervenante sur la natalité. Elle était dans une logique populationniste et coloniale, comme Françoise Vergès l’a rappelé concernant La Réunion [Ndlr. Dans son livre Le ventre des femmes, paru aux éditions Albin Michel en 2017.] Ses habitants avaient une très forte velléité d’indépendance, qui inquiétait l’État colonial, alors le ministre Michel Debré a mis en place ces migrations forcées vers la Creuse. Les parents n’étaient pas assez lettrés, avaient peu de moyens financiers, l’État leur a dit qu’ils auraient un meilleur futur en métropole, finalement ils n’ont pas été scolarisés, ont été abusés et ont subi le travail précaire lorsqu’ils ont été placés en familles d’accueil. On arrive à une marchandisation des enfants, déplacés pour pallier à la désertification d’une région et placés dans des familles d’accueil comme main d’œuvre agricole. Les enfants n’étaient pas considérés comme tels, ils étaient réifiés, ils étaient des solutions à un problème et si on leur avait demandé, ils seraient restés à La Réunion. »
Des scandales hier, de lourdes conséquences aujourd’hui
D’autres scandales ont suivi. Celui de « L’Arche de Zoé » notamment, du nom de cette association dont le président et des membres avaient tenté de faire venir illégalement en France 103 enfants tchadiens retirés à leurs parents et présentés comme orphelins du Darfour. « Cette affaire a rappelé qu’il est interdit d’adopter dans des zones de guerres pour éviter les trafics or il y a eu beaucoup d’adoptions au Liban durant la guerre. Justement, l’association Born in Lebanon fondée par Dida Guidan en Suisse essaie de mettre en place un programme avec l’État pour une justice restauratrice. Plutôt que de voir des centaines de personnes adoptées attaquer l’État, un système sera instauré pour dialoguer avec les institutions. L’objectif est d’envisager une résolution de conflits entre tous les acteurs de ces adoptions. L’enjeu est aussi d’éviter de stigmatiser l’adoption quand des enfants continuent d’arriver car des procès à répétition pourraient les mettre en difficulté.» Autres pays, problématiques similaires « avec les dérives de la kafala en Algérie et au Maroc, dont parle Brahim Kermaoui dans son livre L’enfant égaré. »
Ainsi, avec ce nouveau projet, Amandine Gay veut « questionner l’approche de justice reproductive ». « Il interroge les conditions de séparation des femmes pauvres ou marginalisées des Nord et des Sud avec leurs enfants : comment des enfants sont-ils rendus disponible à l’adoption ? Pourquoi un groupe peut adopter ou non ? Les enfants coréens sont les plus demandés (et aussi les plus »coûteux ») sur le marché de l’adoption internationale, on ne peut s’empêcher de penser aux stéréotypes positifs mais tout de même raciste selon lequel ces enfants seraient plus sages, plus intelligents, etc, après les enfants blancs… Les sociétés seront égalitaires quand des Coréens adopterons des Blancs. »
Et chaque question en soulève une autre : « Quand on fait des recherches sur Google sur le ‘’parcours du combattant’’ lié à l’adoption, les résultats concernent les parents. Personne ne se demande pourquoi ils ne se déplaceraient pas dans le pays de l’enfant, pourquoi ne deviendraient-ils pas une minorité, pour épargner l’enfant ? Les candidats à l’adoption ne réalisent pas que l’enfant va devoir vivre à l’étranger, devenir racisé, changer sa langue, sa nourriture, sa culture… et avoir de nouveaux parents. »
Alors, pour la réalisatrice, il faut « travailler sur l’empathie, ‘’imagine si on t’avait déplacé toi, fait changer de pays ?’»’ et s’interroger sur la démarche même de l’adoption. « Dans les familles hétéronormées, la non-maternité est une incomplétude des femmes.
75 % des familles qui adoptent n’avaient pas l’adoption comme premier choix de parentalité [Ndlr. Chiffre de l’Institut national de démographie, publié en 2005.]. Souvent les couples essaient la procréation classique, découvrent leur infertilité, essaient les fécondités in vitro ou la procréation médicalement assistée, puis préféreraient adopter en France ou des enfants blancs. C’est seulement en découvrant les durées d’attente pour l’adoption nationale ou les critères auxquels ils ne correspondent pas que ces couples se tournent vers l’adoption internationale d’enfants racisés. Qu’est-ce que cela signifie d’être le quatrième choix ? »
Autre point juridique à creuser, qui en découle : « En France on a créé une fiction juridique, l’acte de naissance indique que les parents adoptants sont les parents de naissance de la personne adoptée, ce qui est faux. On procède ainsi car on a besoin de faire ressembler la parentalité adoptante à la parentalité biologique. »
Enfin, un sujet également peu abordé : l’abandon des enfants et personnes adoptées. « Les ruptures d’adoption sont comptabilisées depuis 2007. On estime que 10 à 15 % des personnes ont été ré-abandonnées chaque année, par des adoptants qui n’ont pas fait le deuil de la parentalité biologique, suite à l’arrivée d’enfants biologiques après l’adoption, ou à cause du racisme ou de l’homophobie des parents adoptants, entre autres raisons ». Les personnes adoptées peuvent par ailleurs être plus vulnérables : « En France nous n’avons pas de statistiques mais aux États-Unis, pays toute époques confondues pratiquant le plus l’adoption, les chiffres montrent qu’il y a plus de suicide chez les adolescents adoptés que les non-adoptés, et que les familles adoptantes ont davantage recours au soutien psychologique. »
Mettre les personnes adoptées au centre
La démarche d’Amandine Gay et de toutes les personnes adoptées qu’elle évoque révèle que les enfants et personnes adoptées ne sont jamais au centre, l’attention est toujours focalisée sur les parents. Pour cette raison, elles ont décidé de prendre la parole. « On bénéficie d’une expertise de 50 ans sur l’adoption en France, si un groupe est légitime pour en parler et être questionné c’est nous. » Et pas uniquement pour porter leur cause : « Notre expérience bénéficie à tous les modèles de nouvelles familles. »
La réalisatrice se réjouit de voir que « les initiatives se multiplient, portées par les adultes et grâce aux réseaux sociaux, on peut trouver tout ce qu’on veut et s’organiser. La première association en France a été fondée par des personnes d’origine coréenne en 1995, « Racines Coréennes ». La plus grosse association de personnes adoptées en France aujourd’hui s’appelle «La Voix des Adoptés ». Elle siège au sein de plusieurs institutions dont l’Agence Française de l’Adoption (AFA). » Leur but : « faire entendre les intérêts des adoptés, mettre par exemple en place des fonds dédiés aux adultes pour les recherches – que l’État prenne en charge un billet de retour ne me paraît pas aberrant puisqu’il nous a fait venir -, passer de l’orientation des candidats à l’adoption à celles des adolescents et adultes adoptés, pour mieux tenir compte des besoins. »
Ce combat, les personnes concernées ne doivent pas le mener seules selon Amandine Gay. « Les féministes, blanches, de classe moyenne ou bourgeoises se sont éloignées de la fonction reproductive des femmes. Mais si désormais elles ne s’intéressent pas à la justice reproductive, qui le fera ? On peut parler des placements pour raisons économiques par exemple, qui ne visent pas des « mauvaises mères », mais des mères pauvres obligées de travailler. Le lien direct peut être fait entre les foyers et les prisons, comme le démontre Dorothy Roberts dans Killing the Black Body : Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty… Ou entre les foyers et la rue, Lyes Louffok en parle dans Dans l’enfer des foyers et rappelle souvent que 1 SDF sur 4 en France est un ancien enfant placé. On parle de droits des femmes isolées et précaires et de leurs enfants. Enlever des enfants à des femmes de familles monoparentales qui travaillent le soir est un choix politique. Pourquoi ne pas leur fournir de l’aide ? Pourquoi préférer financer les foyers plutôt que des crèches ou des nounous ? »
Avec les féministes, Amandine Gay pense aussi aux associations antiracistes. « Elles ont un travail à mener, les enfants sont davantage retirés aux familles noires et arabes et il y a eu historiquement dans le monde anglo-saxon des oppositions aux adoptions transraciales. Tout ceci cause la destruction de communauté, de familles. »
La réalisatrice rappelle que « la société a jusqu’ici été focalisée sur un point de vue moral ou humanitaire de l’adoption » et avertit « ce n’est pas ce qui nous intéresse, on doit arriver à s’exprimer librement sans chercher à ménager qui que ce soit, mais on doit être assez accessibles et dans l’empathie et l’émotion pour qu’on nous écoute et qu’on puisse faire avancer la réflexion. Il y a encore des adoptions en cours, il faut donc éviter des drames. » Et comme pour « Ouvrir la voix », elle travaille autant sur la forme, l’esthétisme, que le fond. « Pour la première fois, ce sera un film d’archives avec uniquement des archives institutionnelles, des discours des adoptés de 1945 à nos jours ainsi que des images de leurs familles. Nous sommes, avec Enrico Bartolucci, photographe et chef opérateur de OLV, dans une recherche esthétique. Il existe très peu de films de ce genre avec des archives, des interviews seulement et sans voix off. Nous voulons pousser le genre du film d’archives en exploitant des images de Pathé des années 50, des vidéos au format cours des journées télévisés des années 80, des reportages… Il y a un travail à faire compte tenu de l’évolution graphique des JT, des lancements, de la façon dont les choses se racontent… L’écriture est terminée, nous explorons les pistes de financements – nous sommes soutenus au Québec avec la Société de développement des entreprises culturelles (Sodec) – et sommes dans la phase des pré entretiens. Nous avons un partenaire : CG cinéma, qui coproduit le film. » Pour ce sujet là encore original, la question des financements se pose. Et un défi particulier se pose à la réalisatrice, « la transition du »guérilla film making » à un mode de production classique. Par exemple, le CNC [Ndlr. Centre national du cinéma et de l’image animée] prélève une taxe solidaire qui correspond à 10 % des recettes, pour son fonds de soutien. Or cette institution n’a pas financé mon premier film et a tout de même perçu un pourcentage des recettes…» Reste à voir si le succès de « Ouvrir la voix», peu voire pas soutenu car considéré par les institutions comme « un film de niche », aura un impact.
Amandine Gay part d’elle, de son vécu, de ses expériences, pour donner la parole à celles et ceux à qui elle est si rarement donnée au cinéma : les personnes directement concernées. Elle mêle l’intime au politique, naturellement, à la frontière où l’histoire personnelle rencontre la grande Histoire. Et à l’intersectionnalité des problématiques de race, classe et genre qui lui sont chères et encore peu explorées en France.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Portrait d’Amandine Gay. Crédits : Matias Indjic