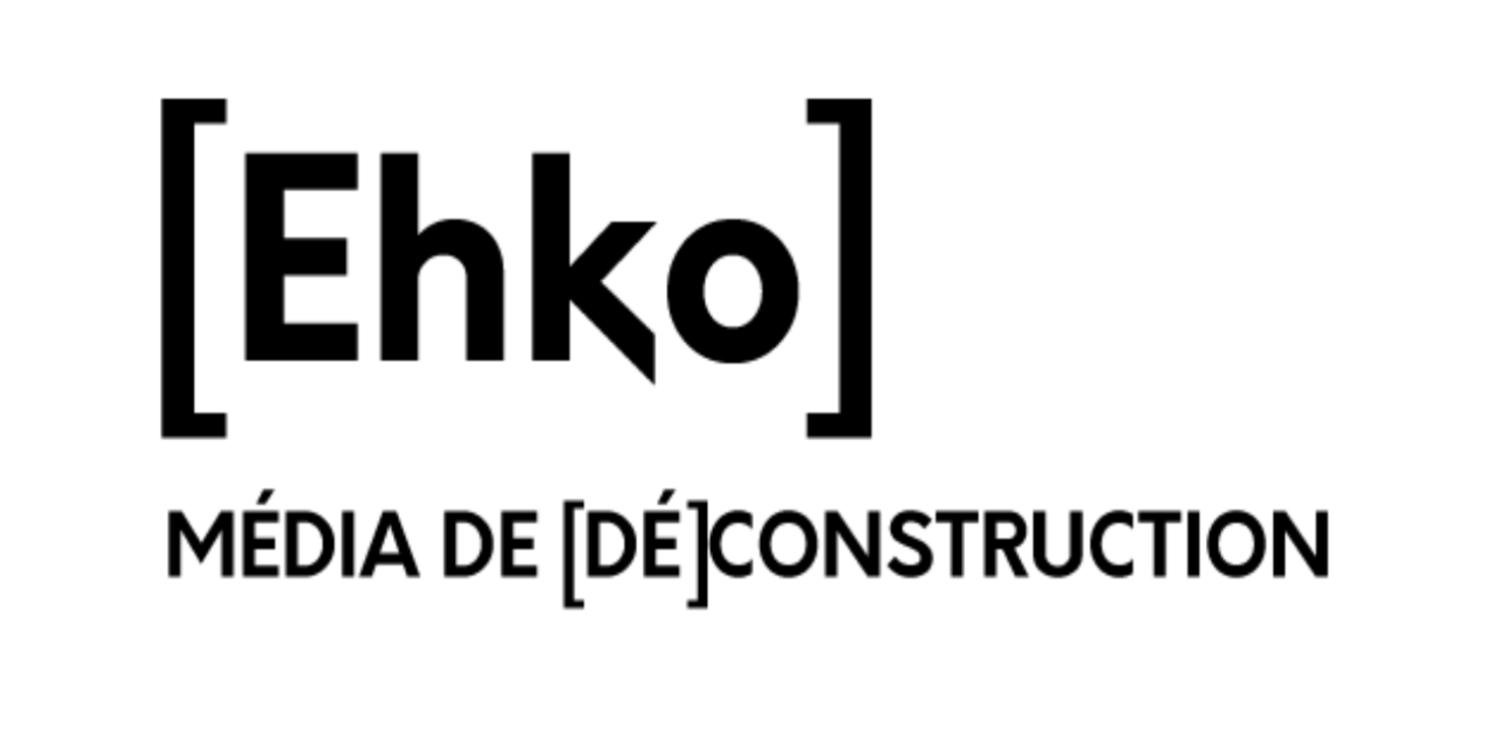Les « Gilets jaunes » servent de révélateurs au macronisme et le macronisme était porteur de ce mouvement qui est apparu par réaction à lui. La question n’est pas tant « pourquoi » ce mouvement mais « comment » quelqu’un comme Emmanuel Macron a pu accéder au pouvoir.
[Certes] les mains étaient posées sur la table, tendues à plat. En geste de pacification peut-être. Et le ton était solennel, ce 10 décembre, après 3 semaines de manifestations des « Gilets jaunes ». « Les événements de ces dernières semaines (…) ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles », a articulé Emmanuel Macron. Puis diverses mesures liées à l’augmentation du pouvoir d’achat et baisse de taxes furent annoncées. Mais la suppression de l’impôt sur la fortune, largement contestée, était maintenue. Cette allocution, vague écho à celle du 30 mai 1968 prononcée par le Général De Gaulle, fut regardée par 21 millions de Français. Un record. « Trop peu, trop tard » a-t-on pu entendre. Le samedi suivant, le jaune prévalait dans les rues et sur les ronds-points de France.
Puis vinrent les vœux du 31 décembre. Autre dispositif, autre ton. Mêmes réactions. Debout, arrimé au sol et au prompteur, une élocution mécanique car déclamée de façon évidente. Après avoir dénoncé ceux qui « prennent pour prétexte de parler au nom du peuple – mais lequel, d’où ? Comment ? », il finit par évoquer « la foule haineuse ». Edmond de Rostand parlait de « La canaille ». Virginia Woolf se plaignait, elle, de « ce monstre anonyme, l’Homme de la Rue ». Rien de nouveau sous le soleil…
Emmanuel Macron passait ainsi du terme « peuple » (introuvable selon lui) à celui de foule. Comme pour mieux refuser toute dimension politique à ce mouvement et le réduire ainsi à une éruption irraisonnée et déraisonnable. Car on sait, depuis le sociologue Gabriel Tarde, combien la foule est jugée dangereuse et irrationnelle. Or ce mouvement des Gilets jaunes est éminemment politique.
Yellow is the new red
Mouvement polymorphe qui échappe à toute classification nette, « les Gilets jaunes » laisse circonspects tous ceux dont le métier est pourtant de disséquer les entrailles des Français pour s’assurer du présent et imposer l’avenir. Mouvement gazeux, hautement volatile et explosif ou mouvement fluide d’une « société liquide » selon la théorie du sociologue Zygmunt Bauman, la seule certitude est celle de la matérialité concrète des revendications.
C’est une taxe écologique sur le diesel qui a allumé l’incendie social. Ignore-t-on encore que les questions fiscales ont ébranlé des empires, de l’impérieuse Rome à l’impérative Britannia ? Sous la revendication de la justice fiscale a aussi pointé le désir de justice sociale au nom de cette « passion de l’égalité », selon l’expression de Tocqueville, qui a toujours animé l’esprit français.
Des précédents historiques ont ainsi émaillé les analyses. Jacqueries, du nom de ces révoltes paysannes dans l’Occident médiéval. Mouvement poujadiste, référence au mouvement des années 50 qui revendiquait la défense des commerçants et des artisans et condamnait l’inefficacité du parlementarisme. Certains ont vu dans ces Gilets jaunes un mouvement d’extrême gauche. D’autres le signe indiscutable d’un mouvement d’extrême-droite. On a même pu entendre sur un plateau télé un « spécialiste-es-société » expliquer que ce A entouré d’un cercle vu sur les murs de paris est « un symbole d’extrême-droite ». Acquiescements doctes sur le plateau. Excuses depuis du dit spécialiste.
Les « Gilets jaunes » sont devenus des signifiants vides, emplis de ce que chacun voulait bien y voir. Selon son propre prisme idéologique. Ou ses intérêts. Bourdieu nous a pourtant appris que les classes populaires ne disent pas, elles sont dites. C’est là le rôle des ventriloques dûment convoqués sur les plateaux télé pour essayer d’expliquer ce mouvement. Car « être dit », c’est aussi, en un sens, « être domestiqué ».
On a ainsi pu « dire » les Gilets jaunes à travers l’opposition de la France périphérique (petites villes et campagnes abandonnées) à la France centrale. La France encore dotée de services publics et riche d’un dense tissu économique à la France de « la diagonale du vide », selon l’expression du démographe Hervé le Bras, celle de zones désertées par les services publics. Des analystes y ont décelé l’opposition entre la France des « petits blancs » à celle plus métissée des grandes villes. Opposition qui se cristalliserait dans l’affaire Benalla. Autre antagonisme, la France de la voiture contre celle qui dispose du maillage de transports en commun. La France besogneuse et peu diplômée contre celle citadine et plus diplômée. La France qui a l’obligation de se lever tôt contre celle qui a le luxe de se coucher tard. La France des PME contre celle du CAC 40. La France de la mondialisation funeste contre celle, que symbolise Emmanuel Macron, de la mondialisation heureuse. La start-down nation contre la start-up nation.
Les Gilets jaunes, c’est surtout le retour de l’inconscient de classe ; celui qu’on pensait dépassé, renvoyé aux limbes de l’Histoire. D’autant que la mort actée des classes populaires, ou plutôt leur agonie lente, semblait structurer la politique française depuis plus de 35 ans. Le faire-part de décès avait pris la forme d’une note de la fondation Terra nova.
En mai 2011, ce think tank de centre-gauche, suggérait à la « gauche » de concentrer sa campagne sur les classes moyennes plutôt que sur les couches populaires. « La coalition historique de la gauche centrée sur la classe ouvrière est en déclin. Une nouvelle coalition émerge : « la France de demain », plus jeune, plus diverse, plus féminisée. Un électorat progressiste sur le plan culturel (…). Il constitue le nouvel électorat « naturel » de la gauche mais il n’est pas majoritaire », détaillait cette note. Pour Terra nova, il fallait sortir d’une gauche politique portant les valeurs de la classe ouvrière, tant en termes de revendications sociales que de sa vision de l’économie : pouvoir d’achat, salaire minimum, congés payés, sécurité sociale, nationalisation des grandes entreprises, encadrement des prix. A partir de la fin des années 1970, la rupture se serait faite sur le facteur culturel. « Mai 68 a entraîné la gauche politique vers le libéralisme culturel : liberté sexuelle, contraception et avortement, remise en cause de la famille traditionnelle ». Le déclin de la classe ouvrière aurait entraîné « des réactions de repli » et «une discordance sur les valeurs culturelles ». L’hypothèse a d’ailleurs été ranimée quand certains sondages ont indiqué que la première revendication des Gilets jaunes serait l’abrogation du dit mariage pour tous. De la loi Taubira donc, point d’orgue de la victoire du sociétal sur le social et matérialisation de cette « discordance sur les valeurs culturelles ».
Mais les classes de l’extrême « moyenne » et de l’équilibrisme des revenus médians ont été aussi observées lors des manifestations des Gilets jaunes. Le ventre mou des classes populaires à moyennes inférieurs. Jusqu’alors, les chocs des politiques économiques et du lent démembrement de l’Etat social avaient été plus ou moins amortis par ce ventre mou, plus ou moins ressentis par lui également. Mais la politique d’Emmanuel Macron a accéléré ce démembrement, transformant ce ventre mou en épine dorsale qui s’est agitée comme une vague. Jusqu’à faire tanguer par effet mécanique, puis par effet de surprise et de peur, la partie supérieure de la population : les classes moyennes à supérieures. Celles qui ont le pouvoir, économique, politique et symbolique. Celles qui approuvent la politique d’Emmanuel Macron qui les protège encore ou leur rapporte « un pognon de dingue ».
Toutes ces grilles d’analyse sont sans doute vraies ensemble et fausses séparément. C’est peut-être du côté des travaux de l’historien Benedict Anderson qu’il faut aussi chercher la clé. Les réseaux sociaux ont permis d’agglomérer en « une communauté politique imaginée » des gens qui ne se connaissaient pas mais qui ressentaient un fort sentiment de communauté. Pas une communauté de destin, comme pour la nation. Mais de sort. Il fait d’un tas atomisé un tout qui se structure au fur et à mesure de son déploiement. C’est justement là la force de ce mouvement car il agrège autour d’un plus petit dénominateur commun : la colère.
L’Homme de la rue
Un film de Franck Capra fait comme un écho au mouvement des Gilets jaunes. Ce film, « Meet John Doe » (ou « L’homme de la rue », 1941) pose un regard social sur les Etats-Unis post-crise de 1929. L’expression John Doe (ou Jane pour les femmes) désigne une personne non identifiée. Dans le droit anglais, c’est le nom donné à un plaignant inconnu. John Doe est donc le common man, l’homme de la rue. L’histoire est simple : par dépit devant la perte de son emploi, une journaliste prétend avoir reçu la lettre d’un homme désespéré, chômeur depuis plus de 4 ans. Il y annonce avoir décidé de se suicider le soir de Noël. La lettre dénonce aussi les injustices sociales et la perte de valeurs de solidarité et de fraternité. La « Common Decency » dont parlait Orwell. Les lecteurs veulent rencontrer cet inconnu, ce John Doe qui a su si bien écrire leur malheur. Des « clubs John Doe » fleurissent alors à travers le pays, les gens se parlent, s’entraident, se connectent alors que jusqu’alors chacun s’ignorait. Les notables, à la fois politiciens et patrons de presse, prennent peur mais imaginent vite comment récupérer cet engouement. Un casting est organisé et c’est un chômeur (joué par Gary Cooper) qui est retenu pour devenir l’auteur de cette lettre.
Capra dépeint une opinion publique malléable. Un héros nécessaire qui deviendra bouc-émissaire. Un patron de presse aux ambitions politiques et à qui la police sert de milice privée. Capra interroge aussi la puissance des médias, oppose l’homme de la rue à la foule versatile mais qui veut croire. Capra en fait la mesure de toute morale et de toute action vraiment politique, au sens de vie dans la cité. Surtout il pointe la force révolutionnaire de la dignité. Si dans le film de Capra, c’est la radio et la presse écrite qui vont permettre que les club John Doe se créent, désormais les réseaux sociaux jouent ce rôle. Ces médiums ont eu pour fonction de transformer « ces groupes d’un instant », selon l’expression du père de la psychologie des foules Gustave Le Bon, en mouvement qui se structure au fur et à mesure qu’il se déploie. Qui sort de la dénonciation pour aller vers l’énonciation.
Car il faut les écouter ces Gilets Jaunes, John Doe modernes : « Je croyais être le seul à vivre cela » ; « Je sors enfin de chez moi, j’agis, je rencontre des gens ». Atomisation des souffrances pour un agrégat des colères mais aussi des solitudes, des hontes. Le désir de dignité est effectivement tout autant un moteur de l’histoire.
Marie T., par exemple, rencontrée le 8 décembre pour [Ehko], se dit simplement « en colère ». Marie est une maman de 35 ans. Elle a laissé ses deux enfants à la garde de sa mère ce samedi pour « monter à Paris ». Elle habite un petit village à 200 kilomètres de la capitale. Chaque jour, pour se rendre à l’hôpital qui l’emploie comme aide-soignante, elle conduit 70 kilomètres, aller-retour. « L’augmentation du diesel a signifié pour moi un coût supplémentaire de 50 euros par mois. Cela peut sembler peu mais pour moi, c’est énorme. Mon mari est en formation. On arrive à peine à vivre sur mon salaire. Mais je ne me plains pas car je vois parfois à l’hôpital des malades qui me disent que dès le 15, ils n’ont plus rien sur leur compte ». Marie observe ses camarades. Beaucoup de femmes sont là. Le Gilet jaune est aussi une femme.
Thomas P. a la vingtaine, il n’a jamais travaillé. Gilet jaune depuis le début, il dit être dans la rue contre la politique d’Emmanuel Macron : « il a fait des cadeaux aux plus riches et aux plus pauvres, il a supprimé des aides. On n’en peut plus. Cette politique nous écrase. Je vis déjà moins bien que mes parents au même âge que moi alors que je suis plus diplômé. Eux-mêmes ont peur désormais pour leur retraite ».
Pierre V. est ambulancier. Sa femme est infirmière. Il a aussi revêtu le fameux gilet jaune. Pourtant Pierre, le début de quarantaine souriante, est plutôt bien loti. Il habite une grande ville du nord de la France. Il est là dit- il car chaque jour son métier lui permet de mesurer « la misère de ce pays ». « J’ai parfois à faire à des gens qui appellent les pompiers pour des malaises et en creusant, on se rend compte qu’ils n’ont pas mangé assez, faute de moyens ». Ce samedi 8 décembre, Pierre a observé les jets de lacrymogènes devant le cordon de CRS serré et déployé aux abords des quartiers de l’Ouest parisien. « 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et on nous envoie cela ». Le gaz se fait dense, l’atmosphère est irrespirable.
Une semaine après, aux abords de la place de la République à Paris, il y a peu de gilets jaunes. La faute peut-être à l’attentat survenu quelques jours avant à Strasbourg, revendiqué par l’État dit islamique. Ailleurs dans Paris, le déploiement des forces de l’ordre, les véhicules blindés garés devant les vitrines de noël enguirlandées ont donné à la capitale des allures de camp retranché. La fatigue est là, évidente aussi. Le froid ne décourage pas pourtant, pas plus que les violences policières qui ont émaillé les manifestations. Selon Amnesty International, les forces de l’ordre ont eu recours à un « usage excessif de la force lors des manifestations des Gilets jaunes ». D’après de nombreux témoignages recueillis par l’ONG, la police a « fait un usage inapproprié des flashball, en tirant sur la foule ». « Des grenades de désencerclement » ont été lancées, « qui ne devraient jamais être utilisées dans des opérations de maintien de l’ordre ». En marge des manifestations, la police a aussi confisqué « leurs équipements de protection, mais en plus le simple fait qu’elles soient en possession de tels équipements a été utilisé comme prétexte pour les arrêter ».
Les gilets jaunes, envers du macronisme et de sa diagonale du vide politique
Comme le notait Marx à propos de la Révolution de 1848 : « De nos jours, chaque chose paraît grosse de son contraire ». Le macronisme était porteur des Gilets Jaunes. Les Gilets Jaunes disent en creux le macronisme. L’envers et l’endroit de deux façons de dire et faire le politique.
Car que voit-on depuis le 17 novembre 2018 ? Des Gilets jaunes vêtus d’une fibre acrylique phosphorescente. L’acrylique tirée du pétrole, ce liquide précieux et hautement inflammable, dont l’augmentation d’un autre dérivé, le gasoil, a été l’étincelle. Jaune phosphorescent, pour être enfin vus pour ces gens qui se sentent invisibilisés. Être vus et entendus enfin, hors de ces chemins balisés des « Itinérances mémorielles », ces visites monarchiques d’un Macron en Catherine de Russie dans des villages Potemkine, dûment balisés et aseptisés par ses équipes de communications et de sécurité.
Le gilet jaune aussi comme métonymie de tant de choses : la colère, le harassement. Le jaune, couleur de la peur et de l’exclusion. Peur du déclassement, de la paupérisation, de la pauvreté. Sans ce gilet, chacun est seul dans son incompréhension de ce qui lui arrive. Revêtu de ce gilet jaune, membre d’un groupe. Voilà sa vie, sa colère devenues sujet politique et médiatique, et lui-même acteur tout autant politique. L’habit ne fait pas le moine mais il fait le mouvement. Le jaune deviendra-t-il aussi une couleur révolutionnaire ? Yellow is the new red…
Que voit-on encore ? Des corps qui s’opposent. Il ne s’agit pas là de développer la théorie des deux corps du Roi, humain et souverain. Mais du corps des pouvoirs et de celui du peuple. Le corps d’Emmanuel Macron d’abord dont il est dit qu’« Il ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Il se maquille même les mains ».
Ces mêmes mains manucurées posées sur le bureau de l’Elysée lors de son allocution. Le corps de sa femme aussi, tout autant vilipendée lors des manifestations. Ce corps, luxueusement mis en valeur et qui a été tant exposée sur les pages glacées. Ce corps dont la conquête a semblé les prolégomènes de la chanson de geste médiatique qui a été construite autour de la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron.
Il y avait aussi sur les plateaux télé les corps des journalistes, sanglés et corsetés, lissés et grimés pour les besoins du dispositif télévisuel. Tous en anthracite discret et camaïeu de bleus passés. Des journalistes devenus des appareils idéologiques de l’Etat et qui poussaient le mimétisme jusqu’à sembler indissociable des hommes politiques invités. Dans les deux cas, des corps comme des marqueurs de pouvoir, censés impressionner. Au sens premier : tenir à distance.
En face, qu’a-t-on vu ? Des corps douloureux. Des visages souffrant. Des visages à nu. Les visages des Gilets jaunes vus lors des manifestations sont pour beaucoup marqués et fatigués. Des corps réels, gueules cassées des politiques de casse sociale. Puis gueules cassées par les violences policières. La guerre sociale d’usure qui leur est faite se lisait dans les sillons de chair, guerre qui s’est accélérée avec Emmanuel Macron. Ce président au visage si lisse et maquillé. On songe alors à les observer, ces visages saisis dans les rues de Paris, à ces mots adressés par Edouard Louis à son père : « Ta vie prouve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu’au contraire nous sommes ce que nous n’avons pas fait, parce que le monde, ou la société, nous en a empêchés »[1]. Des visages qui portent ces verdicts sans tribunal, sinon celui invisible de la fatalité économique. De la faillite politique.
Qu’a-t-on entendu ? La plupart des manifestants n’ont jamais mis un pied à Paris. Pas plus que dans une manifestation. Certains ont voté Mélenchon, d’autre Le Pen, certains Macron. Beaucoup ne votaient plus. Tous disent refuser d’être « récupérés ». Un Gilet jaune glisse même, amusé : « De toute façon, on est irrécupérables maintenant ». « On n’est ni droite ni gauche » souffle un homme d’une cinquantaine d’années, étrange écho au « ni droite, ni gauche » d’Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale. Apolitisme revendiqué. Ou plutôt refus de tout partisanisme. Rejet de la politique qui est aussi retour au politique. Car les personnes croisées disent toutes se politiser, ou se repolitiser tout en se resocialisant pour certaines. Les Gilets jaunes, c’est donc le retour du refoulé de classe mais aussi du politique. Quand toute la politique d’Emmanuel Macron a précisément signifié l’inverse : start-up nation vague et atomisée ; évacuation du politique au profit d’un mélange de technocratie et de communication hors-sol.
Car on ne peut avoir réclamé la rencontre directe avec le peuple sans accepter que cette visitation monarchique puisse se renverser en face-à-face démocratique. On ne peut avoir vidé le principe de représentativité, avoir réduit les élus nationaux à des députés croupion (voir les tribulations du député Joachim Son-Forget) dans une Assemblée nationale poulailler et s’étonner de la violence du rejet de toute « représentation ». Et du désir de démocratie directe symbolisée par le référendum d’initiative citoyenne. On ne peut avoir sapé avec méthode les courroies de transmission et d’amortissement démocratiques et s’étonner qu’elles n’aient pas joué leur rôle de ralentissement, d’alerte, de canalisation des tensions.
Les Gilets jaunes jouent ainsi le rôle de révélateur. Révélateur de la crise de la représentativité, qu’elle soit politique ou médiatique. Refus de l’intermédiaire qui fait écran, qui finit par confisquer la voix. Car le peuple, encore une fois, n’est admis à la parole que dûment représenté, corseté par la représentation, la médiation, l’intermédiaire. Que ce soit l’élu, le sondeur ou l’éditorialiste. Sa parole directe inquiète le plus souvent car jugée irrationnelle, éruptive (« la foule haineuse » dont a parlé le président) ou peu aux fait des « réalités vraies ».
Ce mouvement des Gilets jaunes a été aussi le révélateur d’un pouvoir sans assise réelle. Car la question n’est pas tant « pourquoi » ce mouvement des Gilets jaunes mais « comment » quelqu’un comme Emmanuel Macron a pu accéder au pouvoir.
Mais y réfléchir c’est se pencher dangereusement sur le fonctionnement de nos institutions. Et de nos médias. Un des intérêts de ce mouvement est justement d’avoir mis à nu la logique microcosmique du macronisme. Le pouvoir contre tous et pour peu. Sa logique anti-politique aussi, politique entendue au sens premier, vie de la cité. Le macronisme comme avatar technocratique du bonapartisme a été révélé pour ce qu’il est : une forme de pouvoir qui semble s’autonomiser entièrement par rapport à la société civile. Qui se prétend arbitre au-dessus des classes sociales mais qui sert, en dernière analyse, à ceux qui ont porté au pouvoir Emmanuel Macron. Les urnes ne sont venues que valider du vernis démocratique nécessaire et légal un candidat porté bien en amont par les milieux économiques et médiatiques.
Margaret Thatcher disait « There is no such thing as society ». Selon le libéralisme qu’elle a appliqué au fer rouge au Royaume-Uni, la société n’existe pas. Il n’existe que des individus atomisés. C’est aussi contre cela que les Gilets jaunes s’agrègent. Ils font et refont société contre le macronisme qui la détricotait avec méthode.
Hannah Arendt avait noté que le totalitarisme n’est pas tant un « régime » politique qu’une « dynamique » auto-destructive reposant sur une dissolution des structures sociales et juridiques. Leçon fondamentale que nous rappellent « les Gilets jaunes ».
[1] Qui a tué mon père, Editions Seuil, Paris, 2018.
Soutenez-nous à la hauteur de vos attentes.

Illustration : Paris, décembre 2018. Crédit: Warda Mohamed